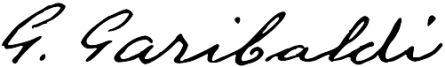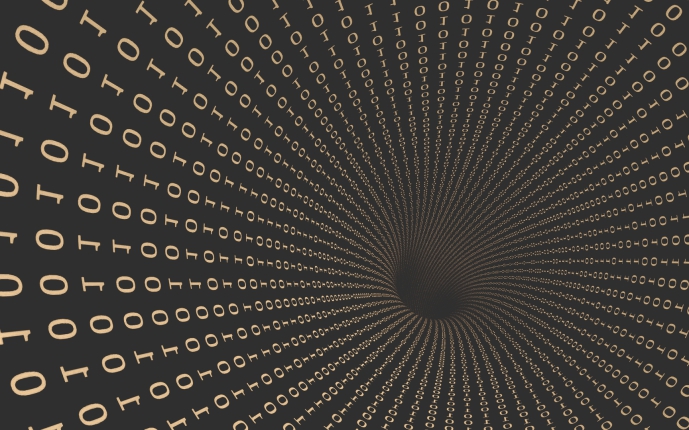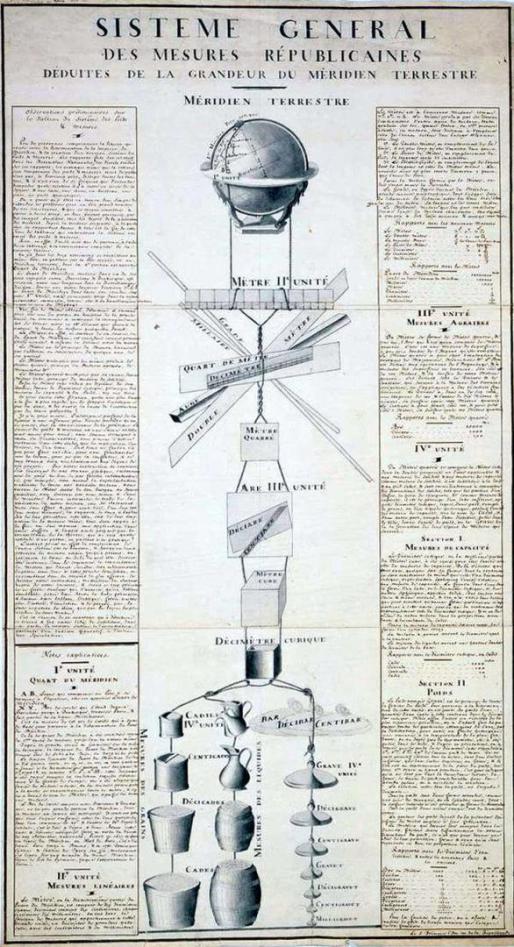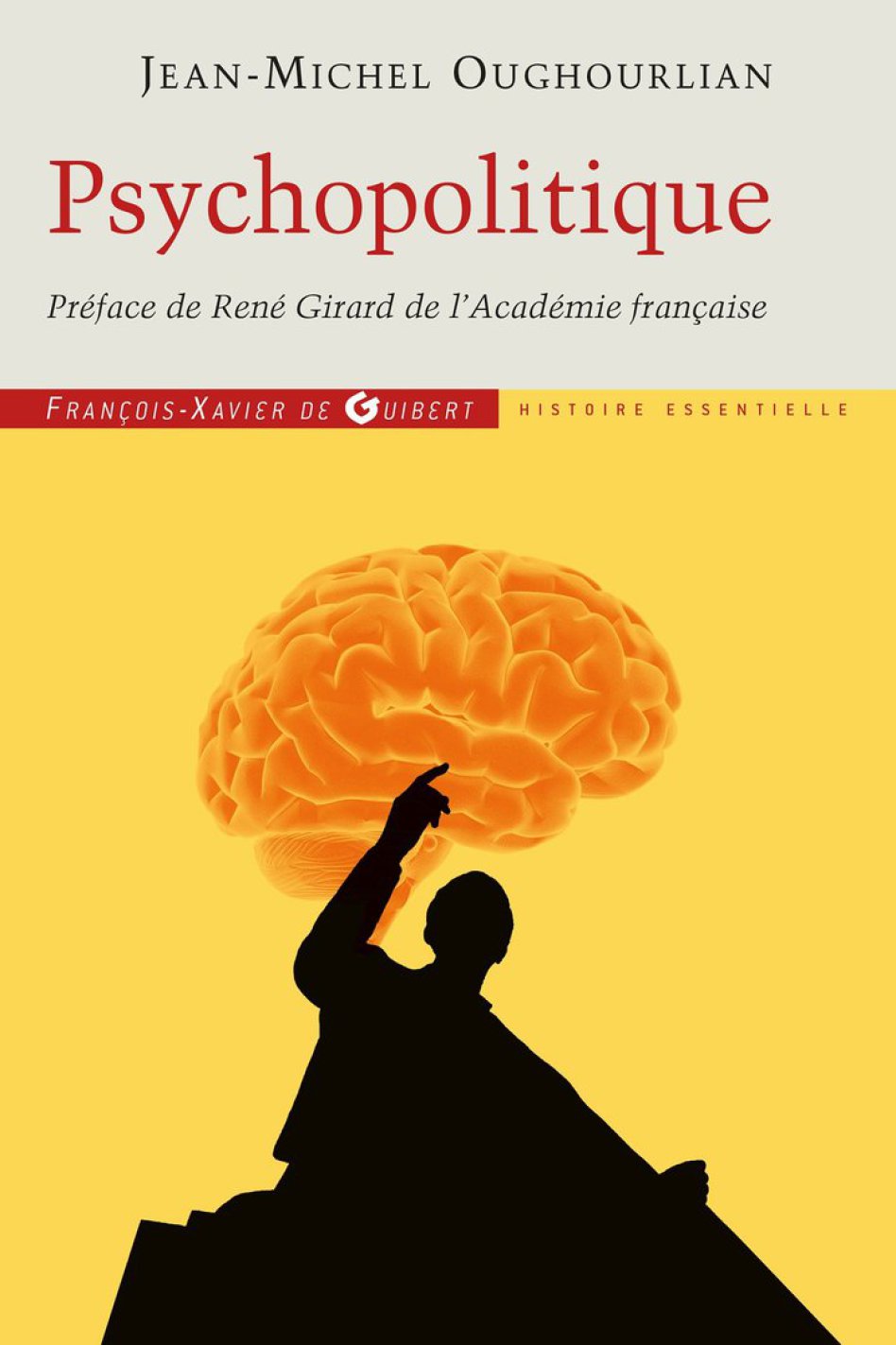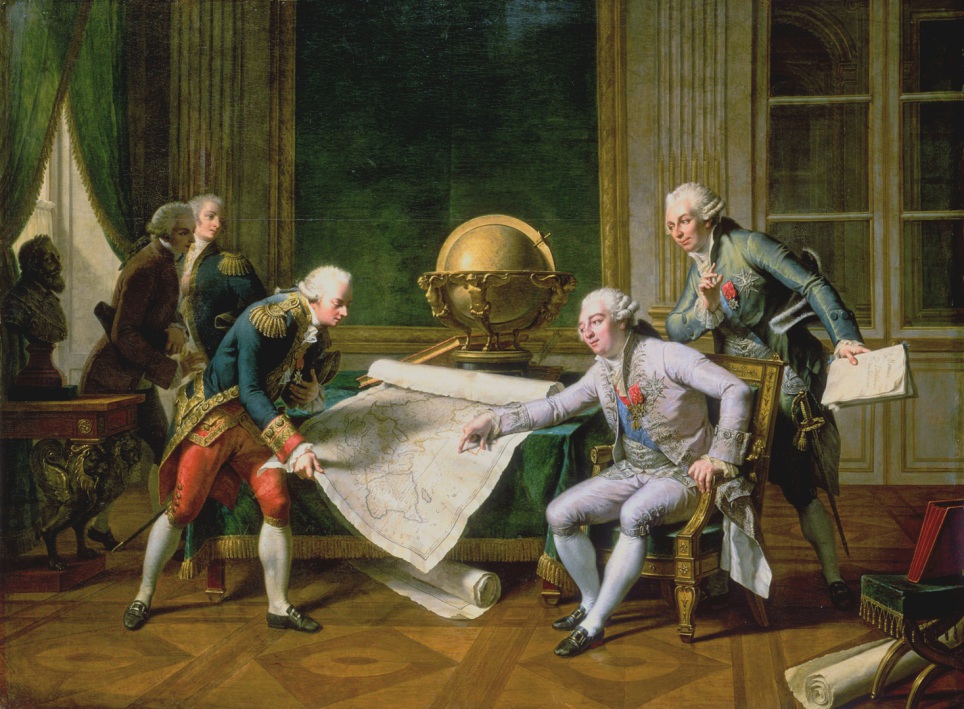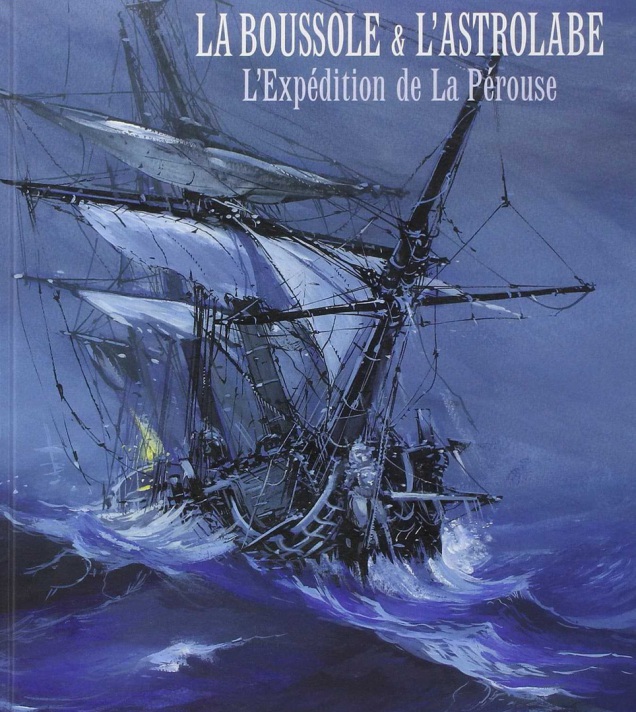TRAVAUX EN LOGE 6022-23
BERNADOTTE
CAVOUR & GARIBALDI
Il Risorgimento
Camillo Cavour
Camillo Benso, comte de Cavour
Homme État italien. acteur de l’unité italienne. Il est considéré, avec Giuseppe Garibaldi, Victor-Emmanuel II et Giuseppe Mazzini, comme l'un des « pères de la patrie » italienne.
Né le 10 août 1810 à Turin ; décédé le 6 juin 1861 dans la même ville.
Initié franc-maçon de Rite Écossais Ancien et Accepté.
Le Risorgimento
Entre la première guerre d'indépendance (1848) et la déclaration de l'Unité italienne (1870), trois hommes ont œuvré au Risorgimento.
Garibaldi, aventurier sublime, désordonné et brouillon : la force de l’épée ;
Mazzini, révolutionnaire carbonariste et inflexible, républicain farouche, perpétuel exilé : l’intellectuel malchanceux ;
Cavour, homme d’état réaliste, constructeur patient et pragmatique, adepte du compromis : le diplomate versatile.
Mais c’est en s’opposant vivement les uns aux autres, sans toutefois vouloir s’anéantir jamais, qu’ils parvinrent à donner son Unité à l’Italie ; en l’espérant de toute son âme (Mazzini), en combattant sans relâche (Garibaldi), en profitant des opportunités que les circonstances lui permettaient de saisir (Cavour).
Le Risorgimento est le fruit inattendu et singulier de cette conjonction d’efforts tout à la fois antagonistes et complémentaires, de hasards inattendus et favorables et de détermination.
Aussi dissemblables qu’ils furent, Mazzini, le sec, Garibaldi, le brave et Cavour, le voluptueux, avaient en partage l’anticléricalisme et la maçonnerie.
Second fils du cinquième marquis de Cavour, grand propriétaire foncier piémontais, collaborateur du prince Borghese et de Adèle de Sellon, issue d’une grande famille de notables calviniste de Genève, Camillo Cavour, reçut une éducation libérale et européenne. Sa langue maternelle, le français, reste tout au long de son existence son moyen d'expression en privé ; il n'utilisera l'italien que dans sa vie publique.
Extrêmement actif, il fréquente l'Académie militaire royale de Turin, qu'il termine en 1825. Nommé à quatorze ans page du prince de Carignan grâce aux relations de son père, il vit cette fonction, censée être un honneur, davantage comme une servitude. Au cours de l'hiver 1826-1827, grâce aux cours de l'École d'application du Corps royal du génie de Turin, il devient lieutenant du corps du génie.
Cavour se passionne pour l’économie et les sciences. Il veillera toujours à enrichir son domaine des technologies agraires les plus modernes que ses voyages, principalement en Angleterre et France lui permettent d’importer.
Il cultive très tôt de puissantes relations européennes, en France, grâce à son oncle Clermont-Tonnerre, avec Guizot, Louis Philippe premier et Louis Napoléon Bonaparte, en Angleterre auprès de Disraeli, Gladstone et divers membres du parti Whig.
Ses affinités intellectuelles le portent à révérer Bentham et Tocqueville et forger sa philosophie politique, résolument libérale et libre-échangiste.
Il se consacre à la gestion de ses domaines, et multiplie des initiatives industrielles et bancaires.
En 1847, Cavour fait son apparition officielle sur la scène politique en tant que fondateur, avec le catholique libéral Cesare Balbo, du journal Risorgimento dont il prend la direction.
Il écrit à cette époque :
« L'histoire de tous les temps prouve qu'aucune nation ne peut atteindre un haut degré d'intelligence et de moralité sans que le sentiment de sa nationalité soit fortement développé : dans un peuple qui ne peut pas être fier de sa nationalité, le sentiment de la dignité personnelle existera seulement exceptionnellement chez quelques individus privilégiés. Les classes les plus peuplées qui occupent les positions les plus humbles dans la sphère sociale ont besoin de se sentir grandes du point de vue national pour acquérir la conscience de leur dignité. »
Il devient Chef de la majorité anticléricale au parlement, puis ministre du royaume de Sardaigne de 1850 à 1852 et encore chef du gouvernement de 1852 à 1859.
Cavour s'oppose aux idées républicaines de Giuseppe Mazzini et de Garibaldi qu'il considère excessivement révolutionnaires.
Au contraire, Cavour tient à entretenir des relations amicales avec la France. Ses années au ministère du Commerce dans le gouvernement piémontais (dès 1850), lui permettent de multiplier les accords bilatéraux avec les puissances européennes comme la Grèce, l'Allemagne, la Suisse et les Pays-Bas.
Mais ses efforts diplomatiques sont mis à mal. Dès 1860, alors que Cavour est Président du conseil des ministres, les tensions s'accroissent. La France exige que le règne séparé en Toscane soit placé sous tutelle de la Maison de Savoie et réclame Nice et la Savoie. Si le piémont refuse l'accord, il se retrouve seul face à l'Autriche. Cavour, appuyé par la Grande Bretagne défie la France en organisant un référendum sur la question de la création d'un nouvel Etat, référendum qui légitime l'assimilation de la Toscane au Règne de Sardaigne. La France annexe alors la Savoie et Nice, en échange desquelles le Règne de Sardaigne s'agrandit annexant la Lombardie, l'Emilie-Romagne.
L'Italie commence son unification. Mais un deuxième homme permet d'accélérer le processus. Il s’agit de Garibaldi (voir le chapitre le concernant)
Cavour est jugé comme extrêmement sympathique par ses contemporains ; d'humeur enjouée, on dit de lui qu'il a « la politique gaie » et le peuple piémontais, dont il a gagné l'affection, l'appelle « papa Camillo ».
Cavour ne s’est jamais marié, affirmant « Je ne peux prendre de femme maintenant, je dois faire l'Italie ». Bon vivant et sensuel, Cavour a de nombreuses liaisons brèves et discrètes. Fin gastronome il met au point divers potages, mets ou desserts célèbres qui portent son nom.
En 1861, avec la proclamation du royaume d'Italie, il devient le tout premier Président du Conseil du nouvel État italien.
Atteint de paludisme, il meurt brutalement deux mois et treize jours après sa prise de fonction.
Les entretiens de Charles de Rémusat avec Camillo Cavour que nous proposons, présentent le double intérêt du recul sur l’œuvre d’une vie car recueillis quelques mois avant sa mort prématurée et d’être libérés des contraintes de forme et de prudence exigées autrement dans des discours publics ou des proclamations.
CHARLES DE RÉMUSAT
ENTRETIENS AVEC CAVOUR
(NOVEMBRE 1860 ET JANVIER 1861)
Charles de Rémusat fit un voyage en Italie dans l'hiver 1860-1861. Pendant ses deux séjours à Turin, il eut plusieurs entretiens avec Cavour, qu'il connaissait depuis longtemps, l'ayant rencontré pour la première fois en 1838, chez le duc de Broglie. C'est de ses Notes politiques sur l’Italie qu'est extraite la relation de ses conversations avec Cavour.
Turin, novembre 1860
Le lendemain de mon arrivée, j'allai chez M. de Cavour (28 novembre).
Je le trouvai dans ce même cabinet assez mesquin où je l'avais vu quatre ans auparavant. Il ne me parut ni vieilli, ni fatigué, toujours simple de manières, facile, causant, point infatué, point solennel. C'est un esprit sans éclat, mais sans nuage. Il a en général les lumières et les idées d'un libéral anglais, avec la vivacité et la simplicité de l'esprit italien. Les difficultés, les finesses, les profondeurs des questions ne le troublent pas; il n'engendre ni scrupule, ni scepticisme, là où nos habiles ne manquent pas de concevoir l'un et l'autre, plus encore par faiblesse d'esprit que par délicatesse de conscience ou excès de pénétration. Ce n'est pas que je croie Cavour d'une grande sévérité morale dans le gouvernement. Ses principes généraux de politique sont parfaitement honnêtes et sa modération naturelle, une certaine bienveillance, l'impartialité d'un esprit calme et ouvert le préservent des sentiments étroits, passionnés qui engendrent les mauvaises actions. Mais pourvu que ses principes politiques soient saufs, que le but soit avouable et légitime, et qu'il ne s'agisse pas de violer l'humanité envers les personnes, il ne s'inquiète pas avec excès de la rigoureuse honnêteté, ni surtout de la dignité des moyens. Il est Italien en cela; l'intérêt avoué lui paraît excuser ou couvrir bien des choses. Seulement, il faut que cet intérêt soit de ceux qu'une saine et raisonnable politique peut défendre.
Comme homme d'État, il a certainement plus de coup d'œil, de promptitude, de résolution, de courage d'esprit et de hardiesse à se compromettre, qu'aucun de ceux que j'ai pu connaître et même qu'aucun de ceux dont j'ai entendu parler depuis quarante ans. Il est de sang froid, optimiste, sans présomption, et il a à un haut degré cette qualité tant prisée des Anglais dans un premier ministre : la bonne humeur. On ne sait comment refuser la grandeur à un homme qui a pris sciemment le rôle qu'il remplit en Europe depuis dix ans, et qui a fait avec conscience de son œuvre une chose qui, dût-elle échouer, restera grande. Cependant, la grandeur manque à son esprit autant qu'à toute sa personne. Je crois que cela tient surtout au défaut d'imagination. L'imagination seule ajoute aux grandes choses les proportions qu'elles méritent, elle le suppose même quelquefois et prête une forme éclatante à ce qui ne la comporte en rien. Cavour n'a rien de cela.
Il est prosaïque. Sa conversation est solide et assez piquante, mais c'est tout. Au point de vue philosophique, son esprit laisse à désirer autant qu'au point de vue poétique. C'est un de ces esprits anglais qui ne s'élèvent pas en fait de métaphysique au-dessus de l'économie politique. Il s'en suit que ce que Cavour écrira, s'il écrit quelque chose, pourra bien être au-dessous de ce qu'on attendra ; mais ce double défaut de philosophie et d'imagination ne fait pas un vide bien fâcheux chez un homme d'État. Si l'on est Achille, on n'a pas besoin d'être Homère. Il est vrai que je ne parle pas ici d'un personnage héroïque, mais je parle certainement d'un homme d'État.
Cavour me reçut avec empressement. Nous n'avions eu que de bons rapports. Il était étonné et ennuyé de la malveillance des salons de Paris envers lui et son pays. Il savait que je n'en étais pas atteint. Moi-même j'avais pris soin de l'en informer, en profitant d'une lettre de recommandation qu'on m'avait demandée, pour lui témoigner estime et sympathie.
Il m'accueillit donc comme un ami. Je commençai par le remercier de la manière dont il avait reçu ma recommandation, ajoutant aussitôt que malgré ma gratitude et bien qu'ami de sa politique et de l'Italie, j'aurais, si nous avions le temps de causer, bien des doutes à lui soumettre dont quelques-uns pourraient ressembler à des critiques.
« Oh! des doutes!, me dit-il sur-le-champ, comment n'en avoir pas en de pareilles affaires ?
Moi-même, il y a bien des moments où je me demande si j'ai bien fait de laisser partir Garibaldi. » Ce fut sa première parole, et elle me frappa, car elle répondait juste à ma pensée. Je croyais, moi aussi, que l'expédition de Garibaldi était la source de tout ce qui s'était fait de hasardeux et de regrettable dans les derniers événements.
« Mais le pouviez-vous empêcher ? lui dis-je. Nous avions cru que c'était un coup de tête, que l'opinion publique prend sous sa protection, et qu'on est forcé de laisser faire. »
«Non, car il n'y avait matériellement aucune difficulté à empêcher Garibaldi de partir. Cela se serait fait sans trouble.
Les difficultés auraient été toutes politiques. C'était créer dans l'opinion un grand sujet de division.
Il est douteux, que le traité qui cédait à la France Nice et la Savoie eût passé à la Chambre, ou du moins passé avec une majorité suffisante. C'était à coup sûr un changement de ministère.»-« Alors, je regrette encore plus l'expédition de Garibaldi. Je n'ai point d'objections générales à l'unité de l'Italie, mais je crois qu'il ne faut ni la précipiter, ni la vouloir absolue.
Je trouve que le système d'annexion a été trop étendu, trop complet. Ce n'est pas d'une manière aussi brusque, aussi carrée, que doivent se faire de tels changements. Enfin, j'aurais, en fait d'annexions, préféré la qualité à la quantité, et j'aimerais mieux vous voir avec un royaume militairement bien constitué, gardant la frontière des Alpes de Venise à Gênes, que vous étendant au Sud et cherchant à vous donner la Sicile et Rome elle-même quand vous êtes à découvert du côté de la Lombardie. »
Il fit un signe d'assentiment : « Mais ce n'est pas nous, observa-t-il, qui avons fait le traité de Villafranca. Du reste, il ne faut pas s'exagérer les embarras que causent les dernières annexions. Les principales difficultés sont dans le royaume de Naples, et elles ne sont pas de celles que le temps et un bon gouvernement ne peuvent résoudre. La vraie difficulté est à Rome. Là aussi, il faut du temps. Nous ne pouvons offrir au Pape du pouvoir en échange des concessions nécessaires; car c'est du pouvoir qu'il faut qu'il cède. De l'argent, il n'en voudrait pas recevoir de nous. Nous ne pouvons lui offrir que de la liberté; celle de sa souveraineté morale et spirituelle, même ecclésiastique, l'abolition des concordats, enfin la liberté de l'Église. Est-ce que la France ne serait pas disposée à nous suivre dans cette voie ? Elle ne peut plus s'attacher à l'ancien gallicanisme. Il est d'un autre temps, et m'a l'air fort abandonné. Est-ce qu'un accommodement sur le principe de la liberté ne lui conviendrait pas, et même à son clergé ? Il y a dans celui de Rome un parti qui ne serait pas éloigné d'entrer dans ces idées. Plusieurs cardinaux, et des plus respectés pour la piété et la science, seraient pour une transaction. […] »
-«Quant à l'Autriche, il faut compter sur les plaies qui la rongent. Elle a beaucoup à faire chez elle pour agir chez nous. Ce que nous avons trouvé à Naples justifie ce que nous avons fait. Les difficultés qu'on y rencontre viennent précisément de l'excessif désordre que le gouvernement royal y avait laissé, augmenté du désordre que Garibaldi y avait apporté.
[…]
Ce sont les incroyables bêtises de Garibaldi qui ont rendu possible la résistance de Gaëte. Sans les fautes de Garibaldi, il y a longtemps que le roi François II aurait quitté le territoire napolitain. Mais, ajouta-t-il, je voudrais causer plus amplement avec vous. Voulez-vous venir chez moi demain de bonne heure ? »
-« Bien volontiers, mais je ne voudrais pas être indiscret.»-« Ne le croyez pas; ce serait moi, au contraire, qui serais bien aise de m'expliquer avec vous.
D'abord, je n'ai rien à cacher, puis je tiendrais à vous mettre au courant. […]
Le lendemain 29, j'étais chez Cavour. Son hôtel, ou, comme on dit en Italie, son palais, est un grand bâtiment triste à façades uniformes, en dehors et en dedans. Le vestibule et l'escalier sont assez vastes avec peu d'architecture. Tout cela est noir et négligemment tenu; c'est un usage assez général. Il demeure au premier sur le même palier que son frère le marquis. Son antichambre est sale et mesquine. Mais, dès qu'on est dans les salons, on les trouve comme partout, élevés, ornés, avec un vieux luxe de peintures et de dorures qui a fort bon air. Il était en robe de chambre, avec un bonnet de velours, ayant la mine d'un notaire fort occupé, devant une table où brûlaient trois ou quatre bougies. Il remettait quelques dépêches, qu'il venait évidemment de finir, à un courrier qui partait pour Naples, l'une pour M. Farini, l'autre pour M. Scialoja; quand ce fut fini, il prit pour ainsi dire la parole, et voici ce qu'il me dit :
«Dès le commencement de mon administration, je me suis attaché à cette idée et à cette idée seulement l'expulsion des Autrichiens de la péninsule, ce qui ne pouvait se faire sans un certain agrandissement du Piémont. Le Piémont ne pouvait, dans ce plan, manquer d'être un grand royaume au nord de l'Italie, uni à tout le reste par une fédération. Nous nous sommes toujours conduits en vue de cette hypothèse. Mais ce n'était qu'une hypothèse, jusqu'au jour où l'on connut positivement les dispositions de l'Empereur. Des conventions furent faites avec lui; non seulement orales, mais écrites. Le plan prit alors plus de consistance. Mais nos vues d'annexion n'allaient pas au delà d'Ancône, qui, par diverses raisons géographiques, est nécessaire aux provinces de l'Adriatique; du côté de la Méditerranée, nous ne songions point à la Toscane. Elle devait rester, non pas en dehors de l'Italie confédérée, mais du royaume septentrional. L'idée de l'unité de l'Italie avait de bonne heure fait de grands progrès, et surtout fait perdre beaucoup de terrain à l'unité républicaine de Mazzini. Le coup décisif en faveur de notre idée fut porté par Manin, lorsqu'il se déclara pour nous.
C'est peut-être le plus grand service qui aura été rendu à la cause italienne.
« La guerre arriva, vous savez comment. L'empereur Napoléon tint absolument, je n'ai jamais très bien compris pourquoi, à débarquer un corps d'armée en Toscane, et à y envoyer le prince Jérôme Napoléon. J'essayai de m'y opposer, mais inutilement. Cela me donna beaucoup de soupçons.
Je craignais qu'il ne voulût faire son cousin grand-duc de Toscane, roi d'Étrurie, etc. ; je n'en voulais à aucun prix, je me serais trouvé avoir introduit en Italie une nouvelle dynastie étrangère, livré une partie du pays à la France. Je voulais à tout prix empêcher cela. C'est alors que j'essayai de faire vibrer en Toscane la corde de l'unité. Ce n'eut aucun succès.
[…]
« La paix de Villafranca survint. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle me surprit beaucoup. Je ne pourrais pas encore dire aujourd'hui pourquoi l'Empereur l'a faite. Plusieurs motifs peuvent y avoir contribué ; une cause physique peut n'en avoir pas été le moins puissant, la chaleur de la température qui, en effet, était insupportable. Quoi qu'il en soit, la paix de Villafranca donna à l'unité un élan subit, universel, irrésistible. Ce devint un cri général. C'est de Villafranca qu'il faut dater le triomphe de l'unité.
Je ne dirai pas qu'on se crut trahi, mais on se sentit abandonné. On s'étonne de ce grand mouvement vers l'unité; c'est la présence des Autrichiens maintenue à Vérone qui a tout fait, aidée, j'en conviens, par la mauvaise conduite des princes, et surtout du roi de Naples qui, avec une alliance, une proclamation et la mobilisation de 25 000 hommes, aurait sauvé sa couronne.
«En même temps, la fédération devenait impossible; avec qui nous serions-nous confédérés pour l'indépendance de l'Italie ? Ce n'était pas la cause des anciens pouvoirs, qui d'ailleurs n'existaient plus. Ni Naples, ni Rome ne voulaient s'allier avec nous, former encore moins une fédération anti-autrichienne. Le traité de Villafranca était tombé à l'état de lettre morte. La France en fit l'aveu en concluant le traité de cession de la Savoie qui admettait virtuellement toutes les annexions.
C'est alors que les troubles de la Sicile éclatèrent. Garibaldi voulut partir. Comme je vous l'ai dit, rien de plus facile que d'empêcher son départ. Il n'y aurait pas eu d'émeute, même à Gênes. S'il y en avait eu, on l'eût réprimée sans peine. Il n'y avait nul ébranlement dans l'armée. Au contraire, l'armée ne peut souffrir Garibaldi, et nous avons toutes sortes de peines à faire accorder par les soldats le salut militaire aux Garibaldiens. Mais la présence de Garibaldi dans le Parlement, de Garibaldi retenu de force quand ses Italiens armés l'appelaient, de ce soldat de l'indépendance indigné qu'on enchaînât son bras et qu'on livrât à la France Nice, sa patrie, parlant de la délivrance de Naples et de Palerme, de la délivrance de Venise et de Rome, dénonçant également la diplomatie française et la tyrannie autrichienne, aurait causé ici même un grand trouble. La majorité se serait scindée. Je ne dis pas que le traité avec la France aurait été rejeté, mais il aurait mal passé, à la majorité la plus réduite. Le ministère était perdu, mais ce qui est plus grave, les rapports avec la France étaient altérés. L'émancipation à l'égard de l'alliance française aurait été à l'ordre du jour. Le grand parti gouvernemental était désorganisé.
[…]
«La modération est le caractère naturel de la Révolution italienne.
Vous voyez comme Turin est tranquille. Vous allez parcourir l'Italie, vous trouverez toutes les grandes villes aussi calmes. A Naples même, il n'y a que du désordre moral. Les troupes n'ont pas eu à sortir de leurs casernes pour rien réprimer. Nous n'avons point de parti de l'émeute. La garde nationale y suffit à tout. Elle est bonne; car ce qu'il y a de mieux à Naples, ce sont, avec les literati, les boutiquiers et la petite bourgeoisie; le mal est dans une partie de la noblesse, les anciens fonctionnaires et la populace.
Dans la Romagne, où les passions sont vives et les vengeances contre les personnes fréquentes, nous n'étions pas tranquilles au moment où le mouvement s'est fait. Nous craignions que la cultelleria n'allât son train.
Minghetti me disait : « Il y aura quinze mauvais jours à passer. » Nullement : point de violence; pas un prêtre n'a été maltraité ni menacé.
« Pour le gouvernement représentatif, soyez tranquille. Je suis aussi parlementaire que vous. J'ai même le défaut d'avoir l'humeur batailleuse, et le pouvoir n'a d'attrait pour moi qu'autant qu'il est disputé. J'aime à tout gagner à la pointe de l'épée. Du reste, sortez dans la rue, achetez un journal de l'opposition, vous verrez si en Angleterre même la liberté de la presse est aussi complète qu'ici. J'ai refait l'expérience qui, au reste, avait été si souvent conseillée, c'est de tout tolérer en fait d'attaques. Nous n'avons même pas forcé les partis subversifs à prendre un masque de légalité.
Le mazzinisme s'est montré à visage découvert. Je suis convaincu que si la République s'était dissimulée, si on l'avait insinuée comme un idéal secret, les jeunes gens s'y seraient laissés séduire davantage. La République a été prêchée ouvertement, et l'Italie est beaucoup moins républicaine qu'en 1848. Je ne connais guère qu'un remède à la puissance de la presse : l'impunité.
«Quant au clergé, ma politique personnelle est de le traiter comme la presse, de le laisser tout faire. Sous le ministère de M. Ratazzi, on a retouché nos lois criminelles, où, parmi beaucoup de choses que j'approuve, on a inséré deux articles que je n'approuve pas, calqués sur votre code, et qui punissent le ministre du culte qui attaque le gouvernement ou lui refuse un service qu'il lui doit. Le cas s'est présenté dans les Romagnes : il a fallu appliquer la loi. Eh bien, dans les Romagnes mêmes, où le clergé est peu populaire, ces rigueurs légales ont été mal vues par l'opinion, et j'espère bien qu'on n'y reviendra pas. Le clergé est assez calme, plus indifférent qu'on ne croit à tout ce qui se passe. En Piémont, il ne nous cause pas le moindre ennui. Nous avons des prêtres dans le Parlement, qui ne sont pas hostiles. Je suis très bien avec mon curé qui est un ancien Récollet. Le Roi a autant de prêtres qu'il veut pour lui dire la messe. A Naples, des évêques montrent jusqu'à du zèle pour nous. Le clergé ne peut s'empêcher de voir que partout l'Église jouit d'une grande liberté. Il a fallu amener ici l'archevêque de Pise, qui avait directement manqué de respect au Roi. Une fois ici, il y a été libre, tranquille, bien traité, bien logé ; il a été frappé de ce qu'il a vu. Il n'a pas voulu me voir, mais il a rencontré plusieurs fois le ministre de la Justice qui est chargé des cultes, et, en prenant congé de lui, il partait avec des idées modifiées par ce qu'il avait vu et entendu à Turin. »
[…]
Turin, février 1861: ouverture du Parlement italien
Cette solennité est un fête publique à Turin. La ville est dans ces jours-là décorée, illuminée, et le goût italien, sans être fort pur ni parfaitement correct, se montre dans la disposition générale de ces sortes de spectacle. On sortait du carnaval qui avait été fort animé; car, à Turin comme dans toute l'Italie, on prend encore très sérieusement le carnaval. Le Roi était, au milieu d'une grande affluence, allé célébrer à Milan le Carnovalone, c'est-à-dire une prolongation de trois jours de carnaval sur le Carême, et que saint Charles Borromée passe pour avoir accordée à sa ville métropolitaine. Le mouvement était partout, et une émotion d'un autre ordre mais sincère et générale, agitait les populations à l'ouverture de ce premier Parlement italien. Tout Turin était donc en joie, et comble de visiteurs de toutes les parties de l'Italie; le lundi 18 février, ce jour qui pouvait être la manifestation solennelle du plus grand événement du siècle, j'ai assisté à la séance royale. Elle a été digne des circonstances.
Le roi Victor-Emmanuel a une figure très ingrate. Il est moins grand que je ne pensais ; il devient gros, et ce n'est même pas un beau soldat, quoique sa figure et sa prestance soient fort soldatesques. Cependant, ses manières simples ne sont ni rudes ni déplaisantes, il est tranquille. Il a prononcé son discours sans embarras, sans emphase, assis, la tête nue, mais avec accent et dignité. Il n'est nullement gêné d'être un Roi, et, somme toute, il en a l'air quand on l'entend. Son discours était excellent, patriotique et politique, prudent au fond et animé dans la forme. Il a été parfaitement approuvé et compris ; les nuances, les indications ont été vivement saisies. Quant à l'enthousiasme de l'Assemblée, ou plutôt au sentiment vrai, plein d'une joie sérieuse et d'une conscience satisfaite, exprimé par des acclamations telles que je n'en entendis jamais, je renonce à le peindre.
Dans ce nom II Re d'Italia, le mot Italia était prononcé avec un accent que je ne saurais rendre.
Mais qu'il était difficile d'être présent à ce spectacle, sans faire, après quelques moments donnés à une irrésistible sympathie, un triste retour sur nos souvenirs ! Assistions-nous aussi à une journée d'illusions nationales? Ne se trompait-il pas, ce peuple heureux, dans son espérance, dans sa confiance, dans son ambition ? L’avenir ne réservait-il pas à ce noble et doux songe le plus cruel, le plus humiliant réveil? Étaient-ils trompeurs, tous ces oracles de la politique qui, au delà des Alpes, ne lui présageaient que misère et désastres? Et quand l'esprit qui l'anime serait aussi éclairé qu'il est confiant; quand il serait dans la raison et le droit, en espérant sa renaissance à la puissance et à la liberté, comment oublier combien notre temps se plaît à démentir les plus justes calculs, à briser les combinaisons les plus sages, à outrager les plus nobles causes ? Comment compter sur la fortune lorsqu'il faut qu'elle protège une juste révolution ? Et alors, je me reprenais à penser à ce que nous avons éprouvé de semblable. Je n'étais pas à cette séance où le Roi des barricades vint promettre à sa dynastie et à la France un avenir indéfini de liberté ; mais nos sentiments d'alors, notre confiance dans notre cause, notre enthousiasme pour ce que nous avions fait, tout cela m'est présent. Qu'est-ce que tout cela est devenu, et que pensent de l'œuvre ceux mêmes qui en furent les auteurs ? Elle est désavouée, elle est trahie. Ceux qui la regrettent la méconnaissent et ne la recommenceraient pas. Les uns en parlent comme des écarts d'une jeunesse orageuse, les autres comme des illusions d'une jeunesse romanesque. Puisse l'Italie en vieillissant rester telle que je la vois.
Charles de REMUSAT.
Giuseppe Garibaldi
Père de l’Unité Italienne
Né le 4 juillet 1807 à Nice (Empire français) ; décédé (royaume d’Italie) le 2 juin 1882 à Caprera.
Initié en 1844 dans la loge l’Asile de la Vertu à Montevideo.
Membre de la loge Les amis de la Patrie au Grand Orient de France.
Grand Maître du Suprême Conseil Écossais de Palerme en 1862.
Grand Maître du Grand Orient d’Italie en 1864.
Grand Hiérophante du Rite Réformé de Memphis et Misraïm en 1881.
Membre honoraire du Souverain sanctuaire du rite ancien et primitif pour la Grande-Bretagne et l'Irlande.
Grand Maître honoraire ad vitam de la Maçonnerie Italienne en 1867.
Garibaldi est l’auteur du Risorgimento italien avec Giuseppe Mazzini (1805‑1872) également Grand Maître du Grand Orient d'Italie et le Comte Camillo di Cavour (1810-1861) franc-maçon lui aussi.
Son père est capitaine dans la marine marchande et ses frères marins ou commerçants. L’enfant n’aime pas les études et privilégie les activités physiques et la vie en mer. Un jour, il prend la mer avec quelques compagnons mais il est arrêté et reconduit au domicile de ses parents. Les cours d’italien et d’histoire antique qu'il reçoit de son précepteur, le signor Arena, un ancien combattant des campagnes napoléoniennes, crée chez le jeune Giuseppe une véritable fascination pour la Rome antique.
Il convainc son père de le laisser suivre la carrière maritime et à 17 ans, s’embarque pour son premier voyage qui le conduit à Odessa, en mer Noire, et jusqu’à Taganrog, en mer d’Azov.
Marin de vocation, Giuseppe Garibaldi rencontre Giuseppe Mazzini en 1833 à Marseille et adhère à Giovine Italia (Jeune Italie), association secrète ayant pour dessin de transformer l'Italie en une république démocratique unitaire. Il participe au mouvement insurrectionnel mazzinien de l'arsenal de Gênes ; reconnu comme un chef de la conspiration, il est condamné à la peine de mort par contumace.
L'Italie lui étant désormais interdite, il s’exile en Amérique du Sud et participe de manière décisive aux guerres de libération de la jeune république d’Uruguay dont il devient le héros et qui lui consacre une journée de fête nationale aux anniversaires de sa mort.
Le 23 juin 1848, après quatorze ans d’absence, Garibaldi gagne Gênes avec cent cinquante volontaires et offre son épée au roi de Sardaigne pour chasser l'Autrichien de la péninsule. Le 12 décembre Garibaldi pénètre dans Rome avec sa légion ; le 21 janvier 1849, il est élu à l'assemblée constituante de la future République qui s'organise autour d’un triumvirat auquel participe Mazzini. Le 8 février 1849, la République romaine est proclamée. Pour abattre la nouvelle république le pape Pie IX fait appel à l'aide internationale à laquelle répondent l'Autriche, la France, l'Espagne et Naples. Face aux troupes françaises bien entraînées et équipées, Garibaldi résiste un mois dans des combats intenses où nombre de ses partisans succombent. Il devient férocement anticlérical en raison de la position du clergé fidèle au pape que soutiennent Français et Autrichiens.
De nouveau en exil, il embarque pour Tunis avant d'arriver à Tanger. Il gagne le Pérou pour s'engager comme capitaine dans la marine et parcourir le monde. En janvier 1852, il obtient la citoyenneté péruvienne et le commandement du bateau « Carmen » sur lequel il s’embarque pour la Chine pour vendre du guano ; puis il se rend à Manille, en Australie puis à New York où il quitte son poste de capitaine le 6 septembre 1853.
En 1858 Cavour, que Garibaldi a rencontré pour la première fois en 1856, envisage de l'utiliser activement dans la guerre qui se prépare. Garibaldi est nommé major-général. Il rencontre pour la première fois Victor-Emmanuel II. En avril 1860, Garibaldi est sollicité pour prendre la direction d'une expédition destinée à soutenir la révolte qui a commencé à Palerme ; le nombre de ses volontaires atteint le millier d'hommes, ce qui a donné son nom de légende à l'entreprise : « l’expédition des mille ». Les combats tournent à l'avantage des garibaldiens soutenus par les Siciliens. En mai 1860 se proclame dictateur (au sens de l’ancienne Rome) au nom de Victor-Emmanuel II et forme un gouvernement provisoire. Dès lors, Garibaldi poursuit sa conquête sur la péninsule et marche sur Naples qu'il prend le 7 septembre 1860. Les troupes piémontaises battent l'armée pontificale à Castelfidardo. De son côté Garibaldi affronte et bat les vingt mille soldats de l'armée des Bourbons à Volturno. Les plébiscites de la Sicile et de Naples rattachent le royaume des Deux-Siciles à celui du Piémont. Garibaldi salue en Victor-Emmanuel II le roi d'Italie, ce qui lui apporte la caution de la faction républicaine. Après une troisième guerre d’indépendance Rome est rattachée à l'Italie le 2 octobre 1870, à la suite d'un plébiscite. Le rêve italien de Garibaldi est réalisé.
Pendant la guerre franco-prussienne de 1870, au cours de laquelle Napoléon III est fait prisonnier, une révolution à Paris abat le Second Empire et la Troisième République est proclamée. À la proclamation de la République, Garibaldi adresse un message au Gouvernement de la Défense nationale : « Ce qui reste de moi est à votre disposition, disposez ». Gambetta (son frère en maçonnerie) lui confie le commandement de tous les corps francs de la zone des Vosges, de Strasbourg à Paris. Garibaldi organise l'armée en quatre brigades sous le commandement de ses deux fils, Ricciotti et Menotti. Le 19 novembre, Ricciotti inflige une défaite aux Prussiens du général Werder. Il faut attendre le 21 janvier 1871 pour que Garibaldi s'installe à Dijon qui est attaquée par quatre mille Prussiens ; Garibaldi sort victorieux. Un armistice entre en vigueur le 28 janvier 1871 mettant fin à la participation de Garibaldi au conflit. En février 1871, Garibaldi est élu sans avoir été candidat, sur les listes de l'Union républicaine à l'Assemblée nationale française. En raison de sa nationalité italienne et de l’opposition de la Droite, il décline ses mandats.
Mémoires de Garibaldi Giuseppe, 1860, (trad. par Alexandre Dumas, Montréal, Editions Le joyeux Roger, 2010)
Pendant l’expédition des Mille, Dumas se rend en Sicile pour livrer à Garibaldi les armes qu’il avait acquises pour sa cause. Il est aux côtés de Garibaldi le jour de son entrée dans Naples puis est nommé Directeur des fouilles et des musées, charge qu'il occupe pendant trois ans (1861-1864) Durant la même période, il dirige le journal L'Indipendente auquel collabore le futur fondateur du Corriere della Sera.
Chapitre I Mes parents
« Je suis né à Nice le 22 juillet 1807, non-seulement dans la même maison, mais dans la chambre même où naquit Masséna. L’illustre maréchal était, comme on le sait, fils d’un boulanger. Le rez-de-chaussée de la maison est encore aujourd’hui une boulangerie.
Mais, avant de parler de moi, que l’on me permette de dire un mot de mes excellents parents, dont le caractère honorable et la profonde tendresse eurent tant d’influence sur mon éducation et sur mes dispositions physiques.
Mon père Dominique Garibaldi, né à Chiavari, était fils de marin et marin lui-même ÉÉ ses yeux, en s’ouvrant, virent la mer, sur laquelle il devait passer à peu près toute sa vie. Certes, il était loin d’avoir les connaissances qui sont l’apanage de quelques hommes de son état, et surtout des hommes de notre époque. Il avait fait son éducation maritime non dans une école spéciale, mais sur les bâtiments de mon grand-père. Plus tard, il avait commandé un bâtiment à lui et s’était toujours tiré honorablement d’affaire. Sa fortune avait subi nombre d’accidents, les uns heureux, les autres malheureux, et souvent j’ai entendu dire qu’il eût pu nous laisser plus riches qu’il ne l’a fait. Mais, quant à cela, peu importe. Il était libre, pauvre père, de dépenser comme il l’entendait un argent si laborieusement gagné, et je ne lui en suis pas moins reconnaissant du peu qu’il m’a laissé. Au reste, il y a une chose qui ne fait aucun doute dans mon esprit, c’est que, de tout l’argent qu’il a jeté au vent, celui qui a glissé de ses mains avec le plus de plaisir est celui qu’il a employé à mon éducation, quoique cette éducation fût une lourde charge pour l’état de sa fortune.
Que l’on n’aille pas croire cependant que mon éducation fut le moins du monde aristocratique. Non, mon père ne me fit apprendre ni la gymnastique, ni les armes, ni l’équitation. J’appris la gymnastique en grimpant dans les haubans et en me laissant glisser le long des cordages ; l’escrime en défendant ma tête et en essayant de fendre de mon mieux la tête des autres ; et l’équitation en prenant exemple des premiers cavaliers du monde, c’est-à-dire des Gauchos.
Le seul exercice de ma jeunesse – et pour celui-là non plus je n’eus pas de maître – fut la natation. Quand et comment appris-je à nager, je ne m’en souviens pas ; il me semble queje l’ai toujours su, et que je suis né amphibie. Aussi, malgré le peu d’entraînement que tous ceux qui me connaissent savent que j’ai à faire mon éloge, je dirai tout simplement, sans que je croie qu’il y ait à se vanter de cela, que je suis un des plus rudes nageurs qui existent. Il ne faut donc me savoir aucun gré, étant connue la confiance que j’ai en moi, de n’avoir jamais hésité de me jeter à l’eau pour sauver la vie d’un de mes semblables. Au reste, si mon père ne me fit pas apprendre tous ces exercices, ce fut plutôt la faute des temps que la sienne. À cette triste époque, les prêtres étaient les maîtres absolus du Piémont, et leurs constants efforts, leur travail assidu tendait plutôt à faire des jeunes gens des moines inutiles et fainéants que des citoyens aptes à servir notre malheureux pays. En outre, l’amour profond que nous portait mon pauvre père lui faisait redouter jusqu’à l’ombre de toute étude pouvant devenir plus tard un danger pour nous.
Quant à ma mère, Rosa Ragiundo, je le déclare avec orgueil, c’était le modèle des femmes. Certes, tout fils doit dire de sa mère ce que je dis de la mienne ; mais nul ne le dira avec plus de conviction que moi.
Une des amertumes de ma vie, et ce n’est pas la moindre, a été et sera de n’avoir pas pu la rendre heureuse, mais, tout au contraire, d’avoir attristé et endolori les derniers jours de son existence ! Dieu seul peut savoir les angoisses que lui a données mon aventureuse carrière, car Dieu seul sait l’immensité de la tendresse qu’elle avait pour moi. S’il y a quelque bon sentiment dans mon âme, j’avoue hautement que c’est d’elle que je le tiens. Son angélique caractère ne pouvait faire autrement que d’avoir son reflet en moi. N’est-ce pas à sa pitié pour le malheur, à sa compassion pour les souffrances que je dois ce grand amour, je dirai plus, cette profonde charité pour la patrie ; charité qui m’a valu l’affection et la sympathie de mes malheureux concitoyens. Je ne suis certes pas superstitieux ; cependant j’affirmerai ceci, c’est que, dans les circonstances les plus terribles de ma vie, quand l’Océan rugissait sous la carène et contre les flancs de mon vaisseau, qu’il soulevait comme un liège ; quand les boulets sifflaient à mes oreilles comme le vent de la tempête ; quand les balles pleuvaient autour de moi comme la grêle, je la voyais constamment agenouillée, ensevelie dans sa prière, courbée aux pieds du Très-Haut, et moi, ce qui me donnait ce courage dont on s’est étonné parfois, c’est la conviction qu’il ne pouvait m’arriver aucun malheur quand une si sainte femme, quand un pareil ange priait pour moi.
Chapitre LVII La fin
(30 juin 1849 : prise de Rome par les troupes françaises, rétablissant le pape Pie IX)
Le général Oudinot, pour montrer, comme il l’avait dit dans ses bulletins, le culte qu’il avait voué à la cité monumentale, depuis le 21, faisait lancer des bombes sur tous les quartiers de la ville. C’était surtout pendant la nuit qu’il employait ce moyen de terreur. Beaucoup tombèrent dans le quartier Transteverin, beaucoup sur le Capitole, quelques-unes sur le Quirinal, sur la place d’Espagne, dans le Corso. Une de ces bombes tomba sur le temple qui couvre l’Hercule de Canova ; mais la coupole résista. Une autre éclata dans le palais Spada et endommagea la fameuse fresque de l’Aurore de Guido Reni. Une autre, plus impie encore, brisa le chapiteau d’une colonne du merveilleux petit temple de la Fortune virile, chef-d’œuvre respecté par les siècles.
Le triumvirat offrit aux familles populaires dont les maisons avaient été renversées un asile dans le palais Corsini. La tenue du peuple romain dans ces jours d’épreuves fut digne des temps antiques. Tandis que la nuit, poursuivies par la grêle de projectiles qui brisaient les toits de leurs maisons, les mères fuyaient, emportant leurs enfants serrés contre leur poitrine, tandis que les airs s’emplissaient de cris et de lamentations, pas une voix ne parla de se rendre.
Au milieu de tous ces cris, un cri railleur s’élevait de temps en temps lorsqu’un boulet ou un obus renversait un pan de maison :
- Bénédiction du pape ! (…)
Je n’ai jamais vu une pareille tempête de flammes, une pareille grêle de mitraille.
Nos pauvres canons en étaient en quelque sorte suffoqués. Et cependant je ne puis dire que cela à l’éloge de Medici, le Vascello et les cassines étaient encore occupées.
Le siège du Vascello seul mériterait un historien. Pendant la soirée du 28, les batteries françaises semblèrent se reposer un instant et reprendre haleine. Mais, dans la journée du 29, elles se remirent à tirer avec une nouvelle rage. Rome était pleine d’un immense frémissement. La journée du 27 avait été terrible, nos pertes avaient été presque égales à celles du 3 juin. Les rues étaient jonchées d’hommes mutilés. Les travailleurs n’avaient pas plus tôt la pelle ou la pioche à la main qu’ils étaient coupés en deux par les boulets ou mutilés par les obus.
Tous nos artilleurs, tous, entendez-vous bien, avaient été tués sur leurs canons. Le service de l’artillerie était fait par des soldats de la ligne. Toute la garde nationale était sous les armes. Il y avait, chose inouïe, une réserve composée de blessés qui, tout ensanglantés, faisaient le service. Et pendant ce temps, admirable contraste, calme et impassible, l’Assemblée, en permanence au Capitole, délibérait sous les boulets et les balles.
Tant qu’une de nos pièces de canon resta sur ses essieux, elle répondit.
Mais, le 29 au soir, la dernière fut démontée.
Notre feu s’éteignit. (…)
La nuit venue, comme on s’attendait à une attaque dans les ténèbres, toute la ville fut illuminée, tout, jusqu’à la grande coupole du Vatican. C’est, au reste, l’habitude à Rome, dans la soirée de la fête de Saint-Pierre. Celui qui, pendant cette soirée, eût arrêté son regard sur la cité éternelle, eût vu un de ces spectacles que le regard de l’homme ne contemple qu’une fois dans le cours des siècles.
À ses pieds, il eût vu s’étendre une grande vallée pleine d’églises et de palais, coupée en deux par les détours du Tibre, qui semblait un Phlégéthon ; à gauche, un mont, le Capitole, sur la tour duquel flottait au vent le drapeau de la République ; à droite, la silhouette sombre du Monte-Mario, où flottaient, au contraire, unis, les drapeaux des Français et du pape ; au fond, la coupole de Michel-Ange se dressant au milieu des nuages toute couronnée de lumière ; enfin, comme cadre au tableau, le Janicule et toute la ligne de Saint-Pancrace, illuminée elle aussi, mais par l’éclair des canons et des mousquets.
Puis, à côté de cela, quelque chose de plus grand que le choc de la matière : la lutte du bon et du mauvais principe, du Seigneur et de Satan, d’Arimane et d’Oromaze ; la lutte de la souveraineté du peuple contre le droit divin, de la liberté contre le despotisme, de la religion du Christ contre la religion des papes.
À minuit, le ciel s’éclaircit, le tonnerre et les canons se turent, et le silence succéda à l’infernal mugissement ; – silence pendant lequel les Français s’approchaient de plus en plus des murailles et s’emparaient de la dernière brèche faite au bastion no 8. […]
Dans ce moment, je l’avoue, complètement découragé sur l’avenir, je n’avais qu’un désir, me faire tuer. Je me jetai avec eux sur les Français. Que se passa-t-il alors ? Je n’en sais rien. Pendant deux heures, je frappai sans relâche. Quand vint le jour, j’étais couvert de sang. Je n’avais pas une seule blessure. C’était un miracle. C’est dans cette affaire que le lieutenant Morosini, pauvre enfant qui n’avait pas vingt ans et qui se battit comme un héros, fut tué en refusant de se rendre. Au milieu de la sanglante mêlée m’arriva un message de l’Assemblée ; elle m’invitait à me rendre au Capitole. Je dois la vie à cet ordre. Je me fusse fait tuer.
En descendant vers la Longara avec Vecchi, lequel était membre de la Constituante, j’appris que mon pauvre nègre Aguyar venait d’être tué. Il me tenait prêt un cheval de rechange, une balle lui avait traversé la tête. J’éprouvai une terrible douleur ; je perdais bien autre chose qu’un serviteur, je perdais un ami.
Mazzini avait déjà annoncé à l’Assemblée le point où nous en étions. Il ne restait que trois partis à prendre, avait-il dit : Traiter avec les Français ; Défendre la ville de barricade en barricade ; Ou sortir de la ville, Assemblée, triumvirat et armée, en emportant avec soi le palladium de la liberté romaine. - À la tribune ! à la tribune !
Quand je parus à la porte de la salle, tous les députés se levèrent et applaudirent. Je cherchai autour de moi et sur moi quelle chose devait éveiller leur enthousiasme à ce point. J’étais couvert de sang, mes habits étaient percés de balles et de coups de baïonnette. Mon sabre, faussé à force de frapper, n’entrait plus qu’à moitié dans le fourreau. On me cria : J’y montai.
De tous côtés j’étais interrogé.
- Toute défense est désormais impossible, répondis-je, à moins que nous ne soyons décidés à faire de Rome une seconde Saragosse. (…) Mais à ce qui est fait, il n’y a pas de remède. Regardons la tête haute l’incendie dont nous ne sommes plus les maîtres. Sortons de Rome avec tous, les volontaires armés qui voudront nous suivre. Où nous serons sera Rome. Je ne m’engage à rien ; mais ce que peut faire un homme, je le ferai, et, réfugiée en nous, la patrie ne mourra point.
Après une courte délibération, l’Assemblée rendit le décret suivant :
RÉPUBLIQUE ROMAINE
Au nom de Dieu et du peuple, L’Assemblée constituante romaine cesse une défense devenue impossible. Elle reste à son poste. Le triumvirat est chargé de l’exécution du présent décret.
Chapitre LVIII Qui m’aime me suive
Le 2 juillet, je rassemblai les troupes sur la place du Vatican, je m’avançai au milieu d’elles. Je leur annonçai que je quittais Rome pour porter dans les provinces la révolte contre les Autrichiens, contre le roi de Naples et contre Pie IX. Et j’ajoutai :
- Qui voudra me suivre sera reçu parmi les miens ; je ne demande à ceux-là qu’un cœur plein de l’amour de la patrie. Ils n’auront pas de solde, pas de repos ; ils auront du pain et de l’eau quand par hasard on en trouvera. Qui n’est pas content de ce sort reste ici. Une fois la porte de Rome franchie, tout pas fait en arrière sera un pas fait vers la mort. Quatre mille fantassins et cinq cents cavaliers se rangèrent autour de moi ; c’étaient les deux tiers de ce qui restait de défenseurs à Rome. Anita, habillée en homme, Ciceravacchio, qui ne voulait pas voir l’abaissement de son pays, et Ugo Bassi, le saint qui aspirait au martyre, furent des premiers à se ranger près de moi. Vers le soir, nous sortîmes par le chemin de Tivoli. Mon cœur était triste comme la mort. La dernière nouvelle que j’avais apprise était que Manara avait été tué... »
« Ici s’interrompent les Mémoires de Garibaldi. Un jour, j’obtiendrai de lui la seconde partie de sa vie, comme j’en ai obtenu la première. Celle-là se résumera en deux mots : Exil et triomphes. » A. DUMAS
Séance du 8 mars 1871 à l’Assemblée nationale et intervention de Victor Hugo
« M. LE PRÉSIDENT : J’aborde les élections partielles de chacun des trois départements de la colonie. 1er Département d’Alger. M. Gambetta a obtenu 12 423 voix ; le général Garibaldi 10 606. Le candidat qui vient en troisième ligne, M. Warnier, n’a obtenu que 4 973 voix. L’élection de M. Gambetta n’est ni contestée ni contestable. Il n’en est point de même de celle du général Garibaldi qui fait l’objet d’une protestation adressée le 19 février à M. le Président de l’Assemblée nationale par le docteur Warnier, et dont nous devons vous faire connaître les termes :
“Je demande à l’Assemblée nationale de déclarer le général Garibaldi inéligible, attendu qu’il n’est pas citoyen français. Par cette décision, je suis le second député du département d’Alger sans nouvelle élection.” Nous vous proposons donc de valider l’élection de M. Gambetta et de laisser au Gouvernement le soin qui lui incombe de pourvoir au remplacement du général Garibaldi par les voies ordinaires.
M. le Rapporteur propose l’annulation de l’élection du général Garibaldi.
Plusieurs voix : Mais non ! Mais non !
M. RICHIER : Garibaldi n’a pas le droit d’être élu et de faire partie d’une Assemblée française.
(Réclamations sur plusieurs bancs.)
M. VICTOR HUGO : Je demande la parole.
M. LE PRÉSIDENT : M. Victor Hugo a la parole.
(Mouvements divers)
M. VICTOR HUGO : Je ne dirai qu’un mot.
La France vient de traverser une épreuve terrible, d’où elle est sortie sanglante et vaincue. On peut être vaincu et rester grand ; la France le prouve. La France accablée, en présence des nations, a rencontré la lâcheté de l’Europe. (Mouvement)
De toutes les puissances européennes, aucune ne s’est levée pour défendre cette France qui, tant de fois, avait pris en main la cause de l’Europe… (Bravo ! à gauche), pas un roi, pas un État, personne ! Un seul homme excepté… (Sourires ironiques à droite. Très bien ! à gauche.)
Ah ! Les puissances, comme on dit, n’intervenaient pas ; eh bien, un homme est intervenu, et cet homme est une puissance. (Exclamations sur plusieurs bancs à droite.)
Cet homme, messieurs, qu’avait-il ? Son épée.
M. LE VICOMTE DE LORGERIL : Et Bordone ! (On rit.)
M. VICTOR HUGO : Son épée, et cette épée avait déjà délivré un peuple… (exclamations) et cette épée pouvait en sauver un autre. (Nouvelles exclamations.) Il l’a pensé ; il est venu, il a combattu.
À droite : Non ! Non !
M. LE VICOMTE DE LORGERIL : Ce sont des réclames qui ont été faites ; il n’a pas combattu.
M. VICTOR HUGO : Les interruptions ne m’empêcheront pas d’achever ma pensée. Il a combattu… (Nouvelles interruptions.)
Voix nombreuses à droite : Non ! Non !
À gauche : Si ! Si !
M. LE VICOMTE DE LORGERIL : Il a fait semblant !
Un membre à droite : Il n’a pas vaincu en tout cas !
M. VICTOR HUGO : Je ne veux blesser personne dans cette assemblée, mais je dirai qu’il est le seul des généraux qui ont lutté pour la France, le seul qui n’ait pas été vaincu.
(Bruyantes réclamations à droite. Applaudissements à gauche)
Plusieurs membres à droite : À l’ordre ! À l’ordre !
M. DE JOUVENCEL : Je prie M. le président d’inviter l’orateur à retirer une parole qui est antifrançaise.
M. LE VICOMTE DE LORGERIL : C’est un comparse de mélodrame. (Vives réclamations à gauche.) Il n’a pas été vaincu parce qu’il n’a pas combattu.
M. LE PRÉSIDENT : Monsieur de Lorgeril, veuillez garder le silence ; vous aurez la parole ensuite. Mais respectez la liberté de l’orateur (Très bien !)
M. LE ÉDUCROT : Je demande la parole.
(Mouvement)
M. LE PRÉSIDENT : Général, vous aurez la parole après M. Victor Hugo.
(Plusieurs membres se lèvent et interpellent vivement M. Victor Hugo)
M. LE PRÉSIDENT aux interrupteurs : La parole est à M. Victor Hugo seul.
M. RICHIER : Un Français ne peut pas entendre des paroles semblables à celles qui viennent d’être prononcées.
(Agitation générale)
M. LE VICOMTE DE LORGERIL : L’Assemblée refuse la parole à M. Victor Hugo, parce qu’il ne parle pas français.
(Oh ! oh ! Rumeurs confuses.)
M. LE PRÉSIDENT : Vous n’avez pas la parole, monsieur de Lorgeril… Vous l’aurez à votre tour.
M. LE VICOMTE DE LORGERIL : J’ai voulu dire que l’Assemblée ne veut pas écouter parce qu’elle n’entend pas ce français-là. (Bruits)
Un membre : C’est une insulte au pays.
M. LE GÉNÉRAL DUCROT : J’insiste pour demander la parole.
M. LE PRÉSIDENT : Vous aurez la parole si M. Victor Hugo y consent.
M. VICTOR HUGO : Je demande à finir.
Plusieurs membres à M. Victor Hugo : Expliquez-vous (Assez ! Assez ! )
M. LE PRÉSIDENT : Vous demandez à M. Victor Hugo de s’expliquer ; il va le faire. Veuillez l’écouter et garder le silence…
(Non ! non ! À l’ordre ! À l’ordre)
M. LE GÉNÉRAL DUCROT : On ne peut pas rester là-dessus.
M. VICTOR HUGO : Vous y resterez pourtant, général.
M. LE PRÉSIDENT : Vous aurez la parole après l’orateur.
M. LE GÉNÉRAL DUCROT : Je proteste contre des paroles qui sont un outrage. (À la tribune ! à la tribune !)
M. VICTOR HUGO : II est impossible. (Les cris : À l’ordre ! continuent)
Un membre : Retirez vos paroles. On ne vous les pardonne pas.
(Un autre membre à droite se lève et adresse des paroles qui se perdent dans le bruit.)
M. LE PRÉSIDENT : Veuillez vous asseoir !
Le même membre : À l’ordre ! Rappelez l’orateur à l’ordre !
M. LE PRÉSIDENT : Je vous rappellerai vous-même à l’ordre, si vous continuez à le troubler. (Très bien ! très bien !) Je rappellerai à l’ordre ceux qui empêcheront le président d’exercer sa fonction. Je suis le juge du rappel à l’ordre.
Sur plusieurs bancs à droite : Nous le demandons, le rappel à l’ordre.
M. LE PRÉSIDENT : Il ne suffit pas que vous le demandiez.
(Interpellations diverses et confuses.)
M. DE CHABAUD-LATOUR : Paris n’a pas été vaincu, il a été affamé.
(C’est vrai ! c’est vrai ! Assentiment général.)
M. LE PRÉSIDENT : Je donne la parole à M. Victor Hugo pour s’expliquer, et ceux qui l’interrompront seront rappelés à l’ordre.
(Très bien !)
M. VICTOR HUGO : Je vais vous satisfaire, messieurs, et aller plus loin que vous. (Profond silence.)
Il y a trois semaines, vous avez refusé d’entendre Garibaldi…
Un membre : Il avait donné sa démission.
M. VICTOR HUGO : Aujourd’hui vous refusez de m’entendre. Cela me suffit. Je donne ma démission. (Longues rumeurs. Non ! Non ! Applaudissements à gauche.)
Un membre : L’Assemblée n’accepte pas votre démission.
M. VICTOR HUGO : Je l’ai donnée et je la maintiens. »
LE SOUFISME
Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie
L'émir Abdel khader.,.....
Maurice Béjart,
.....Cat
Stevens,
......René Guénon,
.......Nusrat Fateh Ali Khan......
Tous ces personnages connus ont un point commun, certains deux, d'autres trois. Quels sont ces trois points ?
La Franc-maçonnerie, I'Islam et le Soufisme.
Emprunt, quelque peu, d'exotisme spirituel et animé dans ma curiosité de cherchant j'ai eu l'occasion de côtoyer des engagés dans la voie du soufisme et il
me tardait d'épancher cette soif de connaissance du sujet. Ma profession de chrétien s'en accommoderait-elle ?
Le dimanche 29/11/2015 je répondais à l'invitation d'une association Inter religieuse pour une conférence débat « à la découverte du soufisme » animés par
« une » membre d'une confrérie soufie et d'un musulman engagé dans le partage religieux des trois religions monothéistes, L'Islam, le Judaïsnme et le Christianisme. Fort de cette opportunité je
m'empressais d'aller m'informer sur une «e- cyclopédie» afin d'être au mieux par le ressenti de ce que nos interlocuteurs avaient envie de nous partager. Ainsi débarrassé de la part académique ou
l'intellect aurait pu s'engluer dans une compréhension de l'islam que je ne connais pas je pouvais ainsi espérer être à l'écoute du cœur. Dans mon état de persévérant j'atten dais des mots des sons
des sourires qui ont une saveur d'authentique pour vous conforter dans la voie que vous suivez ; celle qui nous rassemble ce soir.
Il est usage de dire, et toutes les présentations publiques le confirme, que le Soufisme est la branche ésotérique de l'Islam cependant les intervenants
ont choisis le terme de mystique par confort pour I'auditoire......ce qui n'est pas faux dans la mesure ou l'adepte peut entrer dans des expériencees mystiques, par son cheminement ou voyage, qui
sont susceptibles d'éveiller sa conscience et espérer parvenir, en final, à l'état de Sûfi... la signification étymologique de ce mot relève de plusieurs hypothèses phonétiques....safa
:clarté...al-souf :laine (vêtement des humbles)......Ahl a-soufa :les gens du banc(confrérie dans la mosquée du prophète).
Cette voie spirituelle se singularise par ce qui est décliné comme trinités des Soufis : 3 fois 3 points
Humilité, charité, sincérité, Islam (dogme), Iman (Foi), Ihsan (bienfaisance)....
Amour, crainte, connaissance du divin.
Ce qui amène les adeptes à entrer dans la Croyance, acquérir une Certitude et parvenir à la Voyance.
Détail important : I faut être musulman (en respect des 5 piliers de lIslam) avant d'être soufi....il est évoqué aussi que ce cheminement induit le fait
d'emprunter la voie du Milieu en étant détaché du monde mais dans ce monde.......pour la petite et la grande histoire le Prophète a eu une révélation Soufie.
Le point d'ancrage reste, évidemment, le Coran structuré en 114 surates et 7 doctrines.......Cette voie qualifiée de sacrée invite à une perception d'un
Dieu révélé qui conduit à l'homme Réalisé. Celui-ci passera par des stations en pratiquant des rites qui impliquent le désir de Dieu....à ce titre les rites sont inutiles s'ils ne sont pas accomplis
avec sincérité.
La notion d'amour, dans le soufisme, tient une place centrale de l'enseignement l'iman Al-Ghazali, un des maîtres de cette tradition, précise ainsi : « aimer Dieu est
P'ultime but des stations spirituelles et le plus haut sommet des rangs de noblesse. Il n'est de station au-delà de celle de l'amour qui n'en soit un fruit ou un corollaire».....il sera aisé de
comprendre l'importance de l'invocation, la poésie, le chant la danse....c'est pour cela que le soufisme se manifeste et est connu publiquement par la création artistique......a chute de l'homme sur
terre et sa réintégration divine apparait dans I'enseignement.
Comment prétendre atteindre I'état se Sûfi ?
II faut d'abord être musulman.....puis suivre la voie d'un maître soufi ; le guide spirituel et demander à entrer dans une Confrérie qui s'y
rattache.....apparu peu après la mort du Prophète le soufisme est présent dans l'ensemble du monde musulman et représente maintenant 400 confréries. Les plus nombreuses sont les Aissawa et
Alévites. Le monde occidental connait surtout cette voie spirituelle par les Derviches. La persécution a existée et existe encore à leur encontre car le soufisme est un courant initiatique et
ésotérique qui doit mener une réalisation complète, une vision au-delà du dogme celle qui mène à la liberté, la Conscience dégagée des aspérités du monde matériel et opérante pour le bien-être de
l'humanité.
Ceci restera une présentation succincte en regard de la richesse du sujet mais le propos est de m'interroger en tant de chrétien et franc-maçon sur le
travail spirituel dans la forme pour parvenir à un but......un accomplissement.
C'est donc par ce titre extrait de Jean que j'ai choisi d'intervenir pour présenter ce propos. Cet apôtre, n'est' il pas qualifié de bien-aimé..........et frère, de surcroit ? ! il marquera son
empreinte dans le Nouveau Testament par
P'Apocalypse (du grec Apocalyptos qui veut dire révélation) avec un fort apport symbolique, numérologique et des passages évangéliques denses et courts qui marquent I'intensité du Verbe.....nous
comprendrons la similitude entre être adepte d' une confrérie soufie avec ,en mire, le réalisation en tant que
Sûfi et prendre le chemin du disciple de Jésus pour se fusionner avec le Christ.....le caractère ésotérique de la franc-maçonnerie s'appuie sur la Bible et s'inspire d'autres enseignements
traditionnels dans la méthode à appliquer pour ses étudiants ; leurs progressions se qualifient par les grades tandis qu'il est parlé, dans la voie du soufisme, de stations cela veut dire qu'il n'y
pas de raccourci dans l'approche et la recherche de la Connaissance dans lI'un et l'autre parcours.
L'approche du rite écossais rectifié, d'emblé, affiche le but d'une âme incarnée sur terre animée par l'esprit que P'on souhaite le plus saint possible à
l'aspirant de Vraie
Lumière. En cela nous rejoignons le soufisme et la Kabala du judaisme qui présente comme la loi cachée alors que la Torah la loi publique ; le Tohou Bohou ,la brisure primordiale et la destinée de
l'homme sur notre planète, son désir de retrouver l'état initial (Louis de Saint-
Martin) et comment le réintégrer (Martinez de Pasqually) ...ce qui nous retrouvons par la Genèse dans la chute adamique par un constat......en cela, donc le RER peut se suffir à lui-même par
l'ouverture de la Conscience mais en
P'exigence de sa pratique pour emmener les frères sur le
Chemin , accéder à la Vérité, chérir et entretenir la
Vie....sous toutes ses formes pour la sauvegarde de la « maison commune» comme le proclame le pape François.
Il apporte, cependant, un éclairage supplémentaire aux fidèles d'une église chrétienne par la qualité de légrégore entretenue par la sincérité des frères.
<tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta volonté », « aime ton prochain ,comme toi- même»....il n'y a pas de plus hauts
commandements que ces deux-là précise notre guide.
« un maçon libre dans une loge libre ! » ce slogan m'a toujours habité pour assoir mes attentes dans notre Fraternité parce que la liberté n'est pas
acquise elle se gagne et à tout moment on se peut se libérer de la structure tout en comprenant que « le travail d'un maçon ne s'arrête jamais et qu'il est de son devoir de répandre à
I'entour la lumière entrevue dans une Loge de Saint-Jean » (auteur:Fx).....et pour un maçon du Rite Ecossais
Rectifié.... Disciple du Christ avec reconnaissance de la personne de Jésus désigné comme prophète par les musulmans et Jesouah le Christ Cosmique dans la tradition juive.
Le travail en Loge amène le frère à habiter le spirituel et le matériel par effets miroir en acceptant la différence de l'autre comme enrichissement pour
son âme....le plus grand dénominateur commun étant le rituel.
Disciple du Christ à vocation de devenir :« Prête,
Prophète et Roi » en ajoutant que le religieux voit en un prophète celui « qui annonce, dénonce et renonce ».
Le Soufisme a occasionné, pour moi, ce travail et me permet de terminer pour le Souffrant évoqué pour nos frères apprentis.....ainsi éclairé sur le chemin de notre incarnation la souffrance, ne
serait' elle pas le mal; maladie= mal à die ;clin d'eil phonétique....c'est à dire, en somme, la résistance en face du désir de l'âme humaine d'être, de nouveau, relié avec son Dieu....disons
Grand
Architecte de l'Univers pour les maçons......qui donc résiste ?
Tout cet exposé n'en engage que son auteur.
Mon travail n'est démonstratif ni académique mais me revoie constamment à « pourquoi nous nous sommes fait maçon ?» et je ne cesse de me rappeler que nous sommes héritiers d'une tradition issue de la
Sagesse Immémoriale qui épouse les formes pour les circonstances de l'humanité.
Cette même sagesse transmise d'abord oralement puis par des mots tout aussi nécessiteux de porter le
Verbe......Alors je conclurais pour laisser la Parole à :
A nous de jouer : « le XXI siècle sera spirituel ou ne sera pas ».
André Malraux Tout un programme : « Si vous faites quelque chose, faites le par amour sinon ne
faites rien » Raoul
Follereau Faut 'il le nommer ?: « Qui aime connais Dieu»
Ignace de Loyola.
En quoi la Maçonnerie va participer à la fondation du monde nouveau et comment le cœur du maçon s'accomoderra à battre en de nouvelles mesures face aux
oscillations effrénées d'une civilisation en quête de sens et de ceux qui ont peur du changement.
LE MONOTHEISME EST-IL UN PROGRES
VERSION AFFIRMATIVE
Il m’est demandé ce midi de vous exposer les raisons pour lesquelles le Monotheisme est un progrès.
I. Dans un premier temps, il convient de définir les deux notions afin de conforter notre position = monothesime source de progrès.
Le monothéisme est la croyance en l'existence d'un seul Dieu, en opposition au polythéisme qui admet l'existence de plusieurs divinités. Les religions monothéistes mettent l'accent sur l'unité et l'unicité de Dieu. Les trois principales religions monothéistes étant le judaïsme, le christianisme et l'islam.
Le judaïsme est la plus ancienne des trois grandes religions monothéistes. Les Juifs croient en un Dieu unique, Yahvé, et suivent les enseignements de la Torah, le texte sacré du judaïsme.
Les chrétiens croient en un Dieu unique, mais leur conception de la divinité est trinitaire, ce qui signifie qu'ils reconnaissent la Sainte Trinité composée du Père, du Fils (Jésus-Christ) et du Saint-Esprit. La Bible est le texte sacré du christianisme.
Les musulmans professent la foi en un Dieu unique, qu'ils appellent Allah en arabe. Le Coran est le livre saint de l'islam, révélé au prophète Muhammad par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Les cinq piliers de l'islam guident la vie religieuse et quotidienne des musulmans.
S’agissant de la notion de progrès,
C’est un concept qui désigne généralement l'avancement, l'amélioration ou le développement dans différents domaines de la vie humaine. Il peut être lié à des avancées technologiques, scientifiques, économiques, sociaux, culturels, ou encore à des améliorations dans le bien-être et la qualité de vie. Le progrès implique souvent un mouvement vers l'avant, une évolution positive, et il est souvent associé à la recherche de solutions innovantes pour résoudre des problèmes ou améliorer les conditions de vie.
En résumé, le progrès est un concept complexe qui englobe divers aspects d'amélioration et d'avancement dans la société humaine.
Tout d’abord, il est important de montrer que le monothéisme est un véritable socle moral.
Le monotheisme, qui est la croyance en l'existence d'un seul Dieu, a souvent été considéré comme un socle moral dans de nombreuses cultures et religions à travers l'histoire. Ces traditions religieuses, que sont le judaïsme, le christianisme ou l’Islam, enseignent des systèmes moraux et éthiques basés sur la croyance en un Dieu unique.
Dans le monotheisme, la moralité est absolue et dérive de la volonté divine. Les lois morales sont perçues comme étant établies par Dieu lui-même, ce qui fourni une base solide pour un système moral.
La croyance en un Dieu unique crée un sens de responsabilité envers cet Être suprême. Les adeptes sont souvent motivés à suivre des principes moraux afin de s'aligner sur la volonté divine et de gagner la faveur de Dieu.
Le monotheisme fournit également une base solide pour une conception objective de la morale, puisque la source de la moralité est perçue comme extérieure et transcendante par rapport aux individus et aux cultures.
Il est important de rappeler que les enseignements religieux monothéistes comprennent souvent des directives sur la façon dont les individus devraient interagir les uns avec les autres. Cela engendre des principes de justice, de compassion, et d'amour envers les autres, formant ainsi une base pour l'éthique sociale.
Les traditions monothéistes mettent fréquemment l'accent sur les conséquences morales de nos actions, non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'au-delà. Cette perspective peut influencer les choix moraux des individus en tenant compte des répercussions éternelles.
S’agissant du rôle du monothéisme dans l'établissement de normes morales
Les religions monothéistes, telles que le judaïsme, le christianisme et l'islam, enseignent souvent que Dieu a établi des normes morales immuables. Les commandements divins, tels que les Dix Commandements dans le judaïsme et le christianisme, sont considérés comme des principes moraux fondamentaux. Ces normes sont perçues comme absolues et non négociables, fournissant une base stable pour la conduite éthique.
Le monothéisme propose souvent l'idée d'une responsabilité ultime envers Dieu. Les croyants sont encouragés à vivre selon des normes morales spécifiques en raison de leur engagement envers la divinité. La croyance en une vie après la mort, où les individus rendent compte de leurs actions, peut également influencer le comportement moral des croyants.
Dans les traditions monothéistes, la morale est souvent étroitement liée à la religion. Les lois religieuses et les normes morales sont intégrées, formant un système éthique global. Cela peut contribuer à une cohérence et à une uniformité dans la compréhension de ce qui est considéré comme moralement juste ou faux.
Le monothéisme a joué un rôle important dans la formation des normes morales en fournissant des cadres éthiques, des principes et des incitations basées sur la croyance en une autorité divine.
Concernant l’impact du monothésime sur la cohésion sociale et la stabilité
L'impact du monothéisme sur la cohésion sociale et la stabilité peut varier en fonction du contexte historique, culturel et géographique.
Le monothéisme, en mettant l'accent sur la croyance en un seul Dieu, peut contribuer à renforcer le sentiment d'unité au sein d'une communauté. Les croyants partagent une base commune de valeurs et de croyances, ce qui peut favoriser la cohésion sociale.
Les systèmes religieux mono-théistes souvent promeuvent un ensemble de normes morales et éthiques communes. Ces valeurs partagées peuvent servir de base pour la formation d'une société stable, en encourageant le respect des lois, des droits de l'homme et des principes éthiques.
Les institutions religieuses dans les sociétés monothéistes peuvent jouer un rôle régulateur en influençant les comportements sociaux. Cela peut contribuer à la stabilité en fournissant un cadre moral et éthique.
L'impact du monothéisme sur la cohésion sociale peut également dépendre de la manière dont les interprétations religieuses évoluent avec le temps. Certaines sociétés peuvent évoluer vers une interprétation plus inclusive de leur foi, favorisant ainsi la diversité et l'harmonie sociales.
Concernant le monothéisme et la pensée rationnelle
Le lien entre le monotheïsme et le développement de la pensée rationnelle a été exploré et débattu par de nombreux penseurs et historiens. Bien que ce ne soit pas une relation directe et uniforme, certains arguments suggèrent que le monotheïsme a pu contribuer à favoriser le développement de la pensée rationnelle dans certaines sociétés.
Voici quelques points de discussion sur ce sujet :
Dans les traditions monothéistes, Dieu est souvent présenté comme un être unique et ordonnateur de l'univers. Cette vision peut encourager la recherche d'ordre et de compréhension logique dans le monde naturel. Les croyants peuvent être incités à chercher des lois et des modèles compréhensibles derrière les phénomènes naturels, ce qui peut favoriser le développement de la pensée rationnelle.
Certains penseurs religieux monothéistes ont souligné l'importance de la raison dans la compréhension de la foi. L'idée que la foi ne devrait pas être contraire à la raison a pu encourager le développement d'une pensée rationnelle. Par exemple, la théologie scholastique médiévale a cherché à harmoniser la foi chrétienne avec la philosophie aristotélicienne, mettant en avant la logique et la rationalité.
Le monotheïsme a souvent été associé à des systèmes éthiques qui mettent l'accent sur la responsabilité individuelle. Dans ce contexte, la pensée rationnelle peut être considérée comme un moyen d'exercer cette responsabilité, en prenant des décisions éclairées et en comprenant les conséquences de ses actions.
Voici quelques exemples historiques de progrès intellectuel sous l'influence du monothéisme
Le monothéisme, la croyance en un seul Dieu, a eu une influence significative sur le développement intellectuel et culturel de nombreuses sociétés à travers l'histoire. Voici quelques exemples de progrès intellectuels liés au monothéisme :
Au cours de l'Antiquité, la Grèce a connu une période de grande effervescence intellectuelle. Certains philosophes grecs, tels que Platon et Aristote, ont été influencés par les idées monothéistes présentes dans le judaïsme. Par exemple, les notions de divinité unique et de moralité ont trouvé leur place dans la pensée philosophique grecque.
Au Moyen Âge, sous l'influence du christianisme, de nombreuses universités européennes ont été fondées. Ces institutions ont joué un rôle crucial dans la préservation et le développement des connaissances, de la philosophie et des sciences. Les écoles monastiques et les universités catholiques ont participé à la conservation des manuscrits anciens et à la transmission des savoirs.
La Renaissance et la période post-médiévale ont vu émerger la révolution scientifique en Europe. Des penseurs tels que Copernic, Galilée et Newton, qui ont apporté des avancées significatives dans les domaines de l'astronomie et de la physique, ont souvent été profondément influencés par leur foi monothéiste. L'idée d'un univers ordonné par un créateur unique a motivé ces scientifiques à explorer les lois de la nature.
Les penseurs théologiques dans les traditions juive, chrétienne et musulmane ont contribué au développement de la métaphysique, cherchant à comprendre la nature de Dieu, de l'âme et de l'univers. Les œuvres de penseurs tels qu'Avicenne (Ibn Sina) dans l'islam et Thomas d'Aquin dans le christianisme témoignent de l'interaction entre la foi monothéiste et la réflexion philosophique.
Les enseignements moraux et éthiques des religions monothéistes ont contribué à la formation des systèmes éthiques dans la philosophie et la théologie. Des principes tels que la justice, la compassion et la responsabilité sociale, issus des traditions religieuses, ont influencé la réflexion éthique au fil du temps.
S’agissant de la contribution du monothésime au progrès matériel et scientifique
Il est important de noter que le progrès matériel et scientifique est souvent le résultat de divers facteurs, y compris la culture, la société, l'économie, et bien sûr, la vision du monde dominante. Le monothéisme, en tant que système de croyance en un seul Dieu, a eu une influence significative sur le développement de la pensée et de la société dans différentes civilisations.
Le monothéisme, en particulier dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, a souvent encouragé la recherche de la connaissance et de la compréhension du monde. La croyance en un Dieu unique et rationnel a souvent conduit à l'idée que le monde est ordonné de manière logique et peut être compris par la raison humaine.
Les traditions monothéistes ont souvent mis l'accent sur l'éducation et l'acquisition de connaissances. Les institutions éducatives, telles que les écoles et les universités, ont souvent été soutenues par des communautés religieuses.
Bien que l'on puisse arguer que certaines époques de l'histoire ont vu des périodes de tension entre la religion et la science, de nombreux scientifiques ont également été des croyants monothéistes. Ils ont vu la recherche scientifique comme un moyen de comprendre les merveilles de la création divine.
Les enseignements moraux issus du monotheisme ont joué un rôle dans la formation des normes éthiques de nombreuses sociétés. Ces valeurs morales ont parfois favorisé le progrès social et technologique en encourageant des comportements coopératifs et éthiques.
Les principes moraux du monotheisme ont souvent motivé des actions philanthropiques et des initiatives sociales visant à améliorer la vie des communautés. Les institutions caritatives, les hôpitaux, et d'autres initiatives sociales ont été inspirés par des convictions religieuses.
Pour ce qui est des relations entre monothéisme et développement des sciences
La relation entre le monothéisme et le développement des sciences a été un sujet de débat au fil de l'histoire. Il est important de noter que l'influence des croyances religieuses sur le développement des sciences est complexe et peut varier en fonction du contexte historique, culturel et géographique. Voici quelques points à considérer :
Le monothéisme, en particulier le judaïsme, le christianisme et l'islam, a encouragé une vision du monde qui valorise l'exploration intellectuelle et la compréhension du cosmos. L'idée d'un Dieu créateur peut avoir inspiré la curiosité humaine pour comprendre les lois de la nature.
Dans certaines périodes de l'histoire, les institutions religieuses ont joué un rôle clé dans l'éducation et le soutien aux savants. Les centres d'études religieuses étaient souvent aussi des centres de connaissances scientifiques.
L'idée d'un univers ordonné par un Dieu unique peut avoir contribué à la conviction que ce monde pouvait être compris par le biais de l'observation, de l'expérimentation et de la raison.
Il est essentiel de noter que toutes les sociétés monothéistes n'ont pas eu le même impact sur le développement des sciences.
j’ai dit…
La Chute de l’empire romain
Aujourd’hui, le fracas des armes, la violence des rapports humains et l’émergence de nouvelles croyances viennent mettre à mal nos repères culturels comme sociétaux.
S’appuyant en grande partie sur les réalités géopolitiques et économiques résultant de la seconde guerre mondiale, nos certitudes assises sur nos connaissances et nos acquis, semblent vaciller.
Perturbés en permanence par notre comparaison entre l’environnement actuel et celui de notre enfance, assaillis par des systèmes dits d’information où la rumeur appelée « fake news » est omniprésente et heurtés par la vulgarité qui inonde l’espace médiatique, notre esprit réagit, nous avons l’impression de tituber, KO debout.
Tel Diogène, dans la rue, nous cherchons un homme à qui nous raccrocher mais ne voyons autour de nous que des zombies, vissés à des minuscules écrans qui, étouffant leurs angoisses existentielles, vident en permanence leurs cerveaux rétrécis pour déverser ce qu’il en reste dans le Métavers ou s’adonner a un énième achat compulsif.
S’agitant en permanence comme des fourmis après une attaque de leur habitat, bloqués dans des rues où la circulation a été réorganisée pour des flux de martiens inexistants, nos semblables nous renvoient l’image de nous-même où derrière l’incompréhension qui nous saisit, l’angoisse existentielle incontrôlable nous envahit.
Nous avons l’impression que notre univers quotidien s’écroule par grands pans et nous ne voyons rien à l’horizon se profiler. Au contraire, les solutions présentées par ceux qui veulent mettre à bas notre « vieux monde » semblent puiser leur justification dans des dogmes produits par l’obscurantisme et la bêtise. Et dans tout cela, le fracas des armes se met retentir.
« Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres »[i].
Indépendamment des convictions politiques de son auteur qui restent discutables, cette phrase de Gramsci est troublante d’actualité.
Face à ces interrogations, si nous regardons en arrière, la période de l’histoire qui pourrait être la plus similaire à la nôtre ne serait-elle pas celle de la décadence de l’Empire Romain ?
Pouvons-nous en analyser les raisons ; ces dernières pourraient-elles être riches en enseignement ?
Les premières recherches sur cette page de notre histoire débouchent sur deux constats :
- Il existe une immense diversité d’opinions sur les possibles causes de la décadence et la chute de l’Empire Romain ; nombreuses sont sujettes à controverses et aujourd’hui encore, de nouvelles thèses apparaissent, s’appuyant sur des recherches scientifiques récentes.
- Ce foisonnement est confirmé par le nombre démesuré d’ouvrages écrits depuis des siècles sur le sujet.
Devant cette profusion, et compte-tenu du temps qui m’était imparti, j’avais décidé d’appuyer mon travail sur le choix d’un ouvrage qui en constituerait le fil conducteur guidant mon raisonnement et évitant les égarements.
À l’origine, j’avais choisi les œuvres de Rollin[ii] avec ses tomes sur Rome et les Empereurs mais très rapidement je m’aperçus que son analyse était certes remarquable, mais orientée vers des sujets d’ordre théologique ou scientifique qui me semblent plus d’actualité.
Un ouvrage s’imposa alors de lui-même, Grandeur et Décadence de l’Empire Romain de Montesquieu[iii]. Il est intéressant de noter qu’à l’origine ces considérations devaient constituer un chapitre, une première partie introductive de l’Esprit des lois. L’ampleur du sujet et le temps qu’il y consacra finirent par l’entrainer à produire une œuvre séparée. Également impressionné par l’importance du sujet et sa valeur d’exemple, il n’abandonna jamais ce travail et intégra ses réflexions sur Rome dans toutes ses œuvres.
Jusqu’au début du siècle dernier, cet ouvrage était considéré comme majeur et étudié tant au lycée qu’à l’université au même titre que les Lettres persanes ou l’Esprit des Lois.
Dans ses Réflexions, Montesquieu a une approche assez chronologique, retenant les faits marquants et les personnages importants pour décrire les mécanismes participant à la construction de Rome puis, après son apogée, contribuant à sa perte.
La Rome antique démarre en 756 avant JC et se termine en l’an 476. Entre Romulus, fondateur de Rome et Romulus Augustule, son dernier empereur, c’est plus de 1200 ans durant lesquels plus de 8o rois ou dictateurs et 175 empereurs portèrent tour à tour sa destinée à son apogée ou à sa perte[iv].
Devant cette profusion de gouvernants, pour structurer ma démarche, j’ai plutôt recherché dans les Considérations de Montesquieu, les éléments politiques ou sociaux les plus significatifs en retenant ceux pourraient être considérés comme des piliers sur lesquels Rome s’est bâti, puis ensuite, se sont écroulés les uns après les autres, entrainant sa chute.
La famille Gens structure la société romaine de manière clanique. Les plus puissantes (Claudia, Julia. .... ) descendent des dieux. Le Pater familia en est le chef. Elles tirent leurs revenus des terres qui sont gérées collectivement sous l’autorité de conseils de famille. L’épouse Matrona y occupe une place centrale comme d’ailleurs la femme dans le reste de la société romaine, qu’elle soit vestale, hétaïre ou proche du pouvoir.
Au sein des familles, la vie religieuse est omniprésente avec la vénération des dieux lares. Les dieux sont nombreux ; le romain choisit ceux qu’il souhaite consulter par les auspices. Il les écoute et entretient une relation « contractuelle » avec eux. Il vénère en particulier Fides déesse garante de sa fidélité envers Rome : Fides Populi romani. Le clergé a un rôle d’intermédiaire. Ses membres, les flamines sont choisis dans les riches familles patriciennes.
Ces dernières constituent une véritable caste ayant tous les privilèges. Elles siègent au Sénat et fournissent les postes dans la magistrature. Les promagistrats sont entre autres les questeurs et les collecteurs des impôts, les questeurs Urbani. Les patriciens peuvent aussi être nommés consuls ou proconsuls, ils dirigent les armées. Rassemblés en comices « curiates, centuriates », ils distribuent les titres, les fonctions et détiennent le Magistratus cum Império droit de paix et de guerre. Dans toutes leurs instances ou fonctions, ils sont secondés par les magistrats ordinaires, les tribuns, issus le plus souvent de castes inférieures ou de la plèbe. Ces dernières deviendront rapidement les pourvoyeurs des fonctionnaires au service de Rome.
Constitués des plébéiens, les Comices tributes Concilium Plebis, discutent des projets de lois et les proposent au sénat. Senatus censet, popules jubet le Sénat vote, le peuple commande. Cependant, en cas de litige ou d’appel Provocatio, avec quelconque instance du pouvoir, la décision suprême revient aux patriciens.
Cette organisation, qui est certes plus complexe, constitue la Res publica. Elle lie tous les romains entre eux autour de leur raison d’être commune : Rome.
À l’origine, Rome est une ville « sans commerce et presque sans arts, le pillage était le seul moyen que les particuliers eussent de s’enrichir »[v]
Le butin pris aux vaincus est redistribué de façon équitable entre la cité, les principales familles et les combattants. Les retours des vainqueurs chargés des dépouilles des vaincus donnent lieu à des événements festifs de grande ampleur, tout en contribuant au développement économique de la cité et de ses habitants, Triumphus les triomphes.
Ils permettent de présenter le butin aux romains et mettent en valeur le général vainqueur Imperator. Ce dernier, le visage peint en rouge, immole ensuite les vaincus promis aux dieux. C’est le seul moment où les soldats ont le droit de traverser le Poemerium, espace sacré entourant Rome. En revanche, au passage de leur chef suivi du Sénat, ils ont obligation de se moquer de lui en chantant des chansons grossières et satiriques pour contrebalancer les éloges qui lui sont adressés.
Pour s’assurer que le butin ne soit pas confisqué au profit de quelques-uns, des règles encadrant sa distribution sont instaurées. La première concernée par ces obligations est l’armée. Ces codes conduisent à l’instauration de la discipline, du sens d’autrui et de la collectivité mais aussi, participent au développement de la confiance en soi et au courage pour tous.
Notons au passage que si les chefs ont comme obligation d’assurer la victoire, ils doivent toujours avoir conscience que leur pouvoir appartient au peuple représenté par le Sénat et les comices. Leur nomination à la tête des troupes est parfois de très courte durée. À leur issue, ils doivent se représenter devant le Sénat. Mais lentement les militaires vont étendre leurs pouvoirs dans tous les domaines qu’ils soient législatifs, administratifs ou financiers.
Le maintien d’une croissance stable et harmonieuse de la cité implique sans cesse de nouvelles conquêtes
La guerre est devenue d’utilité publique pour le Peuple et indispensable à ses dirigeants pour conserver leurs statuts. Tout citoyen doit y participer d’une manière ou d’une autre.
La guerre est perpétuelle et la paix n’est que le fait du vainqueur. Elle est considérée comme une période préparant la guerre ou permettant sa seule issue, la victoire. Rome ne fait jamais la paix de bonne foi. On peut raisonnablement en déduire que la maxime Civis pacem para bellum n’est qu’une partie de la pensée des romains face à la guerre.
La connaissance parfaite de l’art militaire est l’axe principal des efforts de Rome. Recherchant toujours la victoire, elle ne recule jamais devant aucun stratagème pour l’assurer ; mensonges, traités rompus, corruption, versement de tribut, politique de terreur ... sont utilisés tout au long de son histoire avec toujours comme justification de ses actes Vae Victis [vi] Malheur aux vaincus, sentence que Rome avait faite sienne.
« Les Romains considérant la guerre comme son seul art, ils mirent toutes leurs pensées et leur esprit à le perfectionner ». Les armées sont organisées en légions, 4200 puis 6000 hommes rassemblés autour de l’étendard Acquila l’Aigle. Les soldats sont des citoyens romains. Lourdement armés, leurs armes et équipements sont leurs propriétés. Ils sont secondés par des soldats moins armés, à l’origine des citoyens plus pauvres. À l’arrière se tiennent les vétérans qui constituent « la réserve de fer ».
La présence des soldats dans l’armée varie en fonction des époques. Elle peut durer de 16 à 20 ans. Il en est de même pour celle des gardes prétoriens. Après les victoires ou de retour à Rome, lorsqu’ils sont « démobilisés » ou après des actes de bravoure, les vétérans sont récompensés par le don d’un lopin de terre. Par la suite, durant l’empire, des terres des colonies voire des pays alliés pourront également leur être distribuée. Ainsi, leur présence sur tout l’empire assure une forme de dissuasion et également si nécessaire une capacité de réserve.
Les fantassins comme les grecs combattent en phalanges. Ils sont appuyés par des cavaliers, les équites qui seront ensuite recrutés chez des alliés démontrant que les romains au contraire des grecs, ont toujours su analyser leurs faiblesses et les raisons de leurs défaites. Ils en tirent des enseignements leur permettant d’inventer de nouvelles armes et de nouvelles stratégies. S’ils les jugent performantes, ils les font leurs. C’est ce qui leur a permis de combattre les éléphants[vii], se doter d’une marine ou assiéger des villes.
Pour les Romains, l’oisiveté est mère de tous les vices surtout dans l’armée où elle est proscrite.
Les soldats sont en permanence soumis à des exercices physiques éprouvants et des manœuvres en nombre sur le Champ de Mars[viii]. S’ils ne s’entraînent pas, ils font des travaux divers et perfectionnent leur armement. Ils construisent des machines de guerre, des camps et des lignes de fortifications pour être en sécurité et, des routes pour se déplacer au plus vite dans tous les territoires. Ces voies facilitent également le commerce.
Cet état de guerre permanent et la suprématie de ses armées conduisent à l’extension des terres romaines. Tout d’abord l’Italie est soumise puis le pourtour méditerranéen. Rome étend enfin son pouvoir au Moyen-Orient, aux bords du Danube, du Rhin et à la lointaine Ecosse. Tous les territoires sont transformés en provinces. La première est la Sicile en 243 av. JC. Elles sont dirigées par des gouverneurs qui dupliquent l’organisation romaine et y perçoivent l’impôt. Ils aménagent les territoires (construction de routes et d’aqueducs) et peuvent même rendre la justice au nom de Rome. Les provinces sont divisées en cités qui s’administrent elles-mêmes avec des magistrats élus reprenant la devise grecque « L’homme est libre comme le gouvernement de la cité ».
Il en est de même pour les royaumes comme l’Égypte ou la Syrie qui peuvent en plus conserver leurs administrations ou leurs rois en devenant des pays alliés.
Bientôt, pour contrôler cette immense superficie de terres si disparates, le Sénat accepte de considérer Octave comme Princeps premier citoyen : poste occupé avant par un sénateur. Il lui octroie L’imperium maius, c’est-à-dire l’autorité sur tous les gouverneurs et la Tribunicia potestas, tribune de la plèbe ; le pouvoir de convoquer une assemblée du peuple pour promulguer des lois. Il a un droit de veto sur toutes les décisions de magistrats.
Devenu Auguste, ce despote éclairé instaure l’empire dans lequel il assure la sécurité des hommes et des institutions. Grâce au commerce et à la réorganisation de l’impôt, tous les territoires retrouvent la paix et la prospérité. L’économie est solide car nombre de travaux manuels pénibles, dans les mines comme dans les champs sont effectués par des esclaves qui constituent 1/3 de la population. La Pax Augusta remplace la Pax Romana plus brutale. Elle s’installe pour 200 ans.
D’Auguste à la mort de Théodose, c’est un moment unique dans l’histoire, où un très grand bassin méditerranéen de l’Euphrate à la Bretagne Orbis Romana aura un seul pouvoir central.
Comment ce monde construit sur un mélange fructueux de force, de vertu, d’intelligence et d’organisation a-t-il pu s’effondrer ?
Comme certains le prétendent, Rome a-t-elle été détruite par des agressions extérieures dont les principales seraient celles provoquées par les barbares et le christianisme ?
En fait, comme le souligne Montesquieu « une civilisation n’est détruite du dehors sans être ruinée elle-même ». Hormis les empires comme ceux d’Amérique latine qui n’avaient ni la taille, ni de forces militaires et économiques suffisantes pour résister à des agresseurs nettement plus puissants qu’eux, l’essence même des empires est sa capacité à vaincre les agressions.
Cependant, c’est quand un empire cesse de comprendre sa raison d’être, de connaitre les fondements et défendre son existence même qu’il commence à se détruire. C’est de ses propres mains qu’il s’anéantit.
Ce sont alors toutes ses fondations qui sont attaqués et qui l’une après l’autre ou simultanément cèdent entrainant dans leurs chutes celles qui résistaient encore.
Rien n’échappe à cette lente destruction et même les qualités dont Rome avait dû faire preuve pour sa construction « mutent » et se retournent contre elle.
La folie des conquérants, c’est de vouloir imposer à tous les peuples vaincus ses lois et ses coutumes. Cela est possible que lorsque les peuples conquis sont très faibles car ils sont anéantis ou réduits.
Hormis au début de leur histoire pour leurs proches voisins, les Sabins, les Volsques, les Eques, ..., par pragmatisme ou par discernement, les romains n’ont jamais mis en œuvre cette politique. L’exemple le plus parlant est leur absorption de la Grèce. Non seulement ils ne la détruisent pas mais avec elle, ils s’initient aux arts, à la science, apprennent l’organisation de la cité et enfin, s’approprie une part importante de sa religion.
Ils ont fait de même avec toutes les civilisations anciennes qu’ils ont découvertes. De ce fait, tout le bassin méditerranéen romain a été tour à tour nourri et policé par les étrusques, les minoens, les assyro babyloniens, les égyptiens mais aussi influencé par les perses archaïques voire les indous. Ils réunissent tous ces savoirs, toutes ces identités ou ces cultures dans une entité unique avec Rome comme centre de gravité.
Toutes ses populations font corps et deviennent romaines.
Mais si l’hellénisme trouvait sa consécration dans la cité, son organisation ne répondait pas à celle nécessaire à un empire. Alexandre en avait fait la cruelle expérience.
Les romains restent insensibles au monde de la science et à ses facultés créatrices. Avec les arts et la philosophie grecque qui les séduisent, ils découvrent l’esthétique et le culte du plaisir. Ils les installent dans la culture romaine.
Le stoïcisme et surtout l’épicurisme promeut alors l’individu, le détournant du Capitole et de l’idée même de la patrie romaine et de ses vertus sur lesquelles elle s’était construite. Lentement l’intérêt particulier remplace le sens commun, la cupidité l’austérité, la compromission le courage.
L’équilibre instable de la répartition des pouvoirs, qui tenait grâce à la force dirigée par la vertu, n’existe plus.
L’aristocratie croit alors de façon maladive en s’accaparant toutes les dignités, la magistrature et le pouvoir. Elle capte tous les honneurs et surtout toutes les richesses.
Devant cette situation, les plébéiens se mettent à refuser leurs conditions. Pour éviter des révoltes et conserver leurs avantages, les patriciens acceptent alors leurs demandes et la société tout entière s’en trouve transformée. Lentement les plébéiens retirent nombre de leurs prérogatives aux patriciens en premier à commencer par celles de la magistrature.
Mais ce faisant, les plébéiens deviennent aussi une caste, se coupent du peuple, lui confisquent son pouvoir originel en devenant censeurs ou questeurs. Tour à tour, les centuries et les comices disparaissent. Les tribuns deviennent des fonctionnaires et l’appareil d’état s’installe partout. Sous Constantin, ce « mammouth » se veut omnipotent et souhaite tout réglementer. Devant cette tâche impossible, il succombe à sa charge et ne tient plus que par la corruption qu’il essaime dans tout l’empire.
Face à tous ces dangers et perdant nombre de leurs pouvoirs, les patriciens se transforme en nobles. Ils quittent Rome pour se réfugier sur leurs terres ; les latifundia qu’ils ont créés en dépossédant les paysans citoyens. Ils profitent sans limites de tous les plaisirs qu’ils découvrent et font administrer leurs biens et leurs esclaves par des serviteurs souvent corrompus. Ils créent une économie fermée construite pour produire des richesses totalement opposées aux intérêts de Rome. Le courage, la sagesse, la justice et le sens de la patrie leur devient totalement étrangers.
Puis le machine s’emballe, le colonat évolue vers le servage et l’effroyable fiscalité du bas empire tue le commerce et ruine l’agriculture. Il en résulte une baisse constante de la population.
Cette décroissance tant économique que démographique devient endémique et ne peut que déboucher sur la ruine de l’Empire. À la fin de l’Empire, la population de la ville de Rome a été divisée par plus de 20.
Pour le peuple, la pauvreté n’est plus une vertu. La perte de ses derniers organes de pouvoirs et la chute de ses conditions le fait se révolter.
La Pax romana se transforme en Pax societa. Le peuple est acheté par la distribution du blé et la tenue des jeux dans des amphithéâtres de plus en plus grands Panem et circences. Le Colisée est construit comme un symbole de la puissance romaine mais il est en vérité le symbole de la perte des valeurs qui ont construit cette puissance.
Ayant perdu leurs raisons d’être, les empereurs comme Néron, Caracalla, Caligula partagent alors les mêmes sources de plaisir que celles du peuple. Ils les asservissent et ce faisant, provoquent la désagrégation des familles, de l’état et détruisent leur fonction, leur image autrefois divine.
La mort des gladiateurs remplace le théâtre grec, le Colisée remplace l’Olympe, Néron remplace Sophocle.
Néron détruit la beauté de la poésie. Le poète Claudien l’achève avec ses persiflages satiriques contre les puissants. Depuis longtemps, Virgile a disparu entrainant avec lui les fondements de l’existence de Rome.
Le sang des arènes rend le peuple romain féroce. La raison essentielle de la dureté initiale qui avait participé à la création de Rome est dévoyée. Seule ne reste que la cruauté avec sa fascination, le sadisme bref le mal !
Tantum religio potuit suadere malorum. « Seule la religion peut éloigner le mal ». Lucrèce
Durant ses conquêtes, pour ne pas ostraciser les autres peuples, comme pour les dieux grecs, Rome avait souvent pris comme siens des dieux étrangers citons Osiris. Il avait également toléré toutes les autres religions sous réserve que leurs pratiquants reconnaissent son autorité suprême et ne souhaitent pas mettre à bas les dieux Latins. De ce fait, beaucoup de Romains, présents en Orient furent ouverts à ces dernières et s’adonnèrent à certaines de leurs croyances en particulier celle du culte de Mithra.
La religion quitte le Capitole pour rechercher les auspices d’autres dieux plus lointains.
Au fur et à mesure que la situation dans l’empire s’aggrave, que les hommes grecs comme les romains ne font plus leurs humanités, n’étudient plus, ils ne trouvent plus réponses à leur raison d’être. Des questions existentielles apparaissent.
Cette prise de conscience de la réalité de la douleur humaine par le plus grand nombre, loi même de la vie, ne trouve plus aucun écho chez les dieux romains et même pas chez les demi-dieux, les héros censés être plus proches des hommes. ....
Alors, les religions à mystère se mettent à combler ce vide.
Mais ces religions étrangères sont souvent transformées à leur profit par les puissants, parfois même totalement caricaturées comme celle du culte Sol Invictus par Héliogabale.
A terme, qu’elles soient syriennes ou autres, ces religions refuges ne donnent pas plus réponses que les religions gréco-romaines aux insuffisances existentielles et à la nouvelle quête de sens des romains.
Alors, apparait la religion chrétienne qui enseigne que « l’angoisse métaphysique est la dignité de l’être pensant ». La foi en un dieu unique est proclamée, le dogme se substitue au contrat.... C’est le début de cette lente transformation qui verra, quelques siècles plus tard, le Christ souffrant du triptyque de Grünewald prendre la place du Zeus triomphant. Le vaincu remplace le vainqueur.
Simultanément, la transcendance de l’évangile dépasse les races et le temps, le romain devient un chrétien parmi tant d’autres, l’image de Rome éternelle s’estompe au profit de celle du paradis qui n’est plus terrestre !
A la même époque, l’empereur Dioclétien divise l’empire et met à mal toute l’Italie par ses impôts affaiblissant définitivement Rome. Constantin termine cette œuvre funeste en se déplaçant à Constantinople et en embrassant la religion chrétienne.
Mais ces lents changements n’ont pas empêché l’empire romain de s’étendre et de conduire en permanence, les guerres nécessaires à son maintien. Jusqu’à César et Marius, Rome arrivait à les faire victorieusement et à repousser les assauts des envahisseurs aux frontières ou mater les rébellions internes avec ses propres moyens. Dans l’empire, cela devient rapidement plus problématique. Sans l’appui des légions de plus en plus nombreuses, Rome ne peut plus résister aux assauts en particulier à la pression germanique à ses frontières Ouest. Dès lors, les besoins en hommes stationnés longtemps dans les endroits les plus reculés de l‘Empire augmentent en permanence.
Loin de chez eux, les soldats romains perdent leurs esprits de citoyens et se reconnaissent plus en leurs généraux qu’en Rome. Pour s’assurer de leur fidélité, ces derniers les achètent à des coûts sans cesse grandissant, seul moyen de conserver leurs places. Cette inflation participe aussi à la paupérisation des finances de l’Empire.
Octave disait « Je crains les soldats, pas les tribuns ! ».
Sûrs de leur puissance, des généraux n’ont pas hésité à franchir le Rubicon, César le premier, puis Octave qui devient Auguste. Lorsque que le pouvoir de l’empire d’Occident s’est affaibli, des soldats nés dans les colonies deviennent empereurs. Certains comme Trajan seront de grands Empereurs, mais pour la majorité, ce fut plus chaotique avec même une période où trois voire quatre empereurs régnaient en même temps. Il est à noter que lorsque le chaos s’installe, la populace en devient la seule force et des empereurs apparaissent au gré des factions ou des événements tel Claude, homme pleutre choisi par hasard pour son insignifiance par la foule et des soldats qui ont envahi le sénat.
« Lorsque Rome est corrompu par les tribuns, le sénat peut se défendre mais quand la populace applaudit une formidable autorité issue de l’extérieur, la république est perdue » Montesquieu. Considérations. chapitre ix.
Avec Auguste disparaissent les triomphes : le chef perd le peuple au profit de ses armées. De plus, le triomphe avait pour but de continuer la guerre, sa disparition débouche sur la recherche de la paix. Alors, les victoires se mettent à faire peur aux nantis qui préfèrent les tractations avec leurs adversaires aux retours des armées triomphantes dans Rome.
« Les guerriers disparaissent au profit des bourgeois »
Pour pallier les refus des patriciens d’occuper leurs postes dans l’armée ou dans les hautes fonctions de l’état, les plébéiens sont aux affaires. Mais ils finissent eux aussi par s’enrichir, rechercher la tranquillité et cultiver la paresse. Rome vit alors les affranchissements de plus en plus nombreux et l’ensemble de l’appareil occupé par des étrangers ou des hommes non formés, ni compétents.
Cependant, ce mouvement ne fut pas rectiligne et à toutes les époques, il y eut des tentatives pour ralentir voire en stopper le funeste processus.
Auguste s’y essaye, Hadrien ou Marc-Aurèle s’y consacrent. Jusqu’au bout des présences héroïques apparaissent comme celle de Julien défenseur de Strasbourg mais au fur et à mesure que la maîtrise des pouvoirs échappe à Rome, le phénomène de désagrégation s’amplifie et la chute est irréversible.
Des cours se forment autour des empereurs les enfermant dans des mondes hors de toute réalité. On verra même des cours composées d’eunuques !
Les barbares ne sont plus combattus, leur paix est grassement achetée. Pire, lorsque des rebellions internes ou de guerres civiles éclatent, Rome leur demande souvent d’intervenir.
Des victoires comme celle des vandales en Afrique du Nord ont également des conséquences économiques qui amplifient la chute. Elles déstabilisent le commerce, plus particulièrement celui du blé entrainant des pénuries, des hausses d’impôts et des révoltes.
Alors, le citoyen romain ne croit plus en Rome, on s’inféode au pouvoir local, qu’importe son origine.
Mais Il y a pire que le barbare aux frontières, il y a le barbare dans la cité.
Après la disparition des petits paysans, pour faire face à la dépopulation des campagnes, assurer des bras dans l’agriculture et fournir en quantité des colons dans toutes les provinces frontières, des masses innombrables d’émigrants, de prisonniers et d’esclaves affranchis sont déplacés dans tout l’empire.
Cette transformation touche toute la société même les armées qui sont dorénavant majoritairement constituées de soldats pris chez les vaincus, en particulier chez les germains.
Tous les niveaux de la société sont concernés, des domestiques aux empereurs et ceci, dans l’0rient comme dans l’Occident....
Simultanément, Rome a transformé les hordes en peuples, en nations. Ces dernières réunies autour de leur chef, qu’elles soient stationnées dans l’Empire ou à ses frontières n’ont aucun lien culturel avec Rome dont ils ne partagent ni la langue, ni la religion et ni la culture.
Lorsque les huns envahissent l’est de l’Europe, poussant devant eux les goths, les digues des limes cèdent et les grandes invasions traversent tout l’empire bientôt coupé en deux avec un empire d’occident et un empire d’orient.
Tous ces sinistres entrainent la paralysie des systèmes administratifs, de l’autorité des provinces et des cités. Les grand domaines latifundia s’organisent en conséquence et se mettent à vivre économiquement de façon totalement indépendante de l’état.
Nombre d’édifices représentatifs de la puissance romaine sont détruits. Ils ne sont plus reconstruits les temples disparaissent, les huttes remplacent les villas. Les vêtements changent, la toge n’existe plus, .... Les plauses en métal remplacent les pierres précieuses serties d’or. En Orient, l’art géométrique sassanide se substitue aux statues des déesses.
D’autres phénomènes dont certains étudiés plus récemment viennent se rajouter à ceux décrits précédemment : Ils sont climatiques avec des épisodes de canicule et de sécheresse. Ceci est vérifié par les récentes études sur la calotte glaciaire. Également des épidémies comme celle de la peste antonine, en vérité la variole ou d’autres plus endémiques comme la malaria frappent les populations. Si elles ne suffisent pas à détruire l’empire, elles y contribuent grandement comme une plaie sur un corps malade.
Déjà en 285 après JC, l’Empire s’est séparé en deux pour se défendre au mieux contre les menaces extérieures. En 476, l’empereur Romulus Auguste est déposé par Odocacre, hérule (Ukrainien) allié des Huns, mercenaire de l’empire puis roi goth. Depuis longtemps Rome a été abandonné, l’évènement a lieu à Ravenne. L’empire d’Occident a vécu. Il est alors découpé en nombreux territoires principalement occupés par les wisigoths.
Le Génie de Rome était d’ordre intellectuel fait de solidité juridique autoritaire alliée à une universalité doctrinale.
La barbarie balaie sa civilisation. Pour illustration, la vestale ou Agrippine devient la germaine que l’on prend, la femme que l’on féconde puis plus tard la religieuse que l’on cloître.
Les monastères se mettent à apparaitre remédiant en place de l’état, à la misère des peuples.
Il faudra 300 ans pour que réapparaissent une réelle culture et une puissance politique inspirée par Rome. Durant cette période d’obscurité, seule la discipline catholique canalisera l’anarchie et organisera tant faire que peut, les équilibres au sein et entre les nouveaux territoires de feu l’Empire romain.
Pour conclure, puis-je prétendre que les descriptions de ces phénomènes conduisant à la chute de l’empire romain m’éclairent sur le devenir de notre société ?
Je ne l’affirmerai pas, en revanche, nous pouvons constater la troublante similitude de ces causes qui ont conduit à sa décadence avec les phénomènes qui viennent agresser actuellement notre civilisation occidentale.
Pour éviter une issue similaire, poursuivre ce travail semble impératif sauf si nous préférons consulter les auspices !
[i] Gramsci : Éclats d’une poétique de l’inaccompli.
[ii] Charles Rollin - Histoire romaine depuis la fondation de Rome jusqu'à la bataille d'Actium suivi de L'histoire des empereurs par Crevier 1742.
[iii] Charles de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu – Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. 1734.
[iv] Durée moyenne au pouvoir 2 ans
[v] Considération &1
[vi] Voir Brennus – Chef gaulois qui occupa Rome en -390 Av. JC
[vii] Guerre contre Pyrrhus. Guerres puniques
[viii] A Rome, au bord du Tibre où les soldats apprennent aussi à nager.
LE MONOTHÉISME EST-IL UN PROGRÈS ?
Septembre 23
Année 391 de notre ère :
L'action se passe à Alexandrie, deuxième ville de l’Empire Romain ; La bibliothèque d’Alexandrie, qui conserve l'héritage philosophique de la Grèce depuis les Ptolémées, est le phare de la pensée antique. Elle est une université au rayonnement universel à l’apogée de l’Empire, au deuxième siècle de notre ère, sous Hadrien et jusqu’à Marc Aurèle.
A cette époque la paix règne dans le plus vaste Empire que le Monde ait jamais connu. Rome, ville de plus d’un million d’habitants, fournit à chacun d’eux deux mètres cube d’eau par jour. Son système de canalisations ne se retrouvera à une même échelle qu’à la fin du 19eme siècle. « La civilisation c’est l’eau » dira l’historien de Rome, Pierre Grimal.
Dans leur célèbre parodie : la vie de Brian, Les Monty Pyton résument bien ce que fut l'Empire dans une scène de leur film :
Des conspirateurs juifs se réunissent pour concevoir un plan pour enlever Ponce Pilate le procurateur de Judée.
Le chef exhorte sa petite troupe. Il pose une question : « Les romains nous ont saigné à blanc, ils nous ont tout pris. Que nous ont-ils donné en retour ? » Et dans le fond de la pièce un petit conspirateur ose timidement une réponse : « l’aqueduc ? » puis un autre : « le système sanitaire ? »
Oui d’accord dit le chef agacé.
Un autre encore : « et les routes ».
« Bon, l’aqueduc, le système sanitaire et les routes, mais c’est tout. »
Un quatrième intervient : « si, l’irrigation et la médecine » ; un cinquième : « l’éducation » ; un autre encore : « le vin » (et tous conviennent que ça, c'est sûr, il faudra le garder)
Ils poursuivent : « la sécurité dans les rues le soir… l’ordre ». Hors de lui le chef de la bande récapitule : « Bon d’accord, mais à part l’aqueduc, le système sanitaire, les routes, l'irrigation, la médecine, l’éducation, la sécurité, qu’est-ce que les Romains ont fait pour nous ? » Et le plus minable des conspirateurs de conclure à la fin : « euh…la paix »
C’était cela l’empire Romain. Globalement tout ce dont nous disposons aujourd'hui. La justice, le commerce, l'industrie, la banque, les transports, le courrier, les arts : tout ce qui fait la vie des hommes en société civilisée.
Puis commence le déclin, la déliquescence de Rome. L'Empire n’est pas menacé par des puissances rivales qui voudraient son anéantissement. Non pas ! Il est menacé par tous ceux qui en dehors de ses frontières veulent à tout prix les traverser pour s’intégrer dans son Monde et jouir de la co-prospérité de tous les peuples qui le composent. On voit bien aujourd'hui que l’histoire pourrait se répéter.
Alors vint Constantin, sa Victoire du Pont Milvius sur un de ses adversaire et la promulgation de l'édit de Milan (313) :
Création de Constantinople / Division de l’empire à Orient et à l’Occident / mise à égalité du culte chrétien avec les autres cultes. Dorénavant les chrétiens ne seront plus victimes de discriminations, leur culte est autorisé et les biens qui leur ont été confisqués leur sont rendus. Rappelons que les persécutions contre les chrétiens n’eurent qu’une seule cause : leur fanatisme ; leur refus de cohabiter dans l’Empire avec les autres cultes alors que les Romains n’avaient cure des croyances de chacun pour peu qu’ils soient fidèles à Rome.
La progressive conversion de Constantin au christianisme s'accompagne d'une politique impériale favorable aux chrétiens ; mais le paganisme n'est pas encore persécuté car, pour l'empereur, l'unité de l'empire prime sur toute autre considération. La bibliothèque d’Alexandrie subsiste. Mais les tensions croissantes entre le pouvoir impérial romain et l'influence religieuse et politique grandissante des chrétiens suscitent des affrontements qui se sont traduits, par exemple, par l'Édit de l’Evêque Théodose, sorte de fatwa ordonnant, entre autres, la destruction des temples païens.
Le temps passe encore. Alexandrie abrite une population multiconfessionnelle ; la cohabitation s'avère de plus en plus difficile. Face aux Juifs et aux païens "Hellènes" : les partisans de Jésus, manœuvrés par l'évêque Cyrille, qui comptent bien se rendre maîtres de la place.
Nous sommes en 391. Un historien de cette époque raconte : « Il y avait dans Alexandrie une femme nommée Hypatie, fille du Philosophe Théon, directeur la Bibliothèque. Elle avait fait un si grand progrès dans les sciences qu'elle surpassait tous les Philosophes de son temps, et enseignait dans l'école d’Epictète, un nombre presque infini de personnes, qui accouraient en foule pour l'écouter. La réputation que sa capacité lui avait acquise, lui donnait la liberté de paraître souvent devant les Magistrats de la Cité, ce qu'elle faisait toujours, sans perdre la pudeur, ni la modestie, qui lui attiraient le respect de tout le monde. Sa vertu, toute élevée qu'elle était, ne se trouva pas au-dessus de l'envie »
Hypatie enseigne la philosophie, elle a le verbe haut mais la grâce l'habite ; tous les témoignages convergent lorsqu'il s'agit d'évoquer sa grande beauté. On a coutume de la représenter au milieu d'un cénacle, le cercle de ses fidèles qui, avec elle, refusent de voir les dieux s'exiler pour céder la place aux religions de l'intolérance.
La pensée et l’enseignement d’Hypatie, je l’évoquerai plus tard ; Mais il vous faut connaitre son intuition dans le domaine de l’astronomie pour comprendre ce que fut cette femme :
Elle enseignait les travaux de l'astronome et mathématicien Aristarque de Samos qui avait évalué le diamètre du soleil. Celui-ci émet au IIIe siècle av. J.-C. l'hypothèse que, puisque le diamètre du soleil est beaucoup plus important que celui de la Terre, c'est autour de lui que normalement doivent tourner les astres. Mais sa théorie héliocentrique se heurte à l’observation des saisons et de la durée des jours qui ne permettent pas de déduire que la terre puisse tourner autour du soleil si sa course est en cercle, comme on le présumait. Hypatie est la première, par ses mesures mathématiques, à avoir imaginé que l’ellipse fut la forme de la course de la Terre autour du Soleil. Il faudra attendre Copernic et Galilée pour le comprendre, mille ans plus tard.
L’historien poursuit : « Mais parce qu'elle avait amitié particulière avec Oreste, Préfet d’Egypte, elle fut accusée d'empêcher qu'il ne se réconciliât avec l’Evêque Cyrille »
En cette année 391, Hypatie est assassinée par les hommes de mains de Cyrille, les Parabalani, membres d'une confrérie chrétienne ayant fonction de fossoyeurs d'Alexandrie. Des Talibans en somme.
Suite du récit : « l'ayant tirée de sa chaise, ils la menèrent sur l’hôtel de leur église, la mirent à nue et la tuèrent à coups de tessons. Après cela ils hachèrent son corps en pièces, les exhibèrent dans les rues et les brûlèrent dans un lieu appelé Cinaron. » On dirait Daesh !
Après quoi la horde sauvage et la foule de gueux déchainée détruisirent la bibliothèque, brisèrent ses statues et brulèrent les œuvres littéraires, trésors philosophiques, qu’elle contenait.
Sénèque l’avait dit en son temps : «La preuve du pire : c’est la foule.»
Saint Cyrille est le Abou Bakr al-Baghdadi de l’époque. Patriarche d'Alexandrie, Cyrille s'attache à éradiquer le paganisme, le judaïsme et ce qu'il considère comme des hérésies chrétiennes : il fait fermer les synagogues. Ces mesures brutales l'opposent à Oreste, préfet d'Égypte (chrétien lui aussi), et sont l'occasion de pogroms et autres scènes sanglantes. Il anéantit ainsi la communauté juive et s'en prend de la même manière aux autres communautés chrétiennes qualifiées d'hérétiques. Ainsi, Cyrille attaque les positions de Nestorius, un autre évêque de grande renommée, et l’accuse « d’adoptianisme », doctrine vers laquelle la chrétienté aurait pu s’orienter qui conçoit Jésus-Christ comme un homme que Dieu aurait adopté.
Pour Saint Cyrille, au contraire Jésus-Christ, Fils unique de Dieu a été engendré du Père avant tous les temps pour ce qui concerne la divinité, et, pour ce qui concerne son humanité, il est né d’une Vierge à la fin des temps pour nous et notre salut ; Cyrille est Docteur de l’Eglise. Il est vénéré par les catholiques et les orthodoxes.
Pour comprendre tout cela vous devez voir Agora, Film espagnol à grand spectacle d’Alejandro Amenábar sorti en 2009 avec l’acteur Michael Lonsdale dans le rôle de Théon, père d’Hypatie. Vous pouvez lire aussi Michel Onfray qui décrit la mort d'Hypatie comme l'acte de décès symbolique de la culture classique de l'antiquité.
Les sciences, les moeurs, les arts vont rapidement régresser dans l'Empire qui bientôt disparaîtra sous les poussées barbares qui en voulant s'y agglomérer le feront imploser. Les acqueducs à Romme bientôt ne seront plus entretenus. La ville d’un million d’âmes n’en comptera bientôt plus de vingt mille.
La mort d'Hypatie met en perspective tout ce qu'il nous en a coûté à nous autres européens de devenir monothéistes : c'est à dire mille ans de terrorisme théocratique : du V EME au XV EME siècle.
L'épisode de la mort d'Hypatie est un révélateur de toutes les tendances contenues dans le monothéisme des religions du Livre, celle d'Abraham, de Jésus et de Mahomet. Vous y voyez la violence, l'intolérance, la haine de la femme et de la sexualité.
Le monothéisme est violent et intolérant
Le monothéisme est prosélyte par nature - si Dieu est unique, il convient d'en imposer la croyance à tous les hommes - les monothéismes sont naturellement portés aux guerres de religion, à la conversion forcée.
On voyait mal en Grèce que les partisans d'Athéna fassent la guerre aux partisans de Mercure, ou encore qu'aux Indes les fidèles de Ganesh dieu a tête l'éléphant massacrent les zélateurs de Vishnou, déesse aux bras multiples.
Mais quand dieu est unique il se bat avec tout le Monde.
Les juifs persécutent les disciples de Jésus qui en retour les massacrent entre deux pogroms de cathares ou d’autres hérétiques orthodoxes ou protestants. Mais tous conviennent à la fin de liquider les juifs.
Dans son inénarrable « Théologie portative » le philosophe d'Holbach pouvait écrire au siècle des lumières à propos des croisades :
« Expéditions saintes, ordonnées par les papes, pour débarrasser l’Europe d’une foule de vauriens dévots, qui pour obtenir du ciel la rémission des crimes qu’ils avaient commis chez eux, s’en allaient bravement commettre de nouveaux chez les autres »
Aujourd'hui c'est pour l'islam qu'on tue.
Holbach disait ceci :
« Mahométisme : Religion sanguinaire dont l’odieux fondateur voulut que sa loi fût établie par le fer et par le feu ; on sent la différence de cette religion de sang et de celle du Christ qui ne prêcha que la douceur, et dont en conséquence le clergé établit ses saints dogmes par le fer et par le feu. »
Le monothéisme hait la femme
On a connu de fortes personnalités de femmes sous l'Antiquité Romaine. Qui peut dire que Livie, femme d'Auguste, Messaline qui faisait des concours de débauche, les deux Agrippines ou les impératrices régentes Julia Domna ou Julia Maesa ne furent pas des femmes d'autorité qui dominèrent leur siècle. La matrone Romaine ne s'en laisse pas compter. Elle domine le ménage et il faut filer doux.
C'est que chez les Grec et les Romains les divinités se partagent entre les deux sexes. Aphrodite, Artémise, Athéna, Déméter, Gaïa ou Perséphone, pour ne citer que les plus connues, s'affrontent aux dieux mâles qui souvent cèdent le pas face à elles.
Les monothéistes au contraire, ceux des trois religions, la femme, ils la veulent brisée, à terre, plus bas que terre quand ce n'est pas brûlée vive lorsqu'elle relève la tête.
Dans l'ancien Testament des Juifs on leur attribue le premier péché (Genèse) Elles font partie des meubles : « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartienne » Ce sont des séductrices qu'il convient d'éviter ! « Et j'ai trouvé plus amère que la mort : la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens ; celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. » On se demande bien pourquoi, tant il est vrai que jusqu’au 6ème siècle, elle n’a officiellement pas d’âme.
Dans le Nouveau Testament des chrétiens : « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » La femme est l'objet honteux du désir.
Quant au Coran, mieux vaut se taire.
Le monothéisme hait le sexe et au-delà déteste le plaisir. Là où les religions polythéistes se réjouissent des fruits de ce monde et appellent à en user avec modération, les monothéismes sont tentés par une forme particulière de nihilisme qui consiste à tout miser sur le pari risqué de la survie, dans un au-delà, de ce qu'ils appellent l'âme.
On pourrait le croire vertueux mais... Le monothéisme n'a pas aboli l'esclavage
Ce sont les Lumières qui l'ont aboli. La très sainte Russie sera la dernière à le pratiquer, après les pieux
évangélistes américains.
« Jésus Christ fut le dernier chrétien » disait Nietzsche
Le monothéisme n'a pas aboli la superstition
Ceux qui connaissent bien l'Italie la savent païenne au fond. On comprend vite qu’en Italie la religion sert avant tout à conjurer les mauvais sorts du destin. Les saints ont remplacé les Dieux. Ils sont même spécialisés On les appelle les saints auxiliateurs :
Si vous êtes vierge et cherchez un époux : priez Sainte Barbe.
Si vous avez des maux de gorge : priez Saint Blaise
Pour vos voyages, voyez Saint Christophe
Pour régler les discordes, consultez Saint Eustache
Pour votre grossesse, voyez Sainte Marguerite
Et si vous êtes épileptique, dansez avec Saint Guy.
Le monothéisme est un rétrécissement de la pensée.
Flaubert a dit ceci de l'Empire Romain des deux premiers siècles de notre ère :
« Les Dieux n'étant plus et le Christ n'étant pas encore, il y a eu, de Cicéron à Marc Aurèle, un moment unique où l'homme seul a été. »
Avant qu’il ne soit établit (par le fer et par le feu de l’inquisition ou de Daesh) que l’homme est fait à l’image de Dieu qui nous aime même si parfois il nous éprouve pour mieux nous accueillir dans son froid paradis, avant cette fable que la science des hommes ne peut plus accepter, on raisonnait à Rome ou à Alexandrie.
Ce qu’Hypatie enseignât là-bas, est la philosophie d’Epicure (340 avant JC) et celle d’Epictète (stoïcien 50 après JC)
Pas celle de Socrate, Platon, ou Aristote, ces philosophes presque maudits par leurs contemporains que seule la chrétienté rendit à postériori célèbres parce qu’ils n’étaient pas incompatibles à son dogme.
Non les philosophes matérialistes, épicuriens, hédonistes ou stoïcs , qui eux seuls sont l’âme de la philosophie grecque. Et pour bien comprendre celle-ci mieux vaut lire les philosophes latins dont le style est moins archaïque.
Voici ce qu’enseignait Hypatie :
MARC AURELE
Philosophe / Empereur de Rome (la carte de visite est sublime !)
(121-180) Pensées pour moi-même.
« Forte natus sumus in mundo qui non curat. Nous sommes nés par hasard dans un monde qui s’en moque.
Qui a vu ce qui est dans le présent a tout vu, et tout ce qui a été de toute éternité et tout ce qui sera dans l'infini du temps.
Tu as subsisté comme partie du Tout. Tu disparaîtras dans ce qui t'a produit, ou plutôt, tu seras repris, par transformation, dans sa raison génératrice.
La mort est la cessation des représentations qui nous viennent des sens, des impulsions qui nous meuvent comme avec des cordons, du mouvement de la pensée et du service de la chair.
Tout est éphémère, et le fait de se souvenir, et l'objet dont on se souvient.
Tout ce qui arrive est aussi habituel et prévu que la rose au printemps et les fruits en été; il en est ainsi de la maladie, de la mort, de la calomnie, des embûches et de tout ce qui réjouit ou afflige les sots.
Celui qui craint la mort, craint de n'avoir plus aucun sentiment, ou d'éprouver d'autres sentiments. Mais, s'il n'y a plus aucun sentiment, tu ne sentiras aucun mal. Et si tu acquiers d'autres sentiments, tu seras un être différent, et tu n'auras pas cessé de vivre.
Bientôt tu auras tout oublié, bientôt tous t'auront oublié. »
SENEQUE
Philosophe / Administrateur de l’Empire
(4 avant JC - 65 après JC) Lettres à Lucilius
« Personne n’a jamais su qu’il était mort.
L'heure qui vous a donné la vie l'a déjà diminuée
Le plus grand obstacle à la vie est l'attente, qui espère demain et néglige aujourd'hui.
Ma patrie est le monde.
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. »
Albert Camus prolongera cette pensée :
« A cet instant subtil où l'homme se retourne sur sa vie, Sisyphe, revenant vers son rocher, contemple cette suite d'actions sans lien qui devient son destin, créé par lui, uni sous le regard de sa mémoire et bientôt scellé par sa mort. Ainsi, persuadé de l'origine tout humaine de tout ce qui est humain, aveugle qui désire voir et qui sait que la nuit n'a pas de fin, il est toujours en marche. Le rocher roule encore. Je laisse Sisyphe au bas de la montagne ! On retrouve toujours son fardeau. Mais Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui nie les dieux et soulève les rochers. Lui aussi juge que tout est bien. Cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile ni fertile. Chacun des grains de cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nuit, à lui seul, forme un monde. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux » Le Mythe de Sisyphe, Gallimard, 1942.
Pour finir écoutons le Marquis de Sade dans sa Philosophie dans le boudoir :
« Cessons de croire que la religion puisse être utile à l'homme. Ayons de bonnes lois, et nous saurons nous passer de religion. Mais il en faut une au peuple, assure-t-on ; elle l'amuse, elle le contient. À la bonne heure !
Donnez-nous donc, en ce cas, celle qui convient à des hommes libres. Rendez nous les dieux du paganisme. Nous adorerons volontiers Jupiter, Hercule ou Pallas ; mais nous ne voulons plus du fabuleux auteur d'un univers qui se meut lui-même ; nous ne voulons plus d'un dieu sans étendue et qui pourtant remplit tout de son immensité, d'un dieu tout-puissant et qui n'exécute jamais ce qu'il désire, d'un être souverainement bon et qui ne fait que des mécontents, d'un être ami de l'ordre et dans le gouvernement duquel tout est en désordre.
Non, nous ne voulons plus d'un dieu qui dérange la nature, qui est le père de la confusion, qui meut l'homme au moment où l'homme se livre à des horreurs ; un tel dieu nous fait frémir d'indignation, et nous le reléguons pour jamais dans l'oubli, d'où l'infâme Robespierre a voulu le sortir. »
[Illustration : Les Romains de la Décadence par Thomas Couture - Musée d'Orsay]
Vérité et Civilisation
F.P. – Juin 2023
L’approche de la vérité par les gens, ainsi que l’idée qu’ils se font de la civilisation, m’ont toujours interpellé, intrigué, surpris, pour ne pas dire stupéfait.
Par les « gens », je veux dire aussi bien les « penseurs » et les « dirigeants » que le commun des mortels. D’ailleurs, les plus sages, raisonnables ou lucides ne sont pas nécessairement ceux à qui l’on pense a priori.
Ces interrogations sont d’autant plus aiguës à l’heure actuelle que nous semblons vivre aussi bien une crise de civilisation qu’un dérèglement de l'entendement humain.
Que dire quand une responsable politique très haut placée d’une superpuissance parle sans sourciller de « vérité alternative » ? Quand un relativisme outrancier tend à se généraliser sous toutes ses formes, en particulier morale et épistémique ? Quand progresse dans la société à vive allure le biais anachronique et donc l’anachronisme éthique sans que l’absurdité de la chose n’effleure tant soit peu l’esprit de ceux qui la pratiquent ?
Et que dire quand « il y a, pour la première fois que je me souvienne dans la vie, un consensus en Occident sur le fait que quelque chose ne va pas. Il est désormais possible de parler ouvertement de déclin [de la civilisation occidentale] sans être moqué.[1] »
« Quand le passé n’éclaire plus l’avenir, l’esprit marche dans les ténèbres » disait Tocqueville. Remontons donc le cours de l'histoire.
Même si nous hésitons à déterminer le « moment exact du déclin ou de l'effondrement romain, nous devons admettre que les civilisations d'Europe occidentale et de la Méditerranée ont à un moment ou à un autre cessé d'être romaines. Cela a bien été le cas, que nous favorisions l'idée de transformation et d'évolution, ou celle de déclin et d'effondrement catastrophiques. Quoi qu'il en soit, des traits autrefois romains ont été appropriés et assimilés par de nouveaux peuples inconnus du monde antique. »
« Cela devrait nous rassurer sur le fait qu'une civilisation de longue durée se transformant progressivement au cours de plusieurs siècles, traversant de nombreux troubles avant un effondrement définitif et laissant des traces d'elle-même signifie que la civilisation en général, bien que fragile, peut être restaurée.[2] »
Mais qu'est-ce que la civilisation ?
Le grand historien d’art Kenneth Clark commence sa série documentaire télévisée en treize parties de ”Civilisation: A Personal View” diffusée en 1969 par la question « Qu'est-ce que la civilisation ? », pour admettre de manière désarmante qu'il ne peut la définir en « termes abstraits », mais peut la reconnaître quand il la voit. Il me semble néanmoins que nous pouvons avoir une idée de ce que c'est en examinant au moins ses résultats, à défaut de ses causes.
De l’avis de Michael Bonner, « la civilisation produit trois résultats principaux, qui apparaissent ensemble pour la première fois dans la culture matérielle de l'Ancien Empire égyptien ».
« Le premier est un sentiment de clarté, exprimant l'idée que le monde est un tout cohérent que les êtres humains peuvent percevoir et comprendre. Il donne lieu à l'utilisation du langage pour décrire le monde et notre expérience de celui-ci, et devient visible dans la présentation élégante des hiéroglyphes dans lesquels les mots et les idées ont été enregistrés pendant des milliers d'années. »
« Le second est un sens de la beauté, exprimé avec une rigueur apparemment mathématique dans les proportions harmonieuses de l'art et de l'architecture égyptiens. »
« Le troisième est un sens de l'ordre. Il est fondé sur la croyance qu'il existe un principe d'organisation du monde dans lequel toutes les choses animées et inanimées ont leur place et leur but. Nous pouvons le voir dans la représentation sympathique de la nature et dans les symboles de l'autorité politique et religieuse.[3] »
Clarté, beauté et ordre apparaissent ensemble peut-être pour la première fois en Égypte, mais sont partout et toujours les principaux résultats de la civilisation.
« L'effondrement de l'URSS en 1991 a semblé laisser place à une nouvelle ère de paix et de stabilité. L'ambiance de l'époque est capturée dans l'incompréhension quasi universelle de la thèse de Francis Fukuyama sur la "fin de l'histoire", ainsi que dans le dessin animé Aladdin de Disney. Aladdin et Fukuyama nous ont tous deux invités à imaginer "un tout nouveau monde", et tous les deux l'ont fait en 1992. »
« Mais l'histoire n'a pas pris fin. Et désormais, le déclinisme ne semble plus impensable. Ces derniers temps, l'Occident semble avoir vacillé d'une crise à l'autre : guerre et humiliation au Moyen-Orient, échec à exporter la démocratie libérale à l'étranger, effondrement financier, terrorisme et, dernièrement, pandémie, problèmes de chaîne d'approvisionnement, reprise de la guerre en Europe, etc. Des livres et des articles contenant des mots comme "déclin", "destin", "désordre" et "fin du monde" ont commencé à apparaître, prédisant une catastrophe.[4] »
Mais le danger vient très souvent de l’intérieur, et ce que nous constatons de l’évolution actuelle des société occidentales devrait nous inquiéter.
Les Lumières, qui ont placé les droits individuels comme socle moral et politique d’une société civilisée, n’ont probablement pas prévu qu’une fois réalisé, leur projet puisse dégénérer en l’apparition accélérée d’égocentristes effrénés, rejetant toute objectivité et même toute intersubjectivité, celles-ci présentant l’inexcusable défaut d’être à l’extérieur du périmètre de leurs glorieux nombrils.
Dans une interview à une télévision australienne, après avoir rappelé la citation apocryphe de Voltaire disant « Je désapprouve ce que vous dites, mais je défendrai jusqu'à la mort votre droit de le dire », John Cleese résume parfaitement bien le fléau du wokisme : « Ce que j'ai trouvé avec la plupart des personnes woke, c'est qu'elles ne débattront pas ou ne discuteront pas de leurs idées, parce que si elles le font, elles pourraient donner une certaine validité à l'idée que l'autre côté a des choses intéressantes à dire, et je pense que [cette attitude] est assez totalitaire.[5] »
Cette irrationalité galopante et le fanatisme qu’elle accompagne ne peuvent pas ne pas avoir de conséquences dramatiques sur les valeurs morales pratiquées dans la société.
Les Lumières ont eu une influence déterminante sur l’évolution des règles éthiques occidentales, particulièrement Kant, dont l’éthique repose sur le principe fondamental de l'impératif catégorique qui stipule : « Agis de telle sorte que le principe de ton action puisse être érigé en loi universelle. » Impératif catégorique qu’il particularise dans le « principe d'humanité », à savoir : « Agis de façon telle que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans toute autre, toujours en même temps comme fin, et jamais simplement comme moyen. »
Selon Kant, l'impératif catégorique demande que nos actions soient guidées par des principes universels et rationnels, indépendamment des conséquences attendues ou des inclinations personnelles.
L'éthique de Kant met l'accent sur l'universalité des principes moraux, l'autonomie individuelle, la dignité humaine et la primauté de la raison dans la prise de décision morale.
Mais elle a fait l’objet de nombreuses critiques.
Schopenhauer critique ainsi « cette affirmation pédantesque, qu'une action, pour être vraiment bonne et méritoire, doit être accomplie par pur respect pour la loi et le concept de devoir, et d'après une maxime abstraite de la raison, non point par inclination, par bienveillance pour autrui, par sympathie, par pitié, par quelque tendre mouvement du cœur[6] ».
Pour Hegel, la conscience morale ne peut pas être réduite à une simple relation entre un individu et un impératif catégorique, sans tenir compte des particularités et des circonstances concrètes de chaque situation ; l’éthique ne peut pas être dissocié du contexte social, politique et historique dans lequel elle s'inscrit. Hegel insiste sur la nécessité de reconnaître les aspirations individuelles, les intérêts légitimes et les objectifs concrets dans la prise de décision éthique.
D’une certaine façon, Charles Péguy résume tout cela en écrivant : « Le kantisme a les mains pures, mais il n’a pas de mains.[7] »
Malgré tout, même si l’éthique ne peut être réduite à la raison, elle ne peut s’en affranchir. Certes, la main pure doit être ornée de bague(s), mais elle doit quand même être là pour les recueillir !
La raison est ainsi un des ingrédients fondamentaux de l’éthique, avec la bonté.
La bonté, il y a beaucoup à en dire ; entre autres : sur la proximité des perceptions de ses attributs dans diverses contrées et différentes cultures, sur l’utilité de la statistique pour étudier finement sa répartition et son effectivité dans la société, ainsi que sur la psychologie et sur la philosophie de la bonté. Mais je ne m’y attarde point, faute de temps.
Comment construire une éthique quand sont remises en question les croyances religieuses et métaphysiques qui proposent un ordre cosmique et attribuent un dessein à l'existence humaine ?
Le grand biologiste Jacques Monod souligne l'importance de reconnaître la réalité de la condition humaine, dépourvue de sens préexistant ou de finalité intrinsèque. Il soutient que l'Homme est confronté à un univers indifférent, dans lequel il doit trouver son propre sens et ses propres valeurs.
Bien que Monod n'ait pas développé exhaustivement une éthique de la connaissance, il a abordé des questions éthiques liées à la science et à la connaissance dans son livre intitulé « Le Hasard et la Nécessité », publié en 1970.
« Le projet de Jacques Monod était très, trop ambitieux : remplacer les éthiques traditionnelles par une éthique fondée uniquement sur le choix éthique que représente l’acceptation par les scientifiques du principe d’objectivité. Cet objectif trop ambitieux, et pour cette raison inatteignable, a occulté ce qui me semble être le plus intéressant dans la réflexion de Jacques Monod : l’idée que donner à la science la place majeure qu’elle occupe n’est pas une décision seulement pratique – la science permet de lutter contre les fléaux et de guérir les maladies ; c’est aussi donner une valeur particulière à une certaine forme de connaissance acquise par la mise en commun des efforts, quoi que cette connaissance puisse nous apprendre sur nous-mêmes, notre nature et notre destin. Cette intuition très forte de Monod est aussi, malheureusement, occultée par la définition très personnelle et biaisée qu’il donne de la connaissance objective.[8] »
Quelles que soient les caractéristiques ontologique et méthodologique de la connaissance objective, elles seraient bien difficilement à même de servir à elles seules à fonder une éthique. « Par contre, elles ne sont pas indépendantes de tout choix éthique. Affirmer qu’une vraie connaissance ne peut émerger que de la libre circulation des idées, et de leur libre critique, est un engagement éthique. […] Le choix de la science et de la connaissance objective est un choix qui engage. C’est croire qu’un progrès est possible, tant dans la connaissance que dans les résultats de l’action humaine. C’est être convaincu que la connaissance est en soi, et non par les applications qu’elle peut engendrer, un bien. »
« Jacques Monod avait raison : la connaissance objective porte en elle des valeurs. Si l’on surmonte une certaine naïveté ontologique et épistémologique qui obscurcit son discours, son intuition demeure : faire de la science est un choix éthique ; comme refuser de privilégier la connaissance objective par rapport à d’autres formes de connaissance est aussi un choix éthique aux valeurs différentes.[9] »
George Shultz, un ancien Secrétaire d’Etat américain, a écrit : « La confiance est la monnaie du royaume. Quand la confiance règne dans la pièce, quelle que soit cette pièce – le salon familial, la salle de classe, le vestiaire, le bureau, la salle gouvernementale ou la salle militaire – de bonnes choses se produisent. Quand la confiance n'est pas dans la pièce, de bonnes choses ne se produisent pas. Tout le reste n'est que détails. » La confiance se construit quand on a en commun un langage, du vécu, des ressentis, des habitudes, et des valeurs. Celles-ci ne peuvent être civilisatrices si elles sont dépourvues de tout base rationnelle.
Vu le cours de l’histoire récente, de l’état de nos sociétés et de l’évolution surprenante des mentalités, la théorie du progrès irréversible semble de plus en plus invraisemblable. Convenons avec Tite-Live, historien de la Rome antique, que « nous ne pouvons supporter ni nos vices ni leurs remèdes ». « Notre époque semble être un bon moment pour se rappeler à la fois que le déclin et l'effondrement sont de réelles possibilités et que la civilisation a tout de même de grands pouvoirs de récupération. »
« En Occident, de telles réflexions tendent généralement à évoquer trois choses (et malheureusement seulement trois) : l'effondrement de l'empire romain, les royaumes successeurs dits barbares, et la Renaissance subséquente de l'Europe […]. Cependant, la pensée conventionnelle est plutôt myope. La fameuse histoire du "déclin et de la chute" de Rome n'est qu'une petite partie d'une histoire beaucoup plus vaste. »
« Une vision plus large de l'histoire montre que l'échec et le renouveau de la civilisation sont la règle. Cela était vrai dès le début dans l'ancienne Mésopotamie, où les cités-États et les régimes politiques se sont développés et se sont effondrés rapidement. Par exemple, la troisième dynastie d'Ur, qui a été établie vers 2112 av. J.-C. et était un point culminant des premières civilisations, a connu un peu plus d'une centaine d'années de stabilité relative, puis s'est effondrée, pour être finalement remplacée par le Premier Empire babylonien. »
D’autre part, « la puissance romaine elle-même aurait été impensable sans l'imitation délibérée des anciens modèles culturels du Proche-Orient après l’effondrement de l'âge de bronze. Les commerçants phéniciens, agissant au nom de leurs seigneurs néo-assyriens, ont répandu la haute culture mésopotamienne et les produits de luxe dans toute la Méditerranée, et ont inspiré les Grecs et les Étrusques à les imiter. Peut-être aucune exportation n'a été plus importante à long terme que l'alphabet phénico-araméen, qui fut bientôt adapté aux autres langues de la Méditerranée. Et n'oublions jamais que c'est la colonie marchande phénicienne de Carthage qui, la première, a tissé une grande partie du monde méditerranéen dans l'unité économique et culturelle dont Rome hériterait un jour. »
« Comment le renouveau se produit-il après le déclin ou l'effondrement ? Pour notre ami Tite-Live, l'histoire elle-même, avec tous ses exemples de succès et d'échecs, montre la voie. La plupart des autres historiens classiques étaient d'accord et voulaient reconnecter leurs lecteurs avec les coutumes passées, les anciens exemples de conduite vertueuse, et ainsi de suite. Le même instinct s'exprime en grande partie dans la vénération confucéenne de l'ancien Etat de Zhou (1046-256 av. J.-C.) en tant qu'âge d'or à préserver et à renouveler à jamais dans les paroles de Maître Kong. »
« Cet instinct est juste : tous les grands renouvellements ont eu le même élan. Les érudits et les poètes du Moyen Âge, par exemple, ont été émus par les vestiges du passé lointain qui les entouraient - par les ruines, les textes anciens et les statues, en particulier. Cela est vrai pour tout le monde, d'Alcuin d'York (vers 735–804) et de Dante (1265–1321) à Muhammad ibn Jarir al-Tabari (839–923), aux grands poètes persans comme Ferdowsi (940–1020) et Khaqani ( 1120-1190), et aux polymathes de l'âge d'or abbasside (750-1258). Cette grande époque de civilisation [que fût l'âge d'or abbasside] est particulièrement instructive parce qu'elle s'inspire autant de l'héritage philosophique et scientifique gréco-romain que de l'art, de l'architecture et de la gouvernance de l'Iran ancien. Et à son tour, l'héritage de l'âge d'or abbasside a également été imité avec le plus de succès, non pas en Orient, mais en Occident. Pour ne citer que deux exemples parmi tant d'autres, le plus grand successeur d'Avicenne (Ibn Sina, 980-1037) et d'Averroès (Ibn Rushd, 1126-1198) fut Thomas d'Aquin (1225-1274) ; et les études astronomiques de Nasir al-Din al-Tusi (1201-1274) et de ses prédécesseurs ont été reprises dans l'œuvre de Copernic (1473-1543), qui les a copiées. »
« Nous, en Occident, qui avons été profondément irradiés par les idéaux des Lumières, devons trouver naïfs cette vision tournée vers le passé. Qui se tournerait vers le passé pour se renouveler ? La plupart d'entre nous préfèrent penser à des génies indépendants comme Bacon (1561-1626) ou Descartes (1586-1650) se débarrassant du poids de l'histoire au profit de la libre innovation.[10] »
Mais, si notre obsession de la nouveauté n'a pas réussi à nous rendre meilleurs, plus vertueux, plus civilisés, ou même plus heureux, peut-être sommes-nous enfin prêts pour quelque chose de vieux – et de rationnel.
[1] Michael Bonner, The Ends of History, https://antigonejournal.com, November 2022.
[2] Ibidem.
[3] Ibidem.
[4] Ibidem.
[5] ”What I've found with most of the woke people, [they] won't debate or discuss their ideas, because if they do, they might give some validity to the idea that the other side has a few interesting things to say, and that I think is quite totalitarian.” John Cleese on ABC TV.
[6] Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation.
[7] Charles Péguy, Pensées, octobre 1910.
[8] Michel Morange, L’éthique de la connaissance, Bulletin d’histoire et d’épistémologie des sciences de la vie, 2010/2.
[9] Ibidem.
MATRIX : illusion, simulation, simulacre : Où est la réalité ?
Conçu à partir d’émergences traditionnelles avouées et inavouées, les films des sœurs WACHOWSKY entrouvrent des portes et invitent à la réflexion sur la condition humaine, sur le labyrinthe de la vie et sur la place de l’homme dans l’univers. Une cosmologie ainsi qu’une cosmographie en quelque sorte
La réalité existe-t-elle de façon intrinsèque ou n’est elle qu’une projection du sujet pensant ?
MATRIX reformule une hypothèse septique et radicale
Le réel n’est-il qu’une gigantesque simulation ?
La réalité est un songe et les songes ne sont que des songes
L’intrigue se déroule au XXIIe siècle : le réel est détruit et l’intelligence artificielle mène la vie dure à l’espèce humaine
Enfermés dans des sortes d’alvéoles, les humains réduits à l’état de larves (leur activité cérébrale étant censée produire l’énergie dont les machines ont besoin) sont utilisés comme piles énergétiques pour la matrice (à la fois mère et machine) qui les maintient par « hallucination « dans l’illusion d’un réel de la fin du XXe siècle
Une poignée d’irréductibles emmenés par NÉO « l’élu », entreprendra de réveiller l’humanité et de la guider dans sa lutte contre les machines, pour la liberté des hommes
Voyons les noms des personnages principaux :
Thomas Anderson, le héros (Anderson signifiant le fils de l’homme) alias Néo le Nouveau, le néophyte. Il deviendra Néo (anagramme de One)
Morphèus : Dieu du songe (qui éveille Néo)
Trinity : Trinité (alliance des humains et du divin) symbolise, comme en alchimie, l’inconscient de l’adepte
Zion (pour Sion) : la terre promise
Le vaisseau Nebuchadnezzar pour Nabuchodonosor
Osiris : l’oracle
Persephine : le créateur de la matrice (Persephine, reine des enfers)
Thomas Anderson est un jeune informaticien, programmeur le jour et pirate informatique la nuit. Sa curiosité va le propulser dans un processus initiatique comparable à celui de nos rites.
Comme toute initiation traditionnelle, il passera par trois étapes :
La séparation d’avec un monde
L’intégration dans un monde nouveau
L’éveil d’une conscience nouvelle
Séparation d’avec un monde
Il va être déconnecté de la matrice : c’est une naissance avec placenta et plongée dans un utérus pour arriver dans un autre monde. Nous, nous quittons le monde profane pour venir travailler en loge et le jour de notre initiation, nous entrons dans le temple par la porte basse
Intégration dans un monde nouveau
Dans un nouveau groupe, celui des rebelles, il découvre le monde réel. Thomas Anderson n’est plus seul. Il est guidé par un maître : Morphéus qui lui transmet ce qu’il sait sur la matrice. Il s’intègre dans une nouvelle communauté au sein de laquelle il va trouver l’amour en la personne de Trinity. Il sera initié au combat pour la survie de Zion, le monde des derniers humains qui ont échappé à l’emprise de la matrice
Anderson va devenir Néo (ce qui n’était au début que son pseudonyme informatique) : il change d’identité, c’est alors un être nouveau
Franc-maçon, nous intégrons l’atelier, sommes reconnus par la loge et devenons un nouveau maillon de la chaîne
Éveil d’une conscience nouvelle
Néo ne deviendra l’élu que lorsqu’il sera capable d’assumer sa nouvelle identité ainsi que le rôle qui lui est dévolu
Comme lui dit Morphéus « la vérité du chemin, ce n’est pas le connaître mais le parcourir »
Que doit apprendre Néo pour accéder à son être véritable, comme The One : que le monde dans lequel il croyait vivre est illusion ? Certes
Reste l’essentiel : Il doit apprendre qui il est et ce qu’il veut et affirmer « je suis ce que je suis »
Ensuite seulement il pourra libérer l’humanité
Maçons, nous travaillons pendant nos tenues -avec l’aide du rituel - à mieux nous connaître, à nous accepter, à trouver notre place, et nous essayons ensuite, à notre mesure, de rendre le monde meilleur. Nous savons que nous ne sauverons pas le monde mais, si nous changeons, nous espérons que le monde finira par changer
Concernant le symbolisme
MATRIX est truffé de citations, d’allusions et de références à notre culture
Métaphore et fable du temps présent
Toutes les orientations de la pensée contemporaine semblent s’y reconnaître
Nous retrouvons « la république de Platon »
La matrice répète exactement le dispositif de la caverne imaginé par Platon dans laquelle les hommes ordinaires sont enchaînés, prisonniers de ce qu’ils considèrent -à tort- comme étant la réalité (chaînes symbolisant l’entrave matérielle à l’accès au spirituel)
Dans cette allégorie, comme dans MATRIX, un prisonnier est libéré du monde des illusions dans lequel tous les hommes vivent. Il découvre progressivement la nature de ce qui existe réellement, puis redescend finalement dans la caverne, au milieu des illusions que la connaissance de la vérité lui permet de maîtriser, dans l’espoir de libérer d’autres prisonniers
La différence ici est que lorsque certains arrivent à s’échapper de leur fâcheuse situation et sortent de la caverne pour se retrouver à la surface de la terre, ce n’est plus la surface lumineuse baignée par les rayons du soleil qu’ils découvrent, mais un spectacle de désolation :« le désert du réel «
L’extérieur est un réel de désolation mais on y est libre, l’intérieur un monde lumineux où l’on est esclave
MATRIX s’inspire d’autres modèles que l’allégorie platonicienne et compose ainsi une représentation originale du perfectionnement de l’esprit humain qui doit passer par plusieurs niveaux de perceptions distincts avant d’accéder à la vérité
La matrice est universelle, omniprésente et, comme l’apprend Néo, « le monde qui t’es présenté te cache la vérité : tu es enchaîné, tu es un esclave »
Comment ne pas penser au rituel maçonnique, au « voile épais qui me couvre les yeux »
Réalité et Illusion
MATRIX est un voyage radical de l’autre côté du miroir de la réalité, mais ce n’est qu’un voyage
C’est une fiction enrichissante mais reste une fiction et un « suscitant » qui tente de nous rendre un peu plus sensible, un peu plus ouvertL’allusion à
Lewis Carroll : le futur Néo suit une messagère portant comme tatouage sur l’épaule un lapin blanc
L’allusion à Jean Baudrillard (sociologue) : la caméra nous permet de lire le titre de son ouvrage « Simulacre et Simulation » caché dans boîtier
Ces allusions nous lancent sur la piste de la question du réel de la simulation, du simulacre et de l’illusion
La simulation se veut l’expérience du réel à travers ce qui nous est rapporté, le simulacre en étant la représentation figurée
Le premier MATRIX jongle astucieusement avec l’idée de simulation, opposant un univers simulé à la réalité que découvre le héros, mais le simulacre n’est jamais clairement abordé
Le film lui-même opère comme un simulacre et les signes et conventions auxquels il a recours en faisant découvrir à Néo le monde réel sont les outils mêmes qui nous interdisent de comprendre la vérité de l’œuvre : il n’y a pas de monde réel
C’est l’Ouroboros, le serpent qui se mord la queue
D’autres films traiteront de cette distinction croissante entre le réel et le virtuel. Signe des temps. L’homme se sent de plus en plus perdu dans un monde qui va peut-être trop vite pour lui et déshumanise l’individu
Comme Néo nous cherchons nous aussi des réponses. Le cadre de l’atelier, du travail initiatique, la rigueur et la stabilité des rituels sécurisent en permettant une ouverture de recherche à la fois personnelle et collective
Autre point de vue : la matrice est aussi ce qui fonctionne comme l’écran nous séparant du réel, rendant supportable ce « désert du réel »
Ici il ne faut cependant pas oublier l’ambiguïté radicale du concept lacanien du réel : le réel n’est pas le référent dernier domestiqué par l’écran du fantasme. Le réel c’est aussi et d’abord l’écran lui-même en tant qu’obstacle qui a déjà déformé notre perception du référent, de la réalité qui nous entoure
L’image de l’écran est en effet récurrente dans les MATRIX
L’interrogatoire de Thomas Anderson (M3) a lieu devant un mur d’écrans que la caméra nous fait traverser. Nous sommes alors de l’autre côté
Dans M2 la rencontre entre Néo et le concepteur a lieu dans une salle ronde aux murs couverts d’écrans qui multiplient en les diversifiant les images du personnage, comme si tous ces Néo n’attendaient qu’un retour à l’unité, The One, qui, une fois construit, établi, va faire son choix
Pour les maçons, l’écran qui nous sépare de la réalité n’est-il pas fait de ces métaux que nous avons du mal à déposer à la porte du temple, des réflexes mentaux dus à notre environnement ? La fraternité initiatique passe par le travail et la recherche de notre réalité
Nos choix sont tout aussi délicats que ceux de Néo car le grand problème de l’homme qui doute, qui cherche, c’est le choix
Néo est débranché de la matrice, de l’illusion d’un réel pour tomber dans le réel
Nous, nous « débranchons » les « tourbillons « de nos vies extérieures en venant en tenue, là où le vénérable nous dit : « nous ne sommes plus dans le monde profane, que nos regards se tournent vers la lumière ». En réalité nous changeons de plan de conscience en essayant de donner le meilleur de nous mêmes. Comme Néo, le spectateur de ces films est invité à arpenter le chemin au travers du réseau de simulacres qui constituent son univers. Nous venons en maçonnerie avec la croyance intime d’être autre chose qu’une entité programmable et ce faisant, nous clamons notre humanité.
La dimension mythique de l’œuvre est flagrante non parce que parsemée de références mythologiques mais parce que la manière dont elle se rapporte au sens correspond assez précisément à ce que Levi Strauss a cherché à saisir en élaborant un nouveau concept du mythe. MATRIX se rapproche d’un mythe non pour son contenu donc, mais pour sa forme. En effet la notion de mythe ne désigne pas, selon Levi Strauss, les récits des origines qui assurent le lien entre le profane et le sacré ou ce pieux mensonge destiné à justifier l’ordre social existant, mais un dispositif de signes qui va chercher son matériau dans tous les univers culturels d’une société afin, non pas de communiquer une signification déterminée, mais de rendre compatible ces différentes manières entre lesquelles les hommes tentent de mettre de l’ordre dans leur propre expérience.
Ainsi il est inutile de chercher un sens au mythe. Car le mythe propose une grille définissable seulement par ses règles de construction. Grille qui confère un sens, non au mythe lui-même, mais à tout le reste ; C’est à dire aux images du monde dont les membres du groupe ont toute conscience
La matrice d’intelligibilité fournie par le mythe permet d’articuler ces données éparses en un tout cohérent
Alors, dans un effort de cherchant, il nous faut saisir le mythe, la grille du mythe, la transcender afin de sortir de la matrice d’intelligibilité
La voie est intérieure et seulement intérieure
En conclusion
Au-delà de ce que les sœurs WACHOWSKY ont voulu exprimer dans leurs films, cette trilogie apparaît comme une métaphore de notre monde, ouvrant des pistes de réflexion différentes selon les individus.
Cependant les bases traditionnelles et culturelles, voire cultuelles sont là et bien là
En cela la quête de Néo est universelle
La Russie au tournant de l’Histoire
(Aleksandr Fiodorovitch Kerenski)
Александр Фёдорович Керенский
Leader de la première révolution Russe (mai à septembre 1917)
Né le 4 mai 1881 Né à Simbirsk ; décédé le 11 juin 1970 à New York.
AlexandreKerenski fut initié en 1912 par la Loge La Petite Ourse de Saint Pertersbourg appartenant au Grand Orient des Peuples de Rusiie issu du Grand Orient de France
La quasi- totalité de son gouvernement appartenait à la Franc-Maçonnerie; dix de ses onze ministres furent .
En 1899, Kerenski entre à l’université de Saint-Pétersbourg et termine des études juridiques en 1904, ce qui lui permet de s’inscrire au barreau de cette ville. Avocat engagé, il porte assistance à de nombreux opposants au régime impérial soumis à la répression policière, ce qui lui vaut d’être exilé à Tachkent en décembre 1905.
Il est libéré en 1906. Ses succès de prétoire favorisent, en 1912, son entrée à la IVe Douma comme député, sous l’étiquette travailliste. Il est aussi, à cette époque, un des dirigeants francsmaçons les plus en vue de Saint-Pétersbourg.
Au début de la guerre, en 1914, il se persuade que le conflit va conduire à l’effondrement du régime tsariste.
Il se construit un profil politique d’opposant absolu à l’autocratie mais refuse toute compromission avec les marxistes. En 1917, Kerenski, entre dans le gouvernement dirigé par le prince Georgy Lvov (également dignitaire franc-maçon).
Il accède au portefeuille de ministre de la justice. Le nouveau pouvoir proclame une série de réformes d’une ampleur sans précédent qui font entrer la Russie dans une ère démocratique malheureusement trop brève : libération des prisonniers politiques, instauration du suffrage universel et suppression de la peine de mort.
Un second gouvernement provisoire est formé au mois de mai, toujours sous la présidence du prince Lvov. Kerenski est en charge du ministère de la guerre et prépare l’offensive menée en juin contre l’Allemagne. La démission du prince Lvov permet à Kerenski de former un nouveau gouvernement. Maître du pays, il le gouverne pendant près de cent jours. Il va s’efforcer, avec une exceptionnelle énergie, de contenir la subversion bolchévique qui s’étend et de réduire les menées réactionnaires des membres de l’ancien régime tout en s’opposant à ce que l’on attente à leurs vies.
À la fin du mois de septembre 1917, il forme un troisième gouvernement de coalition.
Mais la Russie est épuisée par trois années de guerre. Kerenski et son cabinet s’estiment contraints au respect de leurs engagements vis-à-vis des Alliés. Ils craignent de surcroît que l’Allemagne n’exige des concessions territoriales exorbitantes contre un armistice. Ce refus de désengagement dans la guerre est une cause de sa chute. L’accord secret passé entre les bolchéviques et le gouvernement Allemand du Kaiser Guillaume II l’est encore davantage. En pleine guerre mondiale, les banques allemandes prêtent leur concours massif à Lénine en exil en Suisse. Estimant que la situation est « mûre » celui-ci affrète un train blindé qui assure son transit et celui de son trésor vers la Russie. "C'est le fameux train d'or de Lénine".
Dans la nuit du 24 au 25 octobre, les milices bolchéviques investissent tous les points stratégiques de Saint Pétersbourg. Le 25 au soir, le Palais d’Hiver où siège le Gouvernement provisoire est encerclé ; les canons de la forteresse Pierre-et-Paul comme ceux des croiseurs Aurore et Amour sont pointés sur lui. À 21 heures 40, l’assaut est donné. Par ce coup d’état la démocratie est ruinée en Russie et l’Allemagne s’assure à l’Est d’une paix avantageuse par le Traité de Brest-Litovsk signé par les bolchéviques désormais au pouvoir. (La Biélorussie passe sous administration allemande de même que les Pays baltes et la Pologne.
Le gouvernement bolchevique verse au Reich une indemnité de 94 tonnes d’or).
Le régime bolchévique procède à l’assassinat du Tsar et de toute sa famille le 17 juillet 1918 à Ekaterinbourg.
Kerensky gagne la clandestinité. Il parvient à s’exiler à Paris. En 1940 il s’installe à New York ou il est accueilli (notamment en loge) avec de grands égards. Il achève sa longue existence comme chercheur et enseignant à l’Institut Hoover et à l’université de Stanford. Il publie ses mémoires présentées aux ÉtatsUnis en 1965 Russia and History’s Turning Point qui seront traduites en 1966 en France sous le titre La Russie au tournant de l’Histoire.
[NB : Léon Trotski, dans un discours au IVe congrès du Komintern, dénonce l’idéologie de la maçonnerie française, coupable de réunir les ennemis de classe et de vouloir substituer la tolérance à la lutte armée. Les 3 et 12 août 1922 les décrets légalisant la liquidation de la franc-maçonnerie russe sont publiés.]
La Russie au tournant de l’Histoire (1965), édité par Plon en 1967
Chapitre IX. Complots et conspirations.
« En 1905, le lien spirituel entre le trône et le prolétariat industriel des villes avait été rompu. Le 8 juillet 1906, la dissolution de la première Douma, à propos du problème agraire, avait détruit la foi de la paysannerie dans le tsar, “défenseur de la justice et de la vérité”. Maintenant, après la rupture avec la majorité modérée des conservateurs et libéraux dans les Chambres législatives, le trône allait se trouver complètement isolé de la nation, ne pouvant plus compter que sur l’appui des réactionnaires d’extrême-droite et des carriéristes sans scrupule, contrôlés par Raspoutine. Désormais tout le monde avait compris que l’origine du drame ne se trouvait ni dans l’action du gouvernement et des ministres, ni dans des erreurs occasionnelles, mais dans l’attitude du tsar lui-même, qui refusait d’abandonner son idée fixe, selon laquelle la Russie ne pouvait exister et prospérer que sous la férule d’un autocrate. La constatation de ce fait se trouvait à la base de toutes les discussions privées et de tous les projets élaborés au sein du Bloc progressiste ; elle avait, en même temps, profondément pénétré dans l’esprit de la nation et de l’armée. Une question fatidique se posait maintenant devant chaque patriote : était-il pour la Russie ou pour le tsar ? La première personne à s’exprimer à ce propos fut Nicolas Lvov, monarchiste et libéral modéré. Sa réponse était nette : « Pour la Russie. » Et le pays entier lui fit écho, au front comme à l’intérieur. Dès 1915, certains officiers de l’armée avaient commencé à fomenter une série de complots, complètement enfantins, destinés à libérer la Russie de son souverain. À titre d’exemple, on peut citer le projet d’un pilote de combat très connu, le capitaine Kostenko : il se proposait d’attaquer en piqué la voiture impériale, en se tuant avec le tsar Il y avait deux autres officiers, dont l’un était Mouraviov, capitaine du génie et par la suite « héros de la guerre civile », qui vinrent me demander d’approuver un projet non moins fantaisiste : il s’agissait de tendre un piège au tsar pendant une inspection du front et de le faire prisonnier. Le général Denikine lui-même écrit dans ses mémoires que la chute de la monarchie était envisagée favorablement par les soldats, qui voyaient, de longue date, la cause de toutes leurs infortunes dans la Niemka (l’impératrice) de Tsarskoié-Sélo. Au cours de l’automne de la même année 1915, je reçus la visite d’un vieil ami, le comte Paul Tolstoï, fils d’un écuyer du tsar. Ami intime du grand-duc Michel, frère du souverain, il le connaissait depuis son enfance. Il m’annonça qu’il était venu à la demande du grand-duc : connaissant mes rapports avec les partis de gauche, il voulait savoir comment réagiraient les ouvriers dans le cas où Michel prendrait la succession de son frère Nicolas II. Tous ces incidents étaient hautement symptomatiques : ils indiquaient un changement profond dans la mentalité du public. La patience de la nation était à bout. Un nombre croissant de gens avait le sentiment que tous les ennuis de la Russie provenaient de Raspoutine et qu’il suffirait de l’éliminer pour que la politique gouvernementale changeât. Même un homme comme A. N. Khvostov, chef et militant du groupe de l’Union du peuple russe à la Douma, avait élaboré un plan pour tuer Raspoutine. Ce fut enfin le prince Youssoupov, assisté du grand-duc Dimitri, cousin favori du tsar, et de Pourichkévitch, député de droite, qui prit sur lui de sauver la dynastie et la monarchie en tuant Raspoutine. […] Jetant un regard en arrière, je peux opposer un démenti formel à ceux qui accusent les chefs du Bloc progressiste d’avoir combattu le trône pour des motifs égoïstes et ambitieux, conduisant ainsi la Russie au désastre. Pour preuve, il suffit d’évoquer les antécédents de la plupart des députés de la troisième et de la quatrième Douma. C’étaient des gens étroitement associés au régime et au gouvernement par tradition, par leur situation sociale, par leurs intérêts personnels ; ils étaient tous des sujets loyaux. Dans la quatrième Douma, cette majorité, consciente de la grande tragédie qui se déroulait devant ses yeux, s’est vue contrainte d’abandonner sa notion traditionnelle de la monarchie et du rôle de celle-ci en Russie. Tout a été réfléchi et prévu. Ce n’était plus une poignée de députés, mais la majorité de la Douma, qui se posait maintenant, à l’instar de Lvov, la question : « Pour le tsar ou pour la Russie ? ». Et elle répondait : « Pour la Russie. »
Chapitre XXV. Le drame de l’Assemblée constituante.
Le jour crucial du 5 janvier, la capitale avait pris l’aspect d’une ville assiégée. Quelques jours plus tôt, les Bolcheviks avaient institué un « état-major d’urgence », et tout le district de Smolny avait été placé sous les ordres de Bontch-Brouévitch, l’homme de main de Lénine. Le secteur autour du Palais de Tauride était placé sous la surveillance étroite de Blagonravov, le commandant bolchevik. Le palais était entouré d’unités, munies d’armes lourdes, de marins de Cronstadt et de tirailleurs lettons, dont quelques-uns avaient pris position à l’intérieur de l’édifice. Des cordons barraient l’entrée de toutes les, rues qui conduisaient au palais. Il me semble inutile de décrire la première et unique séance de la Constituante. Le traitement incroyable qui fut infligé par les sbires de Lénine aux représentants élus du peuple a été souvent évoqué par ceux qui ont vécu les heures terribles du 5-6 janvier 1918. Aux premières heures du 6, l’Assemblée constituante fut dispersée par la force brutale et l’on ferma les portes du palais. Les foules pacifiques qui s’étaient réunies pour manifester leur appui à l’Assemblée furent chassées par un feu de salve. Cette victoire facile, remportée par les Bolcheviks sur la Constituante, fut suivie presque immédiatement de l’assassinat de Chingarev et Kokochkine, deux anciens membres du parti Cadet et ministres du gouvernement provisoire, qui n’avaient pas pu assister à la séance de clôture parce qu’ils étaient internés à la forteresse Pierre-et-Paul… Tard dans la journée du 6 janvier, on les avait transportés à l’Hôpital Marie, où ils étaient placés sous bonne garde, dans une salle spéciale. Dans la nuit du 7 janvier, une bande de soldats et de matelots bolcheviks y pénétrèrent, sous prétexte de faire la relève ; et les deux hommes d’État qui avaient consacré toute leur vie au service de la liberté et de la démocratie, trouvèrent la mort dans leur lit, où ils furent cloués par les baïonnettes (…)
Évasion de Gatchina
J’attendais les suites des pourparlers, installé dans mon appartement à l’étage supérieur. Soudain, quelques amis pénétrèrent dans mon bureau et m’apportèrent la nouvelle alarmante que les négociations touchaient à leur fin et que les Cosaques avaient consenti à me livrer à Dybenko, en échange de la promesse qu’ils pourraient retourner dans la région du Don, avec leurs armes et leurs chevaux. Le palais de Gatchina (ancien palais du Prince Orlov à 50km au Sud de Saint Pétersbourg) était déserté, à l’exception d’un petit groupe de partisans fidèles qui me servaient d’intermédiaires et me renseignaient sur le cours des pourparlers. Nous n’ignorions pas la démoralisation des Cosaques et les activités subversives auxquelles on se livrait autour de nous. Mais je me refusais encore à croire que le général Krasnov ou les officiers commandants du corps cosaque pourraient se décider à une trahison ouverte. Le général Krasnov vint me voir vers onze heures, et les soupçons qui me hantaient déjà se transformèrent en certitude à la lumière de notre entretien. Il essaya de me persuader de me rendre à Petrograd et de parler à Lénine. Il m’assura que je serais sous la protection d’une garde cosaque et qu’il ne voyait pas d’autre solution. Je n’entrerai pas dans les détails de notre dernière rencontre. En jetant un regard en arrière, je comprends maintenant à quel point la tâche du général était difficile, car il n’était pas un traître par nature. Là-dessus, mes « observateurs » remontèrent en courant les escaliers, pour m’annoncer le résultat final des négociations : on devait me livrer à Dybenko, et les Cosaques rentreraient dans leur province. Il était midi ; le bruit et les cris d’en bas s’amplifiaient. J’ordonnai à tous de me quitter. Je ne voulais garder auprès de moi que mon aide de camp personnel, N. V. Vinner : nous étions décidés à ne pas être pris vivants. Nous avions l’intention de nous loger une balle dans la tête, après nous être retirés dans les pièces du fond, tandis que les Cosaques et les marins nous chercheraient dans celles de devant. En cette matinée du 14 novembre 1917, cette décision paraissait parfaitement logique et inévitable. Tandis que mon entourage prenait congé de moi, la porte s’ouvrit et je vis apparaître sur le seuil deux hommes : un civil que je connaissais et un marin que je n’avais encore jamais vu. Il n’y a pas de temps à perdre, me dirent-ils. Dans une demi-heure, une foule furieuse montera à l’assaut de votre appartement. Enlevez votre tunique, mais faites vite ! Quelques instants plus tard, j’étais transformé en marin, d’aspect plutôt grotesque. Les manches de mon maillot étaient trop courtes, mes souliers bruns et mes guêtres contrastaient avec l’ensemble. Mon béret enrubanné de matelot était beaucoup trop petit et me tenait à peine sur le crâne. Pour compléter mon déguisement, on me remit des lunettes d’automobiliste. Je serrai mon aide de camp dans mes bras et il me quitta en passant par une pièce voisine. Le palais de Gatchina fut construit par Paul Ier, l’empereur demi-fou, sur le modèle d’un château médiéval. Je me trouvais dans un véritable piège, car l’édifice était entouré de douves et on ne pouvait en sortir que par un pont-levis. Notre seul espoir était de passer inaperçus par la cour, à travers la foule armée, pour rejoindre la voiture qui nous y attendait. Je descendis accompagné du matelot par l’unique escalier, au bout du corridor. Nous marchions comme des robots ; nos cerveaux étaient vides et inconscients du danger. Nous gagnâmes la cour sans incident, mais la voiture ne s’y trouvait pas. Saisis de désespoir, nous rebroussâmes chemin sans dire mot. Notre aspect devait paraître passablement bizarre. Les gens qui se pressaient sous la porte cochère nous jetaient des regards curieux ; heureusement, certains d’entre eux étaient nos partisans. Un homme s’approcha de moi en chuchotant : « La voiture vous attend à la Porte Chinoise. Ne perdez pas de temps. » Ces paroles vinrent nous réconforter, car la foule se déplaçait déjà dans notre direction et notre situation devenait à chaque instant plus critique. Et c’est juste à ce moment qu’un jeune officier, le bras en écharpe, eut soudain la bonne idée de « s’évanouir », attirant ainsi sur lui l’attention de la foule. Nous profitâmes de l’occasion pour disparaître en vitesse de la cour du palais. Nous nous dirigeâmes vers la Porte Chinoise, qui donnait sur la route de Louga. Nous marchions lentement et parlions à haute voix, pour ne pas éveiller les soupçons des passants. Ma disparition fut découverte une demi-heure plus tard, lorsque les Cosaques et les matelots pénétrèrent en foule dans mon appartement du premier étage. Des voitures furent aussitôt envoyées dans toutes les directions pour nous rattraper ; mais, une fois de plus, nous fûmes favorisés par la chance. Nous avions aperçu un fiacre qui avançait lentement dans la rue déserte ; nous lui fîmes signe et nous lui promîmes un bon pourboire s’il pouvait nous conduire à la Porte Chinoise. Il resta bouche bée, à l’arrivée, lorsque les deux « matelots » lui remirent un billet de cent roubles. La voiture nous attendait à la place indiquée. Je sautai à côté de l’officier qui la conduisait, tandis que le matelot s’installait sur le siège arrière avec quatre ou cinq soldats armés de grenades. La grand-route vers Louga déroulait un paysage superbe, mais nous préférions tourner nos yeux vers l’arrière, attendant, à chaque instant, d’être rejoints par ceux qu’on allait lancer à notre poursuite. En cas d’attaque, nous étions résolus à nous servir des grenades qu’on avait placées dans le coffre. En dépit de la situation dramatique, l’officier gardait un calme incroyable et ne cessait de siffler une chanson du répertoire de Vertinski, le chanteur à la mode. Notre chance ne nous abandonnait pas : nous ne fûmes pas rattrapés. Mon propre chauffeur, qui était resté au palais de Gatchina, fit, de son côté, preuve de fidélité. Il savait que nous avions l’intention d’aller à Louga. Lorsque ma disparition fut découverte, il se mit à crier que sa voiture était la plus rapide de toutes et que ce lui serait facile de rattraper « cette canaille ». Il partit donc dans ma direction et s’offrit même le luxe d’une panne feinte en cours de route. Nous avions finalement atteint une forêt. Les freins grincèrent. « Sortez, Alexandre Fedorovitch », fit l’officier. Mon matelot, qui s’appelait Vania, me suivit. Nous nous engageâmes dans un sentier couvert de mousse, qui conduisait vers les profondeurs de la forêt. Un silence de mort nous entourait, tandis que nous avancions sans penser, sans même nous inquiéter de ce qui pourrait nous arriver. J’avais une confiance sans limite en ces étrangers qui, poussés par un sentiment que j’ignorais, risquaient si joyeusement leur vie pour me sauver. De temps à autre, Vania s’arrêtait pour reprendre son souffle. Je n’avais plus aucune notion du temps ; j’avais l’impression que notre marche ne finirait jamais. Soudain mon compagnon s’écria : « Nous y sommes ! » Nous étions parvenus à une clairière et le chalet était devant nous. « Asseyez-vous un instant. Je vais aller voir ce qui s’y passe. » H. disparut à l’intérieur du chalet, mais revint bientôt pour me dire : « Il n’y a pas de servantes. La bonne est partie hier. Mon oncle et ma tante sont heureux de vous accueillir. Venez. »
Le chalet dans la forêt
C’est ainsi que commença ma vie dans cette demeure forestière où j’allais rester quarante jours. Les Bolotov, un couple âgé, me firent un accueil chaleureux. « Ne vous inquiétez pas. Tout ira bien », disaient-ils pour me consoler. Ils m’offrirent une hospitalité généreuse, sans faire la moindre allusion aux risques qu’ils couraient. Pourtant ils devaient être pleinement conscients du danger, car les Izvestia avaient fait paraître, dès le 27 octobre, un communiqué intitulé : « Arrestation des anciens ministres ». « Les ex-ministres Konovalov, Kichkine, Terestchenko, Maliantovitch, Nikitine et plusieurs autres ont été arrêtés par le comité révolutionnaire. Kerenski a réussi à s’échapper. Toutes les organisations de l’armée déploieront leurs efforts pour arrêter immédiatement Kerenski et le transférer à Pétrograd. Toute aide ou assistance accordée à Kerenski sera punie, comme haute trahison. » […] -----------
Note sur le Prince Félix
Felixovitch Youssoupov Né le 11 mars 1887 à Saint-Pétersbourg ; décédé le 27 septembre 1967 à Paris. La mère de Felix Youssoupov, la princesse Zénaïde, était réputée plus riche que le tsar. (En 1917, sa fortune était estimée à six cent millions de dollars – près de onze milliards de dollars actuels) La famille résidait ordinairement au palais de la Moïka à Saint-Pétersbourg (où eut lieu l’assassinat de Raspoutine). Ce prince élégant, doté d’une grande intelligence, amateur d’art, vouant un culte à la beauté, mena une double vie, éprouvant pour l’œuvre d’Oscar Wilde une véritable fascination. Félix Youssoupov fut également attiré par les sciences occultes. Youssoupov souffre de l’ascendance qu’exerce Raspoutine sur la famille impériale. Avec le grand-duc Dimitri Pavlovitch, le député Vladimir Pourichkevitch, le lieutenant Sergueï Soukhotine et le Docteur Lazovert il perpétra l’assassinat de Raspoutine dans la nuit du 16 au 17 décembre 1916. Le prince et ses complices furent interrogés. L’impératrice réclama leur exécution immédiate mais les autorités pétersbourgeoises refusèrent d’arrêter les responsables d’un acte approuvé par la population. Nicolas II ordonna leur exil. Le 11 avril 1919, Youssoupov est contraint de quitter la Russie à bord d’un cuirassé HMS Marlborough envoyé à Yalta par le roi d’Angleterre pour sauver ses « cousins russes ». En 1920, il s’établit avec sa femme à Paris. Ami de Kessel, Cocteau ou du comte Boniface de Castellane, il reste, jusqu’à sa mort une des grandes figures de l’émigration russe et de la société parisienne.
La fin de Raspoutine | Extrait des mémoires du Prince Félix Youssoupov
« D’un geste lent, je tirai le revolver de derrière mon dos. Raspoutine se tenait toujours debout devant moi, immobile, la tête penchée à droite ; ses yeux hypnotisés par le crucifix, restaient figés sur lui. – Où faut-il viser, pensai-je, à la tempe ou au cœur ? Un frisson me secoua tout entier. Mon bras s’était tendu. Je visai au cœur et pressai la détente. Raspoutine poussa un rugissement sauvage et s’effondra sur une peau d’ours. Au même instant, j’entendis du bruit dans l’escalier. C’étaient mes amis qui accouraient. Dans leur précipitation, ils avaient accroché un commutateur électrique et nous étions plongés dans l’obscurité la plus complète. Quelqu’un se cogna à moi et poussa un cri ; je ne bougeais pas de peur de marcher sur le cadavre. Enfin, la lumière reparut et tout le monde se précipita vers le corps de Raspoutine. Il était étendu sur le dos. Ses traits se contractaient par moments. Il avait les yeux fermés. Sa blouse de soie était rougie d’une tache sanglante. Nous nous penchâmes tous sur le corps pour l’examiner. Au bout de quelques minutes, Raspoutine qui n’avait plus rouvert les yeux, cessa de bouger. On examina sa blessure, la balle avait traversé la région du cœur. Il n’y avait plus à en douter, il était bien mort. Le grand-duc et Pourichkevitch transportèrent le cadavre de la peau d’ours sur les dalles. Nous éteignîmes l’électricité et montâmes dans mon cabinet après avoir fermé à clef la porte de la salle à manger. Tous nous nous sentions le cœur plein d’espérance tellement nous avions la conviction que l’événement qui venait de se passer sauverait la Russie de la ruine et du déshonneur. Conformément à notre plan, le grand-duc Dimitri, Soukhotine et le docteur devaient faire semblant de raccompagner Raspoutine chez lui pour le cas où la police secrète nous eût suivis à notre insu. (…) Pourichkevitch et moi restâmes à la Moïka. En attendant le retour de nos amis, nous parlions de l’avenir de notre patrie à tout jamais délivrée de son mauvais génie. Pendant que nous causions, je fus saisi soudain d’une vague inquiétude et d’un désir irrésistible de descendre dans la salle à manger où reposait le corps. Je me levai et je descendis. Par terre, à l’endroit même où nous l’avions laissé, gisait Raspoutine. Je lui tâtais le pouls. On ne percevait plus aucun battement. Raspoutine était bien mort. Je ne m’explique pas pourquoi je saisis tout à coup le cadavre par les deux bras et le secouai si violemment qu’il en fut soulevé, se pencha d’un côté, puis retomba. Après être resté quelques temps à côté de lui, je me disposais à m’en aller lorsque mon attention fut subitement attirée par un tressaillement presque imperceptible de sa paupière gauche. Je me penchai sur lui et je l’observai avec attention ; de légers tremblements contractaient son visage. Tout à coup, je vis s’entrouvrir son œil gauche. Le mort ne l’était pas. Quelques instants après a paupière droite commença à trembler à son tour et se souleva. Je vis alors les deux yeux de Raspoutine, des yeux verts de vipère, fixés sur moi avec une expression de haine satanique. Mon sang se figea dans mes 9 veines. Je voulus m’enfuir, appeler au secours, mais mes jambes refusaient de m’obéir, et aucun son ne sortait de ma gorge oppressée. Alors, il se passa une chose atroce. D’un mouvement brusque et violent, Raspoutine bondit sur ses jambes, l’écume à la bouche. Il était effroyable à voir. Un rugissement sauvage retentit dans la chambre et je vis ses mains convulsées battre l’air. Puis il se précipita sur moi ; ses doigts cherchant à me saisir la gorge s’enfonçaient dans mon épaule. Ses yeux sortaient de leur orbite, le sang coulait de ses lèvres. D’une voix basse et rauque, Raspoutine m’appelait tout le temps par mon nom. Rien ne peut se comparer au sentiment d’horreur qui me saisit. Je tâchai de me libérer de son étreinte mais j’étais pris comme dans un étau. Une lutte terrible s’engagea entre nous. Cette créature qui mourait empoisonnée, la région du cœur traversée par une balle, ce corps que les puissances du mal paraissaient avoir ranimé pour se venger de leur déroute avait quelque chose de si effrayant, de si monstrueux que, lorsque j’y repense, je ne parviens pas à me libérer d’un sentiment d’effroi. Il me sembla comprendre encore mieux qui était Raspoutine. J’avais l’impression d’avoir devant moi Satan lui-même incarné dans ce paysan et qui m’avait saisi dans ses griffes pour ne plus me lâcher. Grâce à un effort surhumain, je parvins à me dégager de son étreinte. Il retomba sur le dos, râlant affreusement et serrant dans sa main mon épaulette qu’il avait arrachée pendant notre lutte ; il gisait de nouveau sans mouvements sur le sol. Au bout de quelques instants, il remua. Je me précipitai dans l’escalier en appelant Pourichkevitch. – Vite, vite, descendez ! criai-je, il vit encore. Il y eut quatre coups de feu […] Un scaphandrier remonta le corps, gelé et recouvert d’une épaisse couche de glace entourant le manteau de castor de Raspoutine. L’autopsie révéla trois points d’impacts de balles, qui avaient traversé le cœur, le cou et le cerveau. On trouva dans l’estomac « une masse épaisse de consistance molle et de couleur brunâtre », sans doute le poison. Mais surtout, l’autopsie révéla cette chose inouïe, que Raspoutine n’était mort ni du poison, ni des balles, ni des commotions et des coups assénés. La présence d’eau dans les poumons prouve sans appel qu’il respirait encore au moment où on le jeta dans la rivière. Raspoutine était mort noyé, ou de froid »
De la mesure du monde à l’invention du mètre
Mes très chers frères en vos grades et qualités, Vénérable Maître,
Je souhaiterais vous faire vivre aujourd’hui une aventure autant scientifique qu’humaine qui va marquer la naissance de la mesure des choses, et quand je parle de mesure c’est de pouvoir rendre universelles et incontestables les unités de base pour exprimer les dimensions, les surfaces les volumes afin que toute épure, carte, mais également calcul physique puisse être comparable et interprétable grâce à une unité commune. Cette histoire est une quête d’absolu qui nous conduit à l’invention du mètre et du système qui porte désormais son nom : le système métrique.
Condorcet résuma ce projet par ces mots : “un rêve utopique d’une unité de mesure pour tous les hommes et pour tous les temps“, une déclaration empreinte de valeurs chères à la maçonnerie qui n’est jamais très loin dans cette histoire. Cette recherche de valeurs absolues est intimement liée aux mesures iconoclastes de la révolution du calendrier au système décimal ( et non en base 12 qui fut longtemps utilisée) mais qui allait donner naissance au comité des poids et mesures devenu en 1795 le bureau des longitudes qui est à l’origine du SI système international d’unités.
Nous sommes en 1792, la Révolution française bat son plein, deux diligences filent dans la nuit le long du méridien de Paris. L’une a pris la direction de Rodez en partant de Dunkerque, l’autre doit rejoindre Barcelone en partant de Rodez. L’astronome Pierre François André Méchain prend donc la direction du sud alors que jean Baptiste Joseph Delambre, également astronome pointe vers le nord. Une aventure extraordinaire vient de commencer et va durer 7 ans…
Mais avant de nous plonger dans cette odyssée aux nombreux rebondissements, il nous faut faire un petit historique de l’impérieux besoin des hommes de quantifier et mesurer tout ce qui l’entoure. Depuis la préhistoire, l’homme bâtit, cultive, échange, évalue.
Avec les premières civilisations antiques, des royaumes de Mésopotamie au cités états de Grèce, des dynasties d’Egypte à l’empire Perse, les interactions humaines réclament des 3 systèmes de quantifications permettant les échanges commerciaux, les partages des terres arables, la formalisation d’une propriété privée ou encore les frontières entre puissances rivales.
Ainsi les administrations dominantes établissent de très nombreux systèmes de mesure dont la précision et les équivalences sont sources de discordes et d’imprécisions.
Entre 2650 et 100 ans avant notre ère, on retrouve une multitude d’unités dont voici quelques exemples :
- le cube royal gur de Mésopotamie, un cuboïde théorique d'eau d'environ 6 mx 6m 0,5 m à partir duquel toutes les autres unités pouvaient être dérivées.
- Le Pied Artabic utilisé dans tout l’empire Perse
- La Coudée royale ou meh d’Egypte longueur de l’avant-bras d’environ 52,5 cm
- Le Nouh une corde de 52,5 mètres qui vaut 100 coudées royales pour mesurer un champ ou les éléments de construction des monuments.
- Le Lenga la lieu gauloise distance de 2220 mètres
- La coudée attique grecque d’environ 44,4 cm utilisée au siècle de Périclès Avec la Grèce et ses cités états, on multiplie les unités : pied de Delphe (35 cm), Pied de Macédoine ( 35,35 cm), le pied philtérien ( 35,5 cm) et de même pour évaluer les distances le mille routier 1480 m ou le stade routier 157,5 mètres,
- les hébreux ne sont pas en reste avec le Amma la coudée des Hébreux de 48cm, ou le chemin sabbatique des hébreux équivalent à 1120 mètres soit 2000 grandes coudées
- Sans oublier l’unité la plus utilisée du monde antique, le pied romain de 29,6 cm et le stade romain de 184 mètres La liste semble sans fin …
Tous ces systèmes pour la mesure dimensionnelle ont perduré ou disparu au fil du temps, s’adaptant aux usages et à l’évolution des connaissances en matière de géométrie et, nous verrons plus tard, que cette multitude de manières de quantifier restera une pratique établie jusqu’à la Révolution française.
Il faut tout de suite préciser que les proportions d’un objet, d’un monument ou d’une œuvre ont majoritairement un caractère sacré comme la proportion dite "divine" du nombre d'or, les solides de Platon (tétraèdre, cube ou hexaèdre, octaèdre, dodécaèdre, icosaèdre, …) ou encore la suite de Fibonacci.
On ne pourrait cependant les comparer aux dimensions physiques qui révèlent plus d’une métrique, d’une connaissance concrète de la mesure des choses même les plus vastes comme le calcul de la circonférence de notre planète qui fut réalisée dès l’antiquité par Ératosthène de Cyrène, un astronome, géographe, philosophe et mathématicien grec, en 230 Av JC. Il compare l'observation qu'il fait sur l'ombre de deux objets situés en deux lieux, Syène (aujourd'hui Assouan) et Alexandrie, considérés comme étant sur le même méridien et évalue la distance entre Syène et Alexandrie à 5 000 stades et un angle d’arc de 7,2 degrés ; il en arrive donc à une estimation de 250 000 stades ce qui correspond en mesure 5 actuelle à 39 375 km pour une mesure réelle de 40 007,864 km. Retenons cette mesure et cette dimension qui seront l’enjeu philosophique de l’invention du mètre.
Revenons maintenant en France à la fin du 18ème siècle, une fin de siècle où gronde un tiers état prenant conscience de sa valeur révélée par les philosophes des lumières et qui va bientôt se débarrasser des élites possédantes devenues obsolètes dans un monde qui va radicalement changer avec la Révolution. Un monde où les sciences et techniques prennent un nouvel essor avec une académie des sciences qui va accélérer la promotion des savants , multiplier les champs de recherche, les expéditions et doter la république balbutiante de nouveaux outils mathématiques indispensables à son rayonnement et notamment d’un système de mesure universel et incontestable capable d’améliorer la plupart des activités humaines, des échanges commerciaux à la construction d’édifices ou plus tard, à l’aube de l’autre révolution, industrielle cette fois de machines de production. Mais la France vit encore avec des règles du moyen-âge particulièrement en ce qui concerne ses unités des poids et mesures qui font l’objet de pas moins de 800 appellations.
Ainsi, les mesures variaient d’un endroit à un autre dans le royaume et bien sûr d’un pays à l’autre. On estimait qu’à la fin de l’ancien régime les 800 appellations ne cachaient pas moins de 250 000 unités de poids et mesures différentes. (la pinte de bière à Paris est 30% plus faible en volume qu’à Saint Denis ou encore la livre des boulangers était de 20% plus légère que la livre des quincailliers…) 6 Un enfer pour le développement commercial, économique et scientifique des activités humaines. Et c’est bien grâce à la révolution que la recherche et l’application d’une solution universelle à l’image des droits universels du citoyen fut rendue possible.
Afin que l’universalité des poids et mesures ne puisse être contestée comme une action arbitraire issue d’un groupe de savants ou d’une nation, il fut décidé de déterminer l’unité de mesure fondamentale à partir de la dimension de la terre elle-même d’où devait découler le système métrique, système le plus utilisé au monde aujourd’hui. Pour déterminer cette unité, l’académie charge nos 2 astronomes de mesurer précisément l’arc méridien entre dunkerque et Barcelone, et d’en déduire le quart méridien dont le 10 000 000 est le mètre. La méthode utilisée est une mesure locale par triangulation qui nécessite un équipement particulier, le fameux cercle répétiteur de Borda du nom de son inventeur, un instrument de haute précision permettant de mesurer des distances angulaires entre 2 points de la surface du globe.
Donc il fallait se déplacer à vue de lunette (de quelques lieux) et mesurer des points remarquables (sommet de collines, clochers, ou tout autre élévations singulières) et répéter l’opération jusqu’à arriver au point précis de l’arc méridien. Pour l’anecdote, l’appareil comportait un cercle doublement gradué sur 360° et 400°, nouvelle manière révolutionnaire de découper le cercle mais qui fut vite abandonnée aux vues des difficultés de transcription trigonométrique… 7 Sur le papier, cela semble simple quoique fastidieux mais nous sommes en pleine révolution, la période de la terreur commence. Aux frontières, l’hostilité de la république naissante renforce le sentiment anti français des royaumes européens.
Autant dire que traverser la France et une partie de l’Espagne relève de l’exploit ! De plus pour arranger le tout, l’équipage de nos savants ne passe pas inaperçu avec leurs berlines équipées d’une petite remorque qui contient les appareils de mesure dont le cercle répétiteur Borda. Engins inconnus du commun des mortels et particulièrement dans le monde rural de cette fin de 18ème siècle… Car, au cours de leur périple et de leurs mesures particulières où l’on triangule à partir de points remarquables comme les clochers de villages, les châteaux haut perchés et les curiosités naturelles escarpées, toutes sortes de fortunes vont retarder ou terriblement compliquer leur tâche. On les prend tantôt pour des espions tantôt pour des agents à la solde des contres révolutionnaires ou même pour des exorcistes avec leurs machines infernales….
Pierre Méchain fut même retenu contre son gré et de nombreux mois par les Espagnols en pays catalan pendant la guerre qui fit rage entre les 2 pays et dont la victoire revint à la France grâce au général Dugommier. Il poursuivi cependant ses calculs sur sa partie d’arc méridien. Pour Delambre, la mission fut couramment interrompue faute de nouvelles de son colistier et de ses résultats afin d’aboutir au graal : le mètre ! 8 Mais pendant que nos 2 astronomes essayaient de coordonner leurs calculs et de poursuivre la mesure de l’arc méridien pour obtenir un résultat d’une précision extrême, le gouvernement révolutionnaire décida de ne pas attendre et décréta, avant la validation des savants, d’une règle provisoire d’un mètre pour que le système métrique soit rendu obligatoire au premier juillet 1794. Ce décret resta encore confidentiel mais pour familiariser la population avec cette nouvelle mesure, on fit distribuer des prospectus et des tableaux de conversion et on installa entre 1796 et 1797 16 mètres étalon en marbre dans les lieux les plus fréquentés de Paris.
Mais l’acceptation, la connaissance et l’usage de ce nouveau système faisant table rase des mesures de l’ancien régime fut peu utilisé au départ. D’ailleurs Mechain et Delorme n’achevèrent leurs travaux qu’en 1799, année où fut définitivement adopté Le système métrique. Il fallut tout de même attendre 1837 pour que Louis Philippe révoque “les mesures usuelles“ au profit du système métrique qui fut progressivement adopté par la Belgique, l’Espagne et la plupart des pays du monde vers le milieu du XXème siècle excepté, pour des mesures usuelles, certains pays anglo-saxons que vous connaissez mais qui ont adopté ce système tout en étant les derniers à l’appliquer… une véritable révolution !
Soulignons qu’à son indépendance en 1947, l’Inde déliée des Britanniques adopta le système métrique. La métrisation du monde est aujourd’hui achevée. 9 Il y a pourtant une histoire dans l’histoire car en mesurant l’arc méridien Pierre Méchain a commis une erreur de calcul qui fait que le mètre de Méchain est trop court de 0,2mm. En effet, en refaisant les mesures par satellite on constate que la longueur du méridien du pôle à l’équateur est de 10 002 290 mètres et non 10 000 000 mais c’est la valeur de Méchain qui reste le mètre de toute éternité dont la définition aujourd’hui est le trajet parcouru par la lumière 1/299 792 458 s très exactement !
Du mètre découle la plupart des unités de dimension et de vitesse, de l’angström 1/ 10 000 000 de mètre aux distances galactiques exprimées en année lumière (la distance parcourue par la lumière en 1 année terrestre en prenant comme base 300 000 kilomètres à la seconde) mais également de surface et de volume avec le mètre carré et le mètre cube, toutes ces grandeurs que nous utilisons quotidiennement
Ainsi le mètre a été imaginé par les hommes des lumières, des hommes épris de valeurs universelles, les valeurs des maçons. Et, malgré son origine tumultueuse il définit, au-delà des mesures, notre perception du monde. Enfin, son origine étymologique vient du grec métron qui signifie : mesure !
J’ai dit Vénérable maître
Marie-Guillemine Benoist élève d'Elisabeth Vigée Le Brun
Portrait de Madeleine, Musée du Louvre
Clip BEYONCE = portrait de Madeleine : minute 05,42
La Franc-Maçonnerie et l'esclavage
Le 20 mai 1981, François Mitterrand voulut unir le peuple français avec son histoire en allant fleurir au Panthéon trois tombes : celles de Jean Moulin, de Jean Jaurès et de Victor Schoelcher. Si la plupart des français connaissaient les deux premiers, en revanche, il remit en lumière le troisième entraînant comme conséquence de son acte, l’ouverture d’études et d’analyses multiples et variées sur l’abolition de l’esclavage.
En 1989, à l’occasion du Bicentenaire de la révolution et persévérant dans son souhait de vouloir ressusciter la mythologie républicaine, ce même président fit entrer également au Panthéon la dépouille de l’Abbé Grégoire, second acteur de la lutte contre l’esclavage.
Sachant que l’abbé Grégoire et Victor Schoelcher furent des francs-maçons actifs, l’abolition de l’esclavage fut alors un thème, repris par de nombreuses obédiences qui y consacrèrent moultes travaux. Avec l’instauration récente chaque 10 mai de « La journée nationale des mémoires de l’esclavage, des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition », les commémorations et autres événements maçonniques sur ce sujet se sont ajoutés, tels des « marronniers », les uns et aux autres. Dernièrement, rue cadet, l’installation du buste de la « Marianne noire » aux côtés de celui de Victor Schoelcher fut célébrée ; érigeant cette sculpture, comme l’emblème du rôle majeur que le Grand Orient de France a joué dans l’abolition de l’esclavage.
Avec le recul que nous avons sur François Mitterrand et connaissant la duplicité dont il a été capable dans sa vie politique comme personnelle, et par la méfiance que j’ai naturellement à l’égard de toute grand-messe où sont récitées de longues tirades appelées républicaines ou citoyennes, je me suis m’intéressé un peu plus (doux euphémisme) à l’esclavage et j’ai essayé d’entrevoir les actions justifiant la place revendiquée par la Franc-Maçonnerie dans son abolition.
Avant d’aborder ce sujet, il me semble essentiel de se pencher sur la réalité de l’esclavage dans notre civilisation.
Depuis que l'homme, qu'il soit de Néandertal ou Sapiens-sapiens, a commencé à peupler notre terre, il a, au travers de ses expéditions guerrières, compris qu'utiliser les vaincus comme garde-manger, puis comme objet à tout faire représentaient des avantages procurant pouvoirs, richesses et plaisirs en tous genres. Il a également découvert les capacités de reproduction bon marché de « cette matière première » ; bon marché car dans un temps pas si lointain, en Afrique, un cheval valait a minima 20 esclaves...
Avec les religions primitives, à cette réalité économique, s’est ajoutée une dimension rituelle de l'esclavage avec les sacrifices humains. Ce nouveau besoin de fournir régulièrement aux dignitaires religieux des esclaves, a créé des flux financiers pérennes débouchant naturellement sur un commerce : le premier contrat d’une vente d'un individu de sexe masculin a été découvert en Mésopotamie. Il datait de 2600 ans avant JC.
Dans une antiquité plus proche, ce tribut acquis par tout vainqueur de tout conflit s’est généralisé. Partout dans le monde, sont apparus des esclaves destinés à répondre à tous les besoins de la société : à Sparte, par exemple on trouve même les ilotes qu'on enivre à mort pour prouver aux enfants les méfaits de l'alcool et les inciter en toute occasion à conserver la maîtrise d'eux-mêmes.
Pour tous, sous toutes les latitudes, l'esclavage s’est profondément ancré dans les sociétés. C'est un pilier économique et culturel de toutes les civilisations l'inscrivant comme faisant partie intégrante de notre humanité.
« L’utilité des animaux privés et celle des esclaves sont à peu près les mêmes ; les uns comme les autres nous aident par le secours de leur force corporelle à satisfaire les besoins de l’existence…l'esclavage est un mode d'acquisition naturel » Aristote Politique 1,4,7
En Afrique noire, l’organisation ancestrale des sociétés les plus évoluées repose sur une organisation clanique qui d’ailleurs perdure encore aujourd’hui.
Pour faire très court, tous les échanges sociaux et marchands ne reposent que sur l’appartenance des individus à un clan. Tous ceux qui en sont extérieurs ou ne sont pas capables de s’opposer à un clan dominant, dans les rapports de force ou marchands constituent un réservoir naturel d’esclaves.
Ainsi, les pauvres qui se vendent ou vendent leurs femmes ou leurs enfants, les enfants non reconnus, les exclus ou condamnés et les prisonniers ou déplacés de guerre sont tous mis en esclavage. Ils représentent la force économique des royaumes africains. Eux seuls sont assujettis aux tâches agricoles, artisanales, ménagères ou minières même s’il convient de préciser que leurs conditions de vie, sont « parfois moins pires » que celles des esclaves des autres parties du globe, car plus intégrés à la vie sociale des tribus.
Au plus fort du développement de son empire, Rome, a porté à son summum son organisation. Elle a hiérarchisé les esclaves entre eux avec : les esclaves publics, ruraux et domestiques. Ces derniers peuvent devenir secrétaires administratifs ou précepteurs. Les autres, comme les esclaves publics, sont employés à des travaux d'intérêt général, dans les mines et, tout en bas de la hiérarchie, les prostituées, les gladiateurs, les condamnés aux jeux du cirque et les galériens ferment ce groupe d’individus. Tous réunis, ils représentent une part très importante de la société. Au Ier siècle après JC, environ 30% de la population totale de l'Italie est constitué d’esclaves, soit quelques millions d'individus pour tout l’empire.
Pour illustrer ces chiffres, sachons que notre Vercingétorix n’était pas tout seul à prendre le chemin de Rome. A l'issue de toute la guerre des Gaules, César l'aurait fait accompagner par environ 500 000 à 1 000 000 de gaulois et autres Francs.
A la même époque, avec la fin des guerres puniques, s’amorce la « pompe africaine orientale » marquée par l'arrivée des nubiens, eux-mêmes issus de circuits d’approvisionnement datant des pharaons.
Dans toute l'antiquité, l'esclavage permet l'enrichissement des élites et ce, en toute légalité. L'esclave était qualifiée par le nom commun latin, « Servus » qui signifiait à la fois à la fois l'étranger et l'esclave prouvant la perception qu’en avait toute la société romaine. En Français, Servus[1] donnera le mot Serf prouvant là aussi, la propension des plus puissants à classer les plus faibles en objets utilitaires, en « sous-hommes ».
La chute de l'empire romain et l'apparition du monde chrétien puis musulman ne procurent pas de modifications significatives à cette réalité. Dans les versions en langue d'origine des trois livres saints, nous trouvons 800 références sur les esclaves dans la Bible, 200 dans le Nouveau Testament et environ 29 dans le Coran. Si au fil du temps, les prédicateurs de chaque religion ont eu tendance à rejeter la responsabilité de l’esclavage sur celle des autres, aucune de ces mentions ne condamne explicitement cette réalité. Tout au mieux, elles cherchent à en codifier la pratique.
Cependant, il convient de souligner que la lente évolution du regard de l'homme sur l'esclavage trouve ses origines dans les trois religions monothéistes et plus particulièrement dans la religion catholique. D’abord dictée par une recherche de cohérence théologique, cette dernière initiera une prise de conscience qui prospérera tout au long des siècles. Même si, au fur et à mesure du développement du rejet de l’esclavage, les hommes s’accommoderont des injonctions religieuses et continueront leur triste commerce, cette prise de conscience sera la base d’une transformation lente et irrémédiable de la société occidentale face à cette barbarie.
A contrario, nous pouvons constater qu’il n’en est pas de même en Orient et que cela soit en Inde ou en Chine, la fragmentation séculaire de la société est restée encore d’actualité. Aujourd’hui encore, des centaines de millions de leurs habitants vivent dans des conditions aussi misérables que celles de beaucoup d’esclaves des siècles précédents.
A de volumes moindres, il en de même dans les pays musulmans africains comme moyen-orientaux. Dans certains pays, principalement ceux qui sont en conflits et restent traversés par des flux migratoires non discontinus, l’esclavage est revenu à sa forme initiale.
Revenons à notre analyse historique : A la limite de nos frontières européennes, les empires perse, arabe puis ottoman pratiquent systématiquement l'esclavage, mais le Coran interdit la réduction des croyants en esclaves. De plus, en Afrique du Nord, les arabes ont vite besoin des berbères pour y assurer leur domination et pactisent avec eux car seuls, ces derniers sont capables de s’acclimater aux rigueurs du climat saharien. De plus, pour maintenir le commerce avec l’Afrique noire, la connaissance des routes des oasis est indispensable or, cette dernière ne repose que sur des savoirs oraux jalousement gardés par « les seigneurs des sables ». Ainsi, au fur et à mesure de la propagation de l’Islam, dans le Maghreb, puis dans l’Empire Mandingue (Mali), les populations capables d’être mises en esclavage se raréfient. Les africains non-musulmans vivants aux lisières des forêts équatoriales deviennent alors les proies de substitution. Plus tard, pour satisfaire aux besoins toujours croissants, c’est l’Afrique australe avec le Royaume du Kongo qui en sera affectée.
Il est à noter qu’au travers des siècles, la traite orientale aura été sans doute, plus importante que la traite occidentale.
Dans ce sinistre décompte, n’oublions pas de mentionner la traite à la corne de l’Afrique avec Zanzibar comme maillon central.
Si, pour des raisons faciles à comprendre, la comptabilité de ces commerces n’est pas forcément fiable, les estimations raisonnables des victimes de cette première traite orientale se situent entre 8 à 14 millions d'africains sans compter les millions qui ont disparu durant leurs marches forcées à travers les déserts et ce, avant même d’être vendus. On peut aisément multiplier par 2 ces chiffres pour en apprécier la réalité.
Du XIIIème au XVIème siècle, cette traite africaine s'amplifiera avec les razzias destinées à alimenter les rezzous s’étendant des états soudanais à plus de la moitié des territoires du continent africain. Il en résultera un état de guerre quasi permanent sur une majeure partie de l’Afrique.
En Occident à la même époque, dans des proportions moindres, l'esclavage devient un marché avec les traites maritimes et terrestres dont Venise est la plaque tournante. Grâce à sa quasi-suprématie en Méditerranée, après la chute de Constantinople en 1204, ses marchands ont détourné cette source immense de revenus à leur profit. Les vénitiens commencent par se servir au plus près sur la côte dalmate puis, pour répondre à une demande forte, vont chercher des esclaves dans des contrées plus lointaines même si souvent, ils parent au plus pressé, en pillant les îles grecques. Les slaves avec les tartares du Don et les russes sont capturées. Leurs femmes ou autres habitantes de toute la chaîne du Caucase passent pour très belles et sont très prisées sur les marchés ottomans ou espagnols.
Après avoir vendu leurs captures aux Sarrazins et pour ne pas rentrer à vide, les Vénitiens reviennent avec des condamnés de droit commun arabes puis des noirs ; hommes et femmes qui viendront remplir les galères et les bordels de la cité des doges ou d'autres villes en Occident (Gênes, Syracuse, …).
«L'esclanovie», terre peuplée d'esclavons c'est à dire de slaves, devient le terrain de chasse privilégié des vénitiens, introduisant le mot esclave dans notre langue et remplaçant le terme latin initial.
A la même époque les égyptiens, les incas et les lointains chinois comme d'autres peuples orientaux avaient eux aussi recours à l'esclavage à grande échelle. Ces derniers sont même venus faire leurs emplettes (les chrétiens étant les produits de luxe de l'époque) jusque sur les marchés ottomans. On considère que seules, les trois villes de Tripoli, Alger et Tunis ont vu transiter plus d'un million d'esclaves durant cette époque médiévale.
Dès le XVème siècle ; avec la découverte de l’Amérique puis suite à l’écroulement de l’Empire du Mali, la situation bascule dans une autre dimension. Le besoin immense de main-d’œuvre Outre-Atlantique agit comme un engrenage qui va entraîner toute notre civilisation dans cette entreprise.
S'appuyant sur l'existence des réseaux de la traite orientale et, des circuits développés à partir de no-mans land juridiques constitués par des îles lointaines dont avaient pris possession des aventuriers ou autres pirates, de nouveaux circuits se constituent. Ils fournissent en personnel totalement servile, les grandes « latifundia » espagnoles, portugaises sans oublier les marchands arabes toujours demandeurs.
Dans les Açores, à Madère, au Cap-Vert, dans la petite Ile d'Arguin puis à Sao-Tomé sont créés des comptoirs. L’esclavage occidental à grande échelle se met en place sous l'égide des portugais qui veulent satisfaire aux besoins de la culture de la canne à sucre aux Antilles puis au peuplement du Brésil.
Les autres puissances maritimes ne restent pas passives et immédiatement, en parallèle à leurs avancées néocoloniales, s'organisent en conséquence. Principalement entre l'Afrique, les Antilles et l'Amérique du Nord puis vers les ports européens, la traite en Atlantique instaure le commerce triangulaire. C'est un gigantesque circuit où seront déportés 12 à 15 millions d'hommes. Dans ce monstrueux palmarès européen, la France occupera la quatrième place des puissances esclavagistes derrière le Portugal, l'Angleterre et l'Espagne.
En France, les activités négrières se répartissent en deux pôles principaux, l’un Atlantique et l’autre Normand avec des nombres d’expéditions à peu près identiques. Quatre ports en captent la quasi-totalité : Nantes, Bordeaux, La Rochelle et le Havre. Ces trois derniers ports ont un nombre d’expéditions qui représente environ le quart de celui de Nantes et le dixième de celui de Liverpool. Par extrapolation, au regard de la magnificence architecturale des villes comme Bordeaux ou Nantes, on comprend l’importance économique qu’a pu représenter ce commerce dans la construction des empires, principalement ceux britannique et portugais.
Mais ces témoins architecturaux de la richesse de nos grands ports français ne sont que la partie visible d’une réalité. L'esclavage a fait partie intégrante de notre société européenne. Il a été un formidable vecteur de production et de puissance économique pour tout notre vieux monde et pour l’ensemble des grands puissances mondiales.
Oui, la France est restée très longtemps première puissance européenne, en partie, grâce aux retombées financières de ses colonies. De l’autre côté de la Manche, Albion a pu financer ses guerres contre nous grâce « au sang de ses esclaves ». A la veille de la Révolution Française, un emploi sur huit en métropole dépendait directement des activités des territoires extérieurs et la traite représentait une part non négligeable de celles-ci.
Si nous pouvions essayer une comparaison avec aujourd’hui, nous pourrions dire la traite était « le pétrole », l’énergie de l’époque. Son importance économique pouvait être assez similaire à celle des hydrocarbures et de toutes ses industries dérivées réunis.
Alors, si ces phénomènes massifs et séculaires que sont l'esclavage et la traite étaient parties intégrantes sur lesquels s’étaient construites nos civilisations, comment ont-ils pu disparaître ?
Pas de Deus ex machina ! L'abolition de l'esclavage a été fruit d'une très très lente prise de conscience des hommes sur l'anormalité d’une telle institution. En permanence, cette transformation aura été nourrie par des événements tragiques provoqués par des hommes et de femmes qui, soit refusaient leurs conditions d’esclaves, soit s'interrogeaient sur la justification de telles pratiques qu'ils en soient les spectateurs ou les victimes. Également, il ne faut pas se voiler la face, la condition des esclaves a également été remise en cause par des individus ou des groupes sociaux recherchant une meilleure productivité que celle issue d’esclaves misérables et incompétents. De même, dans les milieux chrétiens l’incohérence d’une justification d’une telle pratique a aussi été un obstacle à la bonne d’évangélisation des peuples africains ou amérindiens des pays conquis.
Ces sources d’interrogations sur l‘esclavage n’étaient d’ailleurs pas nouvelles :
- Dans l’antiquité, l’importance pour le peuple juif emmené en captivité en Egypte et en Mésopotamie est soulignée sans cesse dans la Bible. Cette délivrance du peuple élu a certainement conditionné de façon souterraine comme par la suite, le culte de l’amour d'autrui dans la religion catholique, les opinions. Oui, notre culture judéo-chrétienne a fait prospérer chez nombre d’européens, le rejet d’une telle pratique.
- Également à Athènes comme à Rome, certains avaient pu mesurer les avantages économiques de l’affranchissement par rapport au maintien de l’esclavage brutal.
A ces deux réalités s’ajoutera dès le haut moyen-âge, un autre fait qui viendra bousculer l’ordre établi. Les mondes musulman et chrétien s'affrontent et chacun tente d'extraire leurs coreligionnaires des mains ennemis. Pour organiser leurs échanges ou rachats d’esclaves, ils rédigent des règlements qui constituent les premières décisions anti-esclavagistes.
Dès 1135, Louis VI, Philippe le Bel puis Louis X le Hutin le 3 juillet 1315, vont prendre des édits royaux modifiant les conditions de vie puis libérant les serfs signifiant ainsi la suppression de l’esclavage en France. Dorénavant, le droit du sol inscrit l’interdiction d’esclaves dans le royaume.
« Le sol de France affranchit tout esclave qui le touche » Louis X
En 1335, la Suède puis la Finlande suivent à leur tour cet édit en abolissant l’esclavage sur leurs terres.
Dans le même temps, à Salamanque, Bartolomé de Casas se met à affirmer l’unité de l’espèce humaine. A Valladolid, on découvre la présence d’une âme chez les amérindiens. Certes les noirs seront les victimes collatérales de cette dernière décision qui n’en constitue pas moins, une avancée majeure contre l'affirmation de l'inégalité des hommes entre eux, pierre angulaire de la justification de l’esclavage.
En 1440, une première bulle du pape Nicolas V, s’oppose à la prise en esclavage d’africains mais elle n’est pas entendue et, rapidement les gigantesques profits réalisés dans les nouvelles Amériques vont balayer toutes les volontés d'une partie de l'église de modifier cette réalité humaine.
En France comme dans tous les pays présents sur mer, on créera de prestigieuses compagnies comme celle de la Compagnie des Indes ajoutant en toute légalité la traite des noirs à leurs fructueuses activités commerciales. Les codes noirs parfois les plus abjects sont rédigés. Les pays puissants s’organisent en conséquence. Ils signent des accords de commerce entre eux. En 1701, l’Espagne concède à la France un accord d’exclusivité pour tout son commerce d’esclaves africains.
A la même époque, les premières révoltes des esclaves fuyant leurs conditions par le marronnage, sont toutes impitoyablement réprimées. Elles commenceront cependant, à sensibiliser une petite partie de l’opinion publique, alors que ce commerce devient déportation de masse.
Pourtant, malgré cette affligeante réalité que rien ne semble combattre, une révolution intellectuelle et philosophique va provoquer une déflagration dans cette institution bien huilée.
Ce sont les lumières du XVIIIème siècle qui portent les premières condamnations radicales de l’esclavage. D’abord en Angleterre, relayé par des prédicateurs dissidents de l’Église officielle, un courant se propage simultanément dans le nouveau monde et en France. Il trouve immédiatement un accueil favorable chez les libres penseurs.
Chez certains, à l'instar de Voltaire, la prise conscience est progressive mais tous se radicalisent dans leurs combats :
« Les chiens, les singes, les perroquets sont mille fois moins malheureux que nous. Les fétiches hollandais qui m'ont converti me disent tous les dimanches que nous sommes tous enfants d'Adam, blancs et noirs. Je ne suis pas généalogiste ; mais si ces prêcheurs disent vrai, nous sommes tous cousins issus de germains. Or vous m'avouerez qu'on ne peut pas en user avec ses parents d'une manière plus horrible. » Candide
Certains deviennent de plus en plus virulents :
Jean-Jacques Rousseau, qui juge dans le Contrat social que « ces mots, esclavage et droit, sont contradictoires, ils s’excluent mutuellement », dénonce toute entreprise coloniale dans le Discours sur l’origine de l’inégalité entre les hommes (1754) et dans le Discours sur l’économie politique qu’il rédige pour l’Encyclopédie de 1758.
« Après avoir parcouru l’histoire de l’esclavage, nous allons prouver qu’il blesse la liberté de l’homme, qu’il est contraire au droit naturel et civil, qu’il choque les formes des meilleurs gouvernements, et qu’enfin il est inutile par lui-même ……….
Les peuples qui ont traité les esclaves comme un bien dont ils peuvent disposer à leur gré, n’ont été que des barbares. »
La parution de l’Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans Les deux Indes de l’Abbé Raynal en 1770, surtout celle Des Réflexions sur l’esclavage des Nègres par Condorcet écrit sous le pseudonyme de Joachim Schwartz en 1781, donnent un nouvel élan à ce courant transformant le combat initial contre la seule traite en exigence de la suppression totale de l'esclavage. Ils sont relayés par les écrits de Diderot, du chevalier de Jaucourt, de Rousseau ou d’Olympe de Gouges qui se mettent à inonder le vieux continent d’inépuisables sources d’arguments.
Très rapidement aux anathèmes des philosophes se joint le verdict des économistes. Mirabeau, Dupont de Nemours, Turgot, Adam Smith et Condorcet, sont présents sur tous ces fronts. …
Par ailleurs, des esprits généreux comme celui de La Fayette, en communion avec les américains que sont Washington, Franklin, Jefferson eux-mêmes nourris par Les Lettre persanes ou l’Esprit des Lois de Montesquieu et très fortement influencés par Condorcet, prennent tant en Amérique du Nord que du Sud, les premières décisions de « terrain » qui conduisent à la libération d'esclaves et, surtout à l'accession de certains dans la société des hommes libres.
Comme en Angleterre, des sociétés anti-esclavagistes se créent pour faire pression sur les gouvernements. La plus célèbre sera La Société des Amis des Noirs, créé par Brissot et comptant rapidement 140 membres dont Mirabeau, La Fayette, Condorcet, Sieyès, Grégoire, ...
Le résultat de cette mobilisation sans précédent de l'élite française conduit Louis XVI dès 1776 à promulguer l'interdiction de posséder des esclaves sur tout territoire français et le 8 mai 1779, abolit par ordonnance le servage, le droit de suite et affranchit « les mains mortables, les hommes de corps, les taillables ou mortaillables » de la totalité du domaine royal.
Dès la fin du XVIIIe siècle, une cinquantaine de cahiers de doléances, rédigés en vue de la tenue des États généraux, estiment nécessaire la suppression de l’esclavage dans les colonies.
Malgré les premiers votes des 8 mars et 12 octobre 1790 de l'Assemblée Constituante rejetant « L’Adresse à l'Assemblée Nationale pour l'abolition de la traite des Noirs » présentée par Brissot, l'abolition de l'esclavage est finalement votée pour la France et toutes ses colonies ou territoires Outre-Mer, le 4 février 1794.
Cette décision qui est inscrite au sommet des grands changements dans notre histoire ne sera malheureusement pas suffisante. Tout au long du XIXème siècle, les retours en arrières ou autres interrogations des différents gouvernements influencés par les innombrables groupes d'intérêts esclavagistes, rendront le combat âpre avant d’arriver à l’abolition officielle de l’esclavage en 1848 en France puis en 1889 sur tous les continents contrôlés par les puissances occidentales.
Alors dans ce combat, comment se sont impliqués nos anciens F... et la Franc-Maçonnerie dans son ensemble ? Sa place prédominante revendiquée par certains dans l’abolition de l’esclavage est-elle justifiée ?
Tout d’abord, nous avons tous constater que la majorité voire la quasi-totalité des hommes du XVIII ème et XIX ème siècles, cités précédemment, sont des Francs-maçons.
Ensuite, il est irréfutable d’affirmer que des loges illustres comme celle des Neuf Sœurs où furent initiés Voltaire, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Sieyès, l’abbé Grégoire, ...ont été porteuses d’idéal d’humanité et contribuèrent à le faire rayonner au sien de la Franc-Maçonnerie tout entière. De même, nous savons que, dans cette même loge, fut initié le premier homme de couleur, le Chevalier de Saint-Georges.
Plus tard, après l’Empire, des loges telles que Les Amis de la Vérité ou La Clémente Amitié ont activement œuvrer à cette cause avec in fine, au succès qu’on lui connait.
Mais à cette même époque, qu’en est-il de toute la Franc-Maçonnerie et comment l’ensemble des loges ont-elles abordé cette remise en question de l’esclavage.
En dresser le tableau complet m’étant impossible, j’ai donc choisi de m’intéresser à la vie maçonnique d’une ville et de la prendre comme exemple : celle du Havre.
En 1756, en même temps que la ville prend son essor, les premières loges sont créées dans un contexte assez chaotique.
Rapidement, avec la naissance du Grand Orient de France et ses besoins de faire remonter des subsides, les loges se tournent vers les notables puissants et riches de la Ville, c’est-à-dire les représentants des corps royaux, les officiers de Marine et les armateurs qui en deviennent les plus nombreux et éminents représentants. Les plus grands négociants de la ville sont initiés et font leurs, les Constitutions d’Anderson où il est écrit :
« « Les esclaves, les femmes, les gens immoraux ou deshonorés ne peuvent être admis, seulement les hommes de bonnes réputations »
A la Révolution Française, les loges qui, localement, n’ont eu aucune influence dans son déclenchement, sont prises dans la tourmente. Après les événements de Thermidor, seules trois loges subsistent : celles de l’Aménité, la Fidélité et des 3 Haches (Le Havre, Harfleur, et Honfleur).
Elles recherchent immédiatement à se redévelopper et à rassembler une société élitiste regroupée autour des activités maritimes[2]. De même, elles reprennent très vite au gré des voyages des navires, le contrôle de nombreuses loges coloniales.
Pour étendre leur commerce, tant dans les comptoirs des Indes ou africains qu’aux Antilles ou aux Etats-Unis, les Francs-Maçons visitent les loges locales et y créent des liens fraternels débouchant sur la signature d’accords commerciaux multiples.
Avec la croissance du commerce triangulaire, la propension de nombreux francs-maçons à s’ériger comme défenseurs des positions esclavagistes au fur et mesure que les défenseurs de l’abolition s’expriment, devient le véritable marqueur de l’appartenance à une élite[3]. Des loges puissantes comme celle de la Fidélité au Havre accueillent alors, en plus grand nombre, des hommes aux professions extérieures au négoce : des médecins, des officiers et surtout des avocats, procureurs ou notaires, qui avaient accepté de servir ce commerce dont la sophistication nécessitait des besoins particuliers en écriture juridique. Nombre d’entre eux sont alors impliqués dans la vie publique et combattent fermement les mouvements abolitionnistes.
Dans le même temps, dans son souci de contrôler et réguler les loges coloniales, le Grand Orient de France nomme des F...., officiers de marine ou armateurs pour atténuer les tensions locales entre les loges et stopper les dissensions qui peuvent apparaitre en leurs seins, particulièrement sur les questions d’initiations et de statut de « Frère servant » créé pour les hommes libres de couleur. Dans les règlements de loges, on peut y lire :
« Tous profanes qui auraient le malheur d’être juifs, nègres, ou mahométans ne doivent point être proposés ».
Des navires nommés « Union », « Grande Union » « Véritable ami » « Le Franc-Maçon » ...sillonnent l’Atlantique. La loge « La Sincérité », créée sous les hospices du GODF à l’Ile de Gorée, est visitée par les Hauts-grades et les F... de passage au Sénégal.
Ce courant antiabolitionniste au sein de la FM française est très actif et vient même apporter son concours aux Frères anglais quand les lois de leur pays se mettent à poursuivre les activités négrières. Face à ces changements, ces interrogations et les potentielles possibilités de scission que font peser les loges portuaires ou les loges coloniales, le Grand Orient de France, arbitre en faveur de la fraction de l’élite la mieux placée ou de l’atelier déjà régularisé. L’obédience veille surtout à ne pas remettre en cause les équilibres locaux et les règles qui y ont cours et à empêcher tout risque de voir partir ces loges puissantes et riches dont les remontées financières sont maximales. A la même époque, le pouvoir orléaniste reste profondément esclavagiste et l’opinion publique, très agité politiquement n’a que faire de la situation des esclaves !
Enfin, la France catholique, n’est pas influencée par les mouvements évangélistes protestants qui constituent le fer de lance anti-esclavagiste occidental. En revanche, ils pénètreront lentement les courants de pensée de nombreuses loges.
Ainsi, ce n’est que très tard après leurs réelles interdictions légales et avoir fermé systématiquement les yeux sur les nombreuses pratiques esclavagistes, que l’obédience commencera à être plus directive sur ces questions. L’augmentation des loges accueillant des hommes de couleur en sera certainement une autre raison.
Arrivé aux termes de cet écrit, quelles conclusions puis-je lui donner ?
Me refusant aux approches actuelles qui sont souvent binaires, simplistes, péremptoires et font fi de toute réalité culturelle et historique pour pouvoir servir des causes ou des intérêts partisans, je n’en prendrai aucune !
Je me contenterai des observations suivantes :
- Au cours du XIX ième, en France, les obédiences régentant la FM n’ont pas été à l’origine, ni le bras armé de la lutte contre l’esclavage.
- Mais, durant tout le XVIII et le XIX ième siècle, ce combat aura été porté dans un premier temps par des Francs-Maçons les plus illustres comme Brissot, Mirabeau, l’abbé Grégoire, Arago puis ensuite une poignée rassemblée autour de Victor Schoelcher. Tous en sont des acteurs majeurs et en sont devenus les emblèmes.
- Cependant, si leurs implications, surtout dans la dernière phase de l’interdiction de l’esclavage, furent avant tout personnelles, ne soyons pas naïfs ; leurs travaux et leur présence ont dû lentement irradier l’obédience.
Alors, au-delà des hommes, quelle a été la part de l’obédience dans ce combat ?
Pour en apprécier objectivement sa juste place, il serait judicieux de poursuivre notre étude :
- En analysant l’importance de la FM dans la conduite politique de la France entre 1770 et 1850 et plus particulièrement durant les révolutions de1830 et 1848.
- En précisant l’implication et l’importance des Francs-maçons dans la société française et en vérifiant leur influence dans les changements culturels et sociaux et surtout « leurs capacités opérationnelles », au plus haut niveau de l’Etat, dans les prises des décisions politiques.
- En étudiant comment le courant libéral s’est développé tous au long de ces périodes et vérifier s’il a lentement innervé toute la Franc-Maçonnerie ou si c’est cette dernière qui l’a nourri ?
- En comprenant comment la Franc-Maçonnerie française, étroitement liée avec les FM anglaise et américaine a pu subir ou non leurs influences.
- Enfin, il conviendra d’analyser le déroulement des conflits entre les Paris et les Provinces. Ils ont, en permanence, fracturé l’obédience et ont été une partie constitutive de la vie maçonnique durant tout le XIX ième siècle. Il est certain ces luttes intestines étaient nourries par la défense d’intérêts et ceux issus de l’esclavage ne devaient pas être des moindres.
Le travail ne s’arrête jamais.
J’ai dit V. M.
D.F.
[1] [1] Les verbes conserver, servir, ... viennent également du mot Servus.
[2] Des fraternelles ?
[3] Rappel : Les chambres étaient élues au suffrage censitaire.
NOVEMBRE 6022
Travaux de Loge sur l'œuvre de Jean-Michel Oughourlian
EXTRAIT DE
PSYCHOPOLITIQUE
JEAN-MICHEL OUGHOURLIAN
Entretiens avec Trevor Cribben Merrill
Chapitre 4 LA RIVALITÉ MIMÉTIQUE À L’ÉCHELLE DES NATIONS
T.M : Cet abord psychopolitique des problèmes, qui se posent au monde d’aujourd’hui, est-il totalement nouveau ou bien peut-on le retrouver chez des auteurs plus anciens
?
J-M.O : Je crois que l’on peut voir dans La psychologie des foules de Gustave Le Bon un pas dans cette direction. Ce qu’il appelle l’âme de la foule, ce comportement
d’une foule réagissant d’un même mouvement conduit à concevoir une foule ou une nation comme une entité psychologique. Freud reprend les idées de Le Bon dans son ouvrage Psychologie collective et
analyse du moi. Il confirme les intuitions de Le Bon, les enrichit d’une analyse du leader comme idéal du moi et pousse la hardiesse jusqu’à écrire : « l’hypnose est une foule à deux. » Les
intuitions d’Elias Canetti dans son livre Masse et puissance vont dans le même sens. Le psychanalyste René Laforgue fait un pas de plus dans son livre Psycho-pathologie de l’échec. Dans
l’avant-propos de l’édition de 1950 il écrit : « La psychopolitique serait à la conscience collective ce que la psychanalyse est à la conscience individuelle » et dans l’avant-propos de son livre sur
Talleyrand (1944) il précise : « La psychopolitique devrait nous permettre de traiter les conflits collectifs avec les armes qui nous servent aujourd’hui à combattre les conflits individuels des
névroses. » Les travaux de René Girard permettent à mon avis au psychologique et au politique de s’éclairer mutuellement et c’est cet enrichissement de l’un par l’autre qui me paraît
prometteur.
T.M : Dans son livre Théorie des après-guerres, le philosophe allemand Peter Sloterdijk rejoint les intuitions de Freud : parlant des rapports franco-allemands restaurés
par De Gaulle et Adenauer, il écrit : « … pendant les entretiens entre ces deux grands et vieux hommes, commença à se dénouer cette prise mortelle qui avait lié les deux peuples depuis la quasi
bataille de Valmy, en septembre 1792, par une forme politique de magnétisme animal. » Si je me réfère à vos propres travaux sur l’hypnose et le magnétisme animal, la phrase suivante de Sloterdijk
fait écho de façon encore plus sonore à celle de Freud : « Depuis, les étincelles d’une hypnose réciproque n’ont cessé de jaillir entre Français et Allemands, devenant peu à peu pour l’autre camp, ce
que René Girard… a décrit comme l’unité du “modèle” et du “repoussoir”. »
J-M.O : Nous voici au coeur de la psychopolitique : Français et Allemands, en tant que nations composées de millions d’individus, se comportent comme deux « personnes »,
deux entités psychologiques, dont la fascination mutuelle remonte à la fascination mimétique et rivale de Clausewitz à l’égard de Napoléon. Clausewitz, comme le rappelle René Girard, est fasciné par
Napoléon. Les auteurs cités diraient qu’il est hypnotisé par lui. Je ne le pense pas en ce sens que j’ai montré dans d’autres ouvrages que dans l’hypnose, le modèle reste modèle. Or, Clausewitz prend
Napoléon comme rival. Il s’agit d’une rivalité absolue qui glisse peu à peu de l’avoir à l’être même du modèle : Clausewitz veut détruire l’avoir de Napoléon, le battre et au delà battre les armées
françaises futures. Mais il veut plus : il veut être Napoléon et à la limite le déposséder de son être même pour se l’approprier : « Je suis le vrai Napoléon, car moi, j’aurais gagné la bataille de
France en poursuivant Blucher (le prussien), seul ennemi valable et redoutable, au lieu de me lancer contre Schwartzenberg, l’autrichien sans intérêt ! » Le ressentiment de Clausewitz à l’égard de
Napoléon est profond et à la limite du délire : il affirme d’une certaine manière que le vrai génie napoléonien, l’être même de son modèle lui appartiennent car lui, n’aurait pas perdu la guerre ! Il
y a là une attitude mimétique que la psychologie interdividuelle peut éclairer d’un jour nouveau : l’imitateur, le disciple en veut au modèle divinisé de ne pas manifester sa divinité par la
victoire. S’il veut se subs-tituer à lui, lui arracher son être, c’est pour apporter la preuve que son modèle était vraiment divin ! Clausewitz ramasse l’être terrassé de son « Dieu de la guerre »
pour le réhabiliter. Nous saisissions ici l’unicité du mimétisme et de la rivalité et le glissement inévitable de la mimésis d’appropriation de l’avoir vers l’être même du modèle. Certains écrits
font la même analyse à propos de Judas : il n’aurait pas « trahi » Jésus au sens péjoratif de ce mot. Convaincu de la divinité de son modèle, il aurait voulu en le livrant le forcer en quelque sorte
à révéler sa nature divine, sa puissance. Son suicide alors ne serait pas dû au repentir mais à la déception.
T.M : Pour Sloterdijk, ce que René Girard et vousmême à l’instant dites de Clausewitz et de la « montée aux extrêmes » entre l’Allemagne et la France est encore plus
général. Il écrit en effet que si Napoléon a « joué un rôle fatidique, c’est bien plus parce qu’il a établi un modèle qui a fait date, celui du politicien de génie qui, de manière fatale, précisément
en raison de ses succès éclatants, a semé les graines du ressentiment et d’une rivalité imitatrice nourrie par un mélange d’amour et de haine, et ce, dans tous les pays européens qu’il a attaqués, de
l’Atlantique jusqu’à l’Oural ».
J-M.O : Ce qui me paraît intéressant ici, du point de vue psychopolitique, c’est l’assimilation, l’identification d’un homme, d’un chef, d’un leader, à une nation. Le «
ressentiment » et la « rivalité imitatrice » dont parle Sloterdijk ne s’adressent plus depuis longtemps à la personne de Napoléon, mais à la France et aux Français. Ceci signifie d’une part que la
nation est personnifiée par son leader et qu’aux yeux de ses rivaux il y a peu de distinction entre les deux et, d’autre part, que c’est celui que son leader a entraîné à écraser les autres, qui doit
tenter de cicatriser leurs blessures narcissiques. Si les Français doivent être attentifs à cet aspect dans leur comportement en Europe, les Allemands de leur côté font des efforts incessants pour «
racheter » les crimes de Hitler.
T.M : Si je comprends bien, les leaders sont responsables des actes de leur nation et les nations responsables des actes de leurs leaders ?
J-M.O : Oui, mais le plus souvent pas au même mo ment. C’est pourquoi Sloterdijk analyse le com - portement des nations dans les après-guerres lorsque, après la « montée
aux extrêmes », le calme revenu permet de réfléchir. Il écrit : « […] une culture, après avoir livré ses batailles, a l’occasion de réévaluer ses états d’esprit normatifs fondamentaux – on pourrait
aussi dire sa gram-maire morale – à la lumière des résultats du combat et, le cas échéant, de les réviser. En cas de victoire, les valeurs essentielles de ce travail de vérification portent le nom
d’“affirmation”, en cas de défaite, celui de métanoïa5. » Dans les deux cas, la grandeur du politique se mesure à ses réactions et la leçon psychopolitique à en tirer est que cette grandeur a les
mêmes caractères pour le leader, pour la nation et pour l’individu. En cas de victoire en effet le politique doit à tout prix éviter d’en abuser, pour ne pas tomber dans ce que les Grecs appelaient
l’hubris. La sagesse politique consiste à consolider la paix en sauvant la face de l’ennemi battu et en tâchant d’effacer en lui le res-sentiment en s’abstenant de l’humilier ou de le mépriser. De la
même façon, l’individu qui vient de recevoir une grande promotion ou de gagner beaucoup d’argent doit en quelque sorte se faire « pardonner » son succès en adoptant un « low profile » et en
valorisant ceux qu’il est appelé à diriger. Quant aux vaincus, ils doivent analyser lucidement les raisons de leur défaite et en tirer les conséquences. Évitant le ressentiment stérile, ils doivent
procéder à ce que Sloterdijk appelle une métanoïa, c’est-à-dire un « réapprentissage séculier au service d’une capacité supérieure de civilisation ». De la même façon l’échec individuel doit
déboucher sur une transformation, un apprentissage nouveau afin d’éviter de tomber dans la névrose d’échec ou la dépression.
T.M : Dans ces temps de mondialisation, que pensez-vous du « lien entre l’analyse mimétologique et l’analyse médiologique » que Sloterdijk juge indispensable d’établir
?
J-M.O : Je pense que ce lien est inévitable en effet. Les médias, les journaux, la télévision, Internet, ont transformé le monde en un grand village comme l’a bien vu
Marshal McLuhan, l’écran ayant remplacé l’agora, la place centrale du village ou de la ville. Observons d’abord que l’avalanche médiatique multiplie les effets mimétiques individuels dans des
proportions phénoménales. La mode par exemple n’est plus nationale, mais mondiale et il se vend plus de sacs Vuitton à Tokyo ou à Shanghai qu’à Paris. Cette mondialisation a un effet positif et un
autre qui me paraît négatif en ce qui concerne la paix dans le monde : – L’effet positif vient du fait que les informations sont si débordantes que les nations n’ont pas le temps d’être fascinées les
unes par les autres. Un début de fascination ou de simple intérêt est vite balayé sous une avalanche d’informations et d’images venant d’autres parties du monde. Ceci explique aussi la difficulté
actuelle ou la quasi impossibilité du politique à désigner un ennemi crédible et à entraîner à son égard la passion de la nation, celle-ci ayant déjà « zappé » et étant passée à autre chose. –
L’effet négatif est que, du coup, ce sont les nations elles-mêmes qui réagissent en direct et « comme un seul homme » aux nouvelles qu’on leur apporte et ce sont elles qui risquent de « monter aux
extrêmes », cependant que leurs dirigeants essaient de les calmer. Voyez par exemple les pays arabes et les pays musul-mans en général prenant les Américains pour modèles : ils ne regardent que les
séries et les films américains, s’habillent (dès qu’ils le peuvent) à l’américaine, en blue-jeans et baskets, ne boivent que du Coca-Cola, s’informent sur CNN et sont les derniers qui achètent encore
des voitures américaines. Et que se passe-t-il ? Ils souffrent du dépit amoureux, ne comprenant pas pourquoi leur amour n’est pas payé de retour et pourquoi par exemple les Américains leur préfèrent
leurs rivaux Israéliens. Ils sont en fait mortellement jaloux des Israé-liens à la manière dont un homme est jaloux de voir la femme qu’il aime dans les bras d’un autre. Cette jalousie, ce dépit
amoureux et ce ressentiment sont à mon avis un des facteurs essentiels de la montée de l’islamisme dans les masses que leurs dirigeants « modérés » et soutenus par les États-Unis, essaient de tenir
tranquilles. Les russes sont dans une situation analogue, mais encore pire. En effet ils sont d’abord humiliés de ne plus être une grande puissance, de ne plus être l’égale des États-Unis. Mais de
plus, fascinés eux aussi par le modèle américain, ils pensaient que, s’étant débarrassé du communisme, plus rien ne s’opposerait au développement de leurs relations amoureuses avec les États-Unis.
Ils s’attendaient à voir ceux-ci accourir pour les aider avec un plan Marshall encore plus extraordinaire que le premier. Or ils ont été déçus et leur dépit amoureux est à la mesure de cette
déception : les Américains – à leur grande surprise – ne les aimaient pas pour eux-mêmes ! Ils venaient les dépouiller et, avec l’aide des oligarques, faire main basse sur leurs richesses, leurs
industries, leurs entreprises, et ceci à des prix dérisoires. D’où la réaction et la politique de Poutine qui utilise toutes les techniques de la psychopolitique pour leur remonter le moral, les
consoler de leur déception sentimentale et leur rendre l’estime d’eux-mêmes. Il a fort à faire car il doit lutter contre leurs symptômes dépressifs : la vodka, le découragement et la nostalgie
stérile pour une grandeur passée. Il ne suffit donc pas d’apaiser la colère d’un Prince aujourd’hui ou de le séduire. Le politique a une tâche bien plus ardue : apaiser les ressentiments et les
rivalités mimétiques des nations qui vivent en direct sur l’écran de la télévision leurs humiliations et leurs ressentiments et qui regardent en live leurs modèles se transformer en rivaux. Cela dit,
il ne faut évidemment pas négliger le rôle politique des médias. Le politique doit absolument en tenir compte et le rêve de tout politique est de contrôler les médias de son pays à la façon dont
Berlusconi contrôle la plupart des chaînes de télévision italiennes, parce qu’elles lui appartiennent. Poutine, de son côté, contrôle les médias russes par des moyens plus directs. Dans les
démocraties occidentales, il y a des médias « pour » et des médias « contre » le pouvoir. Elles s’équilibrent à peu près sauf lorsque pour une cause politiquement correcte elles se rejoignent pour
matraquer ensemble le public sur le même thème. On disait au grand homme de presse britannique Robert Maxwell qu’il était un homme de pouvoir, représentant ce quatrième pouvoir qu’était la presse. Il
répondit : « Non, mieux qu’un homme de pouvoir, je suis un homme d’influence ! » Ceci prouve à quel point le rôle des médias peut être dangereux : l’influence, en effet, c’est tout simplement le
pouvoir sans la responsabilité. Dans nos démocraties occidentales, les médias inter-fèrent de plus en plus avec la politique et posent au politique un problème nouveau que Milan Kundera dans son
livre L’immortalité appelle l’imagologie. Il écrit en effet : « L’homme politique dépend du journaliste. Mais de qui dépendent les journalistes ? De ceux qui les paient. Et ceux qui les paient, ce
sont les agences de publicité. » L’imagologie c’est le règne de l’image qui marque un homme politique ou un événement, le résume et le caractérise pour toujours. Kundera pense que l’image a aussi
remplacé la doctrine politique : « On peut à juste titre parler d’une transformation progressive, générale et planétaire de l’idéologie en imagologie. » Le danger pour le politique et le nouveau défi
qu’il doit relever c’est que « l’imagologie est plus forte que la réalité ». Or nous avons dit et nous redirons à quel point la juste vision de la réalité est cruciale en politique comme en
psychologie. Le politique moderne a donc à tenir compte dans les pays démocratiques de cette réalité nouvelle : « Les sondages d’opinion sont l’instrument décisif du pouvoir imagologique. » Kundera,
lui aussi, s’inquiète de ce que la réalité soit perdue de vue : « Comme la réalité, aujourd’hui, est un continent qu’on visite peu et qu’à juste titre d’ailleurs on n’aime guère, le sondage est
devenu une sorte de réalité supérieure ; ou pour le dire autrement, il est devenu la vérité. » Ce phénomène est dangereux. Il complique la tâche déjà ardue du politique. Kundera résume ainsi la
situation : « L’homme politique dépend du journaliste. Et les journalistes dépendent de qui ? Des imagologues. »
T.M : Vous avez raison, et Kundera aussi, d’insister sur le rôle de la presse et des images. En ce moment la presse monte en épingle les élections iraniennes et la
révolte populaire qui semble prendre de l’ampleur. À ce propos, que penser de la course aux armements et du désir des pays comme l’Iran de se doter de l’arme atomique ?
J-M.O : Le pouvoir iranien exploite le ressentiment de son peuple. Celui-ci souffre également de dépit amoureux à l’égard des États-Unis et de l’Occident en général.
Sous le Tchador il y a le blue-jean, le sac Hermès, le T-shirt. Dans les réunions mondaines, ils boivent du Coca-Cola ou du whisky, mais le pouvoir cherche à faire croire qu’il est en train de
développer une contre-culture, une culture rivale de celle des ÉtatsUnis et complètement différente. Cette illusion ayant fait long feu, le pouvoir iranien mobilise la fierté d’un peuple millénaire
et trouve dans l’arme atomique le moyen de défendre son honneur et de se faire respecter. À défaut d’être aimés par ceux que nous admirons, au moins soyons respectés par eux, forçons les à tenir
compte de nous. Il suffit de voir que la réponse iranienne à toutes les ouvertures d’Obama pour un dialogue est toujours : « Oui, mais d’abord le respect ! » Et la théocratie iranienne considère – et
s’efforce de persuader son peuple – que l’interdiction qui lui est faite d’avoir l’arme atomique est une marque de mépris inacceptable et une atteinte à l’honneur de la nation. Le politique iranien
utilise l’arme atomique comme un « signe extérieur de pouvoir » et comme un test du respect que lui porte l’Occident. La bombe est aussi utilisée comme le ciment de la nation, le politique désignant
comme ennemi tout pays, tout pouvoir s’opposant à l’acquisition de la bombe atomique par l’Iran. Aussi le politique trouve-t-il sa justification puisqu’il n’a pas à désigner l’ennemi. L’ennemi se
désigne lui-même et se définit comme toute personne ou nation qui s’oppose à l’armement nucléaire de l’Iran, c’est-à-dire qui le méprise et bafoue son honneur. Ceci est une technique « indirecte » de
désignation de l’ennemi qui vérifie une fois de plus et de manière originale, la définition de Carl Schmitt. Et les ayatollahs auxquels les diplomates expriment leur inquiétude répondent comme les
amoureux : « Il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour – si vous nous aimez, respectez-nous et si vous nous respectez, faites nous confiance : nous n’utiliserons pas la bombe atomique,
pas plus que vous ne l’utilisez. Mais si vous nous la refusez nous considérons que c’est un signe de mépris et de défiance qui est insupportable. » Tant que l’Occident n’aura pas déminé ce problème
sentimental, il ne pourra pas désolidariser le peuple iranien de sa théocratie. Tout l’art de la psychopolitique est ici à l’épreuve des faits. La question de la fierté et de la réussite se pose
finalement de la même façon au niveau de l’individu et au niveau de la nation. Récemment, Jacques Séguéla déclarait dans une émission de télévision : « Celui qui, à 50 ans, n’a pas encore de Rolex a
raté sa vie. » Je pense que les Iraniens en tant que peuple, raisonnent de la même façon : « Quoi, nous les Perses, après 2 500 ans d’une histoire prestigieuse, nous n’avons pas la puissance
nucléaire ? Nous avons donc raté notre rendezvous avec l’Histoire ! »
T.M : Si je vous comprends bien, la rivalité mimétique obéit aux mêmes lois à l’échelle des individus et à l’échelle des nations. Un leader peut « monter aux extrêmes »
contre un autre et entraîner sa nation derrière lui mais une nation peut aussi « monter aux extrêmes », entraînant les dirigeants ou les renversant s’ils ne suivent pas.
J-M.O : Absolument. Et la mondialisation est apaisante tant elle saoule les populations sous une avalanche d’informations qui s’annulent les unes les autres, mais elle
peut être très dangereuse lorsqu’elle met sous les yeux des masses ce que les autres ont et qu’elles n’ont pas.
VIE ET MORT DES CIVILISATIONS
Gustave
Le Bon
Psychologie des foules
1895
Quand l'édifice d'une civilisation est vermoulu, ce sont toujours les foules qui en amènent l'écroulement.
Gustave Le Bon 1841-1931
Médecin, anthropologue, psychologue, sociologue
Né en 1841 à Nogent-le-Rotrou, où son père, Jean Marie Charles Le Bon, est conservateur des hypothèques, Gustave Le Bon fait ses études au lycée de Tours. Il entre ensuite à la faculté de médecine de Paris.
Il parcourt l’Europe, l'Asie et l'Afrique du Nord entre les années 1860 et 1804. Il écrit des récits de voyage, des ouvrages d’archéologie et d’anthropologie sur les civilisations de l’Orient et participe au comité d'organisation des expositions universelles. En 1879, il fait une entrée remarquée au sein de la Société d'anthropologie de Paris qui lui décerne l’année suivante le prix Godard.
En 1888, il démissionne et rompt tout contact avec cette société peu ouverte à ses approches psycho-sociologiques novatrices ; pour lui, « il n'y a pas de races pures dans les pays civilisés » et il entend le terme de « race », à l'instar de Taine ou Renan, comme un synonyme de « peuple », c'est-à-dire « un agrégat d'hommes appartenant au même milieu et partageant la même culture (langue, tradition, religion, histoire, coutumes vestimentaires, alimentaires, etc.) ».
« Les classifications uniquement fondées sur la couleur de la peau ou sur la couleur des cheveux n'ont guère plus de valeur que celles qui consisteraient à classer les chiens d'après la couleur ou la forme des poils, divisant, par exemple, ces derniers en chiens noirs, chiens blancs, chiens rouges, chiens frisés, etc. »
Au chapitre de la colonisation, Le Bon partage avec l’anthropologue Armand de Quatrefages une position hétérodoxe : le rôle de la puissance colonisatrice devait se borner à maintenir la paix et la stabilité, à prélever un tribut, à nouer ou à développer des relations commerciales, mais en aucun cas ne doit s’arroger le droit d’imposer sa civilisation à des populations réticentes. Le Bon ne soutient pas la théorie d’une hiérarchisation des civilisations, mais admet des différences au niveau des stades de développement.
Son premier grand succès de librairie en sciences sociales est la publication en 1894 des Lois psychologiques de l'évolution des peuples, ouvrage qui se réfère aux lois de l'évolution darwinienne en les étendant de la physiologie à la psycho-sociologie.
Psychologie sociale
En 1895, il publie son oeuvre principale, Psychologie des foules.
A partir de grands événements historiques, il décrit l'action des hommes par le seul fait qu'ils sont en groupe. Les principes qu'il expose dans cet ouvrage formeront les bases d'une nouvelle discipline scientifique : la psychologie sociale.
Un parallèle peut être fait entre Le Bon et Machiavel. Le Prince comme Psychologie des foules sont des œuvres que l’on pourrait qualifier de cyniques car elles décrivent des phénomènes (l’art de diriger les peuples ou celui de dominer une foule) de manière crue, sans connotation morale.
Elles furent reçues par leurs lecteurs comme des alertes pour prévenir les mauvais gouvernements (Le Prince) ou les dérives populistes et révolutionnaires (Psychologie des foules)
Elles furent aussi utilisées comme des manuels à l’usage de ceux qui les appliquent pour asservir et manipuler.
Le Bon soutient dès 1924 que la montée du fascisme en Italie n'était pas un phénomène isolé mais risquait au contraire de s’étendre, par le même mécanisme d’un meneur de foules prenant, à la faveur d’événements violents, les rênes du pouvoir et les confisquant ensuite à son seul profit.
Il est connu pour avoir été le premier penseur ayant discerné le danger de la mystique de la supériorité de la race aryenne et condamné par avance la montée du nazisme : « L’Allemand moderne est plus dangereux encore par ses idées que par ses canons »,
« Le dernier des Teutons reste convaincu de la supériorité de sa race et du devoir, qu’en raison de cette supériorité, il a d’imposer sa domination au monde. Cette conception donne évidemment à un peuple une grande force. Il faudra peut-être une nouvelle série de croisades pour la détruire. »
« Les peuples ne se résignent pas à la défaite quand ils se croient supérieurs à leurs vainqueurs. Une tentative de revanche germanique peut donc être considérée comme un des plus sûr événements de la future Histoire. »
Etude des phénomènes révolutionnaires
PSYCHOLOGIE DES FOULES, citations :
« La foule psychologique est un être provisoire, formé d'éléments hétérogènes qui pour un instant se sont soudés, absolument comme les cellules qui constituent un corps vivant forment par leur réunion un être nouveau manifestant des caractères fort différents de ceux que chacune de ces cellules possède »
« Quels que soient les sentiments, bons ou mauvais, manifestés par une foule, ils présentent ce double caractère d'être très simples et très exagérés. Sur ce point, comme sur tant d'autres, l'individu en foule se rapproche des êtres primitifs. Inaccessible aux nuances, il voit les choses en bloc et ne connaît pas les transitions... La simplicité et l'exagération des sentiments des foules font que ces dernières ne connaissent ni le doute ni l'incertitude. Elles vont tout de suite aux extrêmes. Le soupçon énoncé se transforme aussitôt en évidence indiscutable. Un commencement d'antipathie ou de désapprobation, qui, chez l'individu isolé, ne s'accentuerait pas, devient aussitôt haine féroce chez l'individu en foule »
« Les idées n'étant accessibles aux foules qu'après avoir revêtu une forme très simple, doivent, pour devenir populaires, subir souvent les plus complètes transformations. C'est surtout quand il s'agit d'idées philosophiques ou scientifiques un peu élevées, qu'on peut constater la profondeur des modifications qui leur sont nécessaires pour descendre de couche en couche jusqu'au niveau des foules. Ces modifications... sont toujours amoindrissantes et simplifiantes. Et c'est pourquoi, au point de vue social, il n'y a guère, en réalité, de hiérarchie des idées, c'est-à-dire d'idées plus ou moins élevées. Par le fait seul qu'une idée arrive aux foules et peut agir, si grande ou si vraie qu'elle ait été à son origine, elle est dépouillée de presque tout ce qui faisait son élévation et sa grandeur. D'ailleurs, au point de vue social, la valeur hiérarchique d'une idée est sans importance.»
« De même que pour les êtres chez qui le raisonnement n'intervient pas, l'imagination représentative des foules est très puissante, très active, et susceptible d'être vivement impressionnée. Les images évoquées dans leur esprit par un personnage, un événement, un accident, ont presque la vivacité des choses réelles. Les foules sont un peu dans le cas du dormeur dont la raison, momentanément suspendue, laisse surgir dans l'esprit des images d'une intensité extrême, mais qui se dissiperaient vite si elles pouvaient être soumises à la réflexion. Les foules, n'étant capables ni de réflexion ni de raisonnement, ne connaissent pas l'invraisemblable : or, ce sont les choses les plus invraisemblables qui sont généralement les plus frappantes. »
« Ce n'est pas le besoin de la liberté, mais celui de la servitude qui domine toujours dans l'âme des foules. Elles ont une telle soif d'obéir qu'elles se soumettent d'instinct à qui se déclare leur maître »
Influence
Le Bon participe activement à la vie intellectuelle française. En 1902, il crée la Bibliothèque de philosophie scientifique chez Flammarion, qui est un vrai succès d'édition, avec plus de 220 titres publiés et plus de deux millions de livres vendus à la mort de Le Bon en 1931. À partir de 1902 il organise une série de « déjeuners du mercredi » auxquels sont conviées des personnalités telles que Henri et Raymond Poincaré, Paul Valéry, Émile Picard, Camille Saint-Saëns, Marie Bonaparte, Aristide Briand, Henri Bergson, la comtesse Greffulhe, icône de la Belle-Époque et inspiratrice de Proust pour À la recherche du temps perdu.
En 2010, Psychologie des foules est choisi par Le Monde et Flammarion comme l'un des « 20 livres qui ont changé le monde ».
Les idées contenues dans Psychologie des foules jouèrent un rôle important au début du XXe siècle.
Si les praticiens du totalitarisme, Mussolini, Hitler, Staline et Mao, passent pour s'être inspirés (ou plus exactement, avoir détourné les principes) de Gustave Le Bon, beaucoup de républicains – Roosevelt, Clemenceau, Poincaré, Churchill, de Gaulle, etc. – s'en sont également inspirés.
Roosevelt « Je n'eus l’occasion de le rencontrer (Roosevelt) que deux mois avant la guerre, à un déjeuner qui lui était offert par mon éminent ami, Hanotaux, ancien ministre des Affaires étrangères. M. Roosevelt avait désigné lui-même les convives qu'il désirait voir à ses côtés. […] Après avoir parlé du rôle des idées dans l'orientation des grands conducteurs de peuples, Roosevelt, fixant sur moi son pénétrant regard, me dit d'une voix grave : — Il est un petit livre qui ne m'a jamais quitté dans tous mes voyages et qui resta toujours sur ma table pendant ma présidence. Ce livre est votre volume : Lois psychologiques de l'évolution des peuples. »
Charles de Gaulle emprunte dans son livre à la gloire de « l'homme de caractère » (Le Fil de l'épée) l'essentiel des thèses de Le Bon, tendant notamment à considérer la suggestion comme le fait élémentaire et irréductible expliquant tous les mystères de la domination.
Dans son ouvrage Psychologie collective et analyse du moi, paru en 1921, Freud s’appuie sur une lecture critique de Psychologie des foules, il y mentionne les travaux de Le Bon notamment sur « les modifications du Moi lorsqu’il est au sein d’un groupe agissant », et écrit « je laisse donc la parole à M. Le Bon. »
VIE ET MORT DES CIVILISATIONS
LA CONCLUSION DE PSYCHOLOGIE DES FOULES
« La création incessante de lois et de règlements restrictifs entourant des formalités les plus byzantines les moindres actes de la
vie, a pour résultat fatal de rétrécir progressivement la sphère dans laquelle les citoyens peuvent se mouvoir librement.
Victimes de cette illusion qu'en multipliant les lois, l'égalité et la liberté se trouvent mieux assurées, les peuples acceptent chaque jour de plus pesantes entraves. Ce n'est pas impunément qu'ils les acceptent.
Habitués à supporter tous les jougs, ils finissent bientôt par les rechercher, et, perdre toute spontanéité et toute énergie. Ce ne sont plus que des ombres vaines, des automates passifs, sans volonté, sans résistance et sans force.
Mais les ressorts qu'il ne trouve plus en lui-même, l'homme est alors bien forcé de les chercher ailleurs. Avec l'indifférence et l'impuissance croissantes des citoyens, le rôle des gouvernements est obligé de grandir encore. Il leur faut tout entreprendre, tout diriger, tout protéger.
L'État devient alors un dieu tout-puissant. Mais l'expérience enseigne que le pouvoir de telles divinités ne fut jamais ni bien durable ni bien fort.
La restriction progressive de toutes les libertés chez certains peuples, malgré une licence qui leur donne l'illusion de les posséder, semble résulter de leur vieillesse tout autant que d'un régime quelconque. Elle constitue un des symptômes précurseurs de cette phase de décadence à laquelle aucune civilisation n'a pu échapper jusqu'ici.
Si l'on en juge par les enseignements du passé et par des symptômes éclatant de toutes parts, plusieurs de nos civilisations modernes sont arrivées à la période d'extrême vieillesse qui précède la décadence. Certaines évolutions semblent fatales pour tous les peuples, puisque l'on voit si souvent l'histoire en répéter le cours.
Il est facile de marquer sommairement les phases de ces évolutions. C'est avec leur résumé que se terminera notre ouvrage.
Si nous envisageons dans leurs grandes lignes la genèse de la grandeur et de la décadence des civilisations qui ont précédé la nôtre, que voyons-nous ?
A l'aurore de ces civilisations, une poussière d'hommes, d'origines variées, réunie par les hasards des migrations, des invasions et des
conquêtes. De sangs divers, de langues et de croyances également diverses, ces hommes n'ont de lien commun que la loi à demi reconnue d'un chef.
Dans leurs agglomérations confuses se retrouvent au plus haut degré les caractères psychologiques des foules. Elles en ont la cohésion momentanée, les héroïsmes, les faiblesses, les impulsions et les violences. Rien de stable en elles. Ce sont des barbares.
Puis le temps accomplit son œuvre. L'identité de milieux, la répétition des croisements, les nécessités d'une vie commune agissent
lentement. L'agglomération d'unités dissemblables commence à se fusionner et à former une race, c'est-à-dire un agrégat possédant des caractères et des sentiments communs, que l'hérédité fixera
progressivement. La foule est devenue un peuple, et ce peuple va pouvoir sortir de la barbarie.
Il n'en sortira tout à fait pourtant que lorsque après de longs efforts, des luttes sans cesse répétées et d'innombrables recommencements,
il aura acquis un idéal. Peu importe la nature de cet idéal. Que ce soit le culte de Home, la puissance d'Athènes ou le triomphe d'Allah, il suffira pour doter tous les individus de la race en voie
de formation d'une parfaite unité de sentiments et de pensées.
C'est alors que peut naître une civilisation nouvelle avec ses institutions, ses croyances et ses arts. Entraînée par son rêve, la race
acquerra successivement tout ce qui donne l'éclat, la force et la grandeur. Elle sera foule encore sans doute à certaines heures, mais, derrière les caractères mobiles et changeants des foules, se
trouvera ce substratum solide, l'âme de la race, qui limite étroitement les oscillations d'un peuple et règle le hasard.
Mais, après avoir exercé son action créatrice, le temps commence cette oeuvre de destruction à laquelle n'échappent ni les dieux ni les
hommes. Arrivée à un certain niveau de puissance et de complexité, la civilisation cesse de grandir, et, dès qu'elle ne grandit plus, elle est condamnée à décliner rapidement. L'heure de la
vieillesse va sonner bientôt.
Cette heure inévitable est toujours marquée par l'affaiblissement de l'idéal qui soutenait l'âme de la race. A mesure que cet idéal pâlit,
tous les édifices religieux, politiques ou sociaux dont il était l'inspirateur commencent à s'ébranler.
Avec l'évanouissement progressif de son idéal, la race perd de plus en plus ce qui faisait sa cohésion, son unité et sa force. L'individu
peut croître en personnalité et en intelligence, mais en même temps aussi l'égoïsme collectif de la race est remplacé par un développement excessif de l'égoïsme individuel accompagné de
l'affaissement du caractère et de l'amoindrissement des aptitudes à l'action.
Ce qui formait un peuple, une unité, un bloc, finit par devenir une agglomération d'individus sans cohésion et que maintiennent artificiellement pour quelque temps encore les traditions et les institutions.
C'est alors que divisés par leurs intérêts et leurs aspirations, ne sachant plus se gouverner, les hommes demandent à être dirigés dans leurs moindres actes, et que l'État exerce son influence absorbante.
Avec la perte définitive de l'idéal ancien, la race finit par perdre aussi son âme. Elle n'est plus qu'une poussière d'individus isolés et
redevient ce qu'elle était à son point de départ : une foule.
Elle en présente tous les caractères transitoires sans consistance et sans lendemain. La civilisation n'a plus aucune fixité et tombe à la merci de tous les hasards. La plèbe est reine et les barbares avancent. La civilisation peut sembler brillante encore parce qu'elle conserve la façade extérieure créée par un long passé, mais c'est en réalité un édifice vermoulu que rien ne soutient plus et qui s'effondrera au premier orage.
Passer de la barbarie à la civilisation en poursuivant un rêve, puis décliner et mourir dès que ce rêve a perdu sa force, tel est le cycle de la vie d'un peuple. »
COMMENTAIRES DU CONFERENCIER
LES CIVILISATIONS ASCENDANTES
LA CHINE l’irrésistible ascension
LES CIVILISATIONS RESILIANTES
LA RUSSIE éternelle puissance
ISRAEL citadelle assiégée
l’IRAN vive les sanctions
LES CIVILISATIONS DECLINANTES
LES ETATS UNIS « pour résister soyons barbares »
L’EUROPE « après moi le déluge »
Fin de la conférence
ANNEXES
EXTRAITS PSYCHOLOGIE DES FOULES
L’ochlocratie (du grec ancien ὀχλοκρατία / okhlokratía, via le latin :
ochlocratia) est un régime politique dans lequel la foule (okhlos) a le pouvoir d'imposer sa volonté « Gouvernement par la foule, la multitude, la populace »
Ochlocratie n'est pas un synonyme de démocratie au sens de gouvernement par le peuple. Le terme foule, non le terme peuple, est employé ː il suggère dans un sens péjoratif la foule en tant que masse
manipulable ou passionnelle.
Exagération et simplisme des sentiments des foules
Les sentiments, bons ou mauvais, manifestés par une foule, présentent ce double caractère d'être très simples et très exagérés. Sur ce point, comme sur tant d'autres, l'individu en foule se rapproche
des êtres primitifs. Inaccessible aux nuances, il voit les choses en bloc et ne connaît pas les transitions. Dans la foule, l'exagération d'un sentiment est fortifiée par le fait que, se propageant
très vite par voie de suggestion et de contagion, l'approbation dont il devient l'objet accroît considérablement sa force.
La simplicité et l'exagération des sentiments des foules les préservent du doute et de l'incertitude. Comme les femmes, elles vont tout de suite aux extrêmes. Le soupçon énoncé se transforme aussitôt
en évidence indiscutable. Un commencement d'antipathie ou de désapprobation, qui, chez l'individu isolé, resterait peu accentué, devient aussitôt une haine féroce chez l'individu en foule.
La violence des sentiments des foules est encore exagérée, dans les foules hétérogènes surtout, par l'absence de responsabilité. La certitude de l'impunité, d'autant plus forte que la foule est plus
nombreuse et la notion d'un pouvoir momentané considérable dû au nombre, rendent possibles à la collectivité des sentiments et des actes impossibles à l'individu isolé. Dans les foules, l'imbécile,
l'ignorant et l'envieux sont libérés du sentiment de leur nullité et de leur impuissance, que remplace la notion d'une force brutale, passagère, mais immense.
L'exagération, chez les foules, porte malheureusement souvent sur de mauvais sentiments, reliquat atavique des instincts de l'homme primitif, que la crainte du châtiment oblige l'individu isolé et
responsable à refréner. Ainsi s'explique la facilité des foules à se porter aux pires excès.
Habilement suggestionnées, les foules deviennent capables d'héroïsme et de dévouement. Elles en sont même beaucoup plus capables que l'individu isolé. Nous aurons bientôt occasion de revenir sur ce
point en étudiant la moralité des foules.
La foule n'étant impressionnée que par des sentiments excessifs, l'orateur qui veut la séduire doit abuser des affirmations violentes. Exagérer, affirmer, répéter, et ne jamais tenter de rien
démontrer par un raisonnement, sont les procédés d'argumentation familiers aux orateurs des réunions populaires.
La foule réclame encore la même exagération dans les sentiments de ses héros. Leurs qualités et leurs vertus apparentes doivent toujours être amplifiées. Au théâtre, la foule exige du héros de la
pièce des vertus, un courage, une moralité, qui ne sont jamais pratiqués dans la vie.
On a parlé avec raison de l'optique spéciale du théâtre. Il en existe une, sans doute, mais ses règles sont le plus souvent sans parenté avec le bon sens et la logique. L'art de parler aux foules est
d'ordre inférieur, mais exige des aptitudes toutes spéciales. On s'explique mal parfois à la lecture le succès de certaines pièces. Les directeurs des théâtres, quand ils les reçoivent, sont
eux-mêmes généralement très incertains de la réussite, car pour juger, il leur faudrait se transformer en foule. Si nous pouvions entrer dans les développements, il serait facile de montrer encore
l'influence prépondérante de la race. La pièce de théâtre qui enthousiasme la foule dans un pays reste parfois sans aucun succès dans un autre ou n'obtient qu'un succès d'estime et de convention,
parce qu'elle ne met pas en jeu des ressorts capables de soulever son nouveau publie.
Inutile d'ajouter que l'exagération des foules porte seulement sur les sentiments, et en aucune façon sur l'intelligence. Par le fait seul que l'individu est en foule, son niveau intellectuel, je
l'ai déjà montré, baisse considérablement. M. Tarde l'a égale-ment constaté en opérant ses recherches sur les crimes des foules.
C'est donc uniquement dans l'ordre sentimental que les foules peuvent monter très haut ou descendre, au contraire, très bas.
-------------------
Impulsivité, mobilité et irritabilité des foules
La foule, avons-nous dit en étudiant ses caractères fondamentaux, est conduite presque exclusivement par l'inconscient. Ses actes sont beaucoup plus sous l'influence de la moelle épinière que sous
celle du cerveau. Les actions accomplies peuvent être parfaites quant à leur exécution, mais, le cerveau ne les dirigeant pas, l'individu agit suivant les hasards de l'excitation. La foule, jouet de
tous les stimulants extérieurs, en reflète les incessantes variations. Elle est donc esclave des impulsions reçues. L'individu isolé peut être soumis aux mêmes excitants que l'homme en foule ; mais
sa raison lui montrant les inconvénients d'y céder, il n'y cède pas. On peut physiologiquement définir ce phénomène en disant que l'individu isolé possède l'aptitude à dominer ses réflexes, alors que
la foule en est dépourvue.
Les impulsions diverses auxquelles obéissent les foules pourront être, suivant les excitations, généreuses ou cruelles, héroïques ou pusillanimes, mais elles seront toujours tellement impérieuses que
l'intérêt de la conservation lui-même s'effacera devant elles.
Les excitants susceptibles de suggestionner les foules étant variés, et ces dernières y obéissant toujours, elles sont extrêmement mobiles. On les voit passer en un instant de la férocité la plus
sanguinaire à la générosité ou à l'héroïsme le plus absolu. La foule est aisément bourreau, mais non moins aisément martyre. C'est de son sein qu'ont coulé les torrents de sang exigés pour le
triomphe de chaque croyance. Inutile de remonter aux âges héroïques pour voir de quoi les foules sont capables. Elles ne marchandent jamais leur vie dans une émeute, et il y a peu d'années qu'un
général, devenu subitement populaire, eût facilement trouvé cent mille hommes prêts à se faire tuer pour sa cause.
Rien donc ne saurait être prémédité chez les foules. Elles peuvent parcourir successivement la gamme des sentiments les plus contraires, sous l'influence des excitations du moment. Elles sont
semblables aux feuilles que l'ouragan soulève, disperse en tous sens, puis laisse retomber. L'étude de certaines foules révolutionnaires nous fournira quelques exemples de la variabilité de leurs
sentiments.
Cette mobilité des foules les rend très difficiles à gouverner, surtout lorsqu'une partie des pouvoirs publics est tombée entre leurs mains. Si les nécessités de la vie quotidienne ne constituaient
une sorte de régulateur invisible des événements, les démocraties ne pourraient guère subsister. Mais les foules qui veulent les choses avec frénésie, ne les veulent pas bien longtemps. Elles sont
aussi incapables de volonté durable que de pensée.
La foule n'est pas seulement impulsive et mobile. Comme le sauvage, elle n'admet pas d'obstacle entre son désir et la réalisation de ce désir, et d'autant moins que le nombre lui donne le sentiment
d'une puissance irrésistible. Pour l'individu en foule, la notion d'impossibilité disparaît. L'homme isolé sent bien qu'il ne pourrait à lui seul incendier un palais, piller un magasin ; la tentation
ne lui en vient donc guère à l'esprit. Faisant partie d'une foule, il prend conscience du pouvoir que lui confère le nombre, et à la première suggestion de meurtre et de pillage il cédera
immédiatement. L'obstacle inattendu sera brisé avec frénésie. Si l'organisme humain permettait la perpétuité de la fureur, on pourrait dire que l'état normal de la foule contrariée est la fureur.
Dans l'irritabilité des foules, leur impulsivité et leur mobilité, ainsi que dans tous les sentiments populaires que nous aurons à étudier, interviennent toujours les caractères fondamentaux de la
race. Ils constituent le sol invariable sur lequel germent nos sentiments. Les foules sont irritables et impulsives, sans doute, mais avec de grandes variations de degré. La différence entre une
foule latine et une foule anglo-saxonne est, par exemple, frappante. Les faits récents de notre histoire jettent une vive lueur sur ce point. En 1870, la publication d'un simple télégramme relatant
une insulte supposée suffit pour déterminer une explosion de fureur dont sortit immédiatement une guerre terrible. Quelques années plus tard, l'annonce télégraphique d'un insignifiant échec à Langson
provoqua une nouvelle explosion qui amena le renversement instantané du gouvernement. Au même moment, l'échec beaucoup plus grave d'une expédition anglaise devant Khartoum ne produisit en Angleterre
qu'une faible émotion, et aucun ministre ne fut changé. Les foules sont partout féminines, mais les plus féminines de toutes sont les foules latines. Qui s'appuie sur elles peut monter très haut et
très vite, mais en côtoyant sans cesse la roche Tarpéienne et avec la certitude d'en être précipité un jour.
-------------------
L'autoritarisme et l'intolérance
constituent pour les foules des sentiments très clairs, qu'elles supportent aussi facilement qu'elles les pratiquent. Elles respectent la force et sont médiocrement impressionnées par la bonté, facilement considérée comme une forme de la faiblesse. Leurs sympathies n'ont jamais été aux maîtres débonnaires, mais aux tyrans qui les ont vigoureusement dominées. C'est toujours à eux qu'elles dressent les plus hautes statues. Si elles foulent volontiers à leurs pieds le despote renversé, c'est parce qu'ayant perdu sa force, il rentre dans la catégorie des faibles qu'on méprise et ne craint pas. Le type du héros cher aux foules aura toujours la structure d'un César. Son panache les séduit, son autorité leur impose et son sabre leur fait peur.
Toujours prête à se soulever contre une autorité faible, la foule se courbe avec servilité devant une autorité forte. Si l'action de l'autorité est intermittente, la foule, obéissant toujours à ses
sentiments extrêmes, passe alternativement de l'anarchie à la servitude, et de la servitude à l'anarchie.
Ce serait d'ailleurs méconnaître la psychologie des foules que de croire à la prédominance chez elles des instincts révolutionnaires. Leurs violences seules nous illusionnent sur ce point. Les
explosions de révolte et de destruction sont toujours très éphémères. Elles sont trop régies par l'inconscient, et trop soumises par conséquent à l'influence d'hérédités séculaires, pour ne pas se
montrer extrêmement conservatrices.
Abandonnées à elles-mêmes, on les voit bientôt lasses de leurs désordres se diriger d'instinct vers la servitude. Les plus fiers et les plus intraitables des Jacobins acclamèrent énergiquement Bonaparte, quand il supprima toutes les libertés et fit durement sentir sa main de fer.
----------------------
L’imagination des foules
C'est sur l'imagination populaire que sont fondées la puissance des conquérants et la force des États. En agissant sur elles, on entraîne les foules. Tous les grands faits historiques, la création du
Bouddhisme, du Christianisme, de l'Islamisme, la Réforme, la Révolution et de nos jours l'invasion menaçante du Socialisme sont les conséquences directes ou lointaines d'impressions fortes produites
sur l'imagination des foules.
Aussi, les grands hommes d'État de tous les âges et de tous les pays, y compris les plus absolus despotes, ont-ils considéré l'imagination populaire comme le soutien de leur puissance. Jamais ils
n'ont essayé de gouverner contre elle. « C'est en me faisant catholique, disait Napoléon au Conseil d'État, que j'ai fini la guerre de Vendée; en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte,
en me faisant ultramontain que j'ai gagné les prêtres en Italie. Si je gouvernais un peuple de Juifs, je rétablirais le temple de Salomon. » Jamais, peut-être, depuis Alexandre et César, aucun grand
homme n'a mieux compris comment l'imagination des foules doit être impressionnée. Sa préoccupation constante fut de la frapper. Il y songeait dans ses victoires, dans ses harangues, dans ses
discours, dans tous ses actes. A son lit de mort il y songeait encore.
Comment impressionner l'imagination des foules? Nous le verrons bientôt. Disons dès maintenant que des démonstrations destinées à influencer l'intelligence et la raison seraient incapables
d'atteindre ce but. Antoine n'eut pas besoin d'une rhétorique savante pour ameuter le peuple contre les meurtriers de César. Il lui lut son testament et lui montra son cadavre.
Tout ce qui frappe l'imagination des foules se présente sous forme d'une image saisissante et nette, dégagée d'interprétation accessoire, ou n'ayant d'autre accompagnement que quelques faits
merveilleux : une grande victoire, un grand miracle, un grand crime, un grand espoir. Il importe de présenter les choses en bloc, et sans jamais en indiquer la genèse. Cent petits crimes ou cent
petits accidents ne frapperont aucunement l'imagination des foules; tandis qu'un seul crime considérable, une seule catastrophe, les frapperont profondément, même avec des résultats infiniment moins
meurtriers que les cent petits accidents réunis. La grande épidémie d'influenza qui fit périr, à Paris, cinq mille personnes en quelques semaines, frappa peu l'imagination populaire. Cette véritable
hécatombe ne se traduisait pas, en effet, par quelque image visible, mais uniquement par les indications hebdomadaires de la statistique. Un accident qui, au lieu de ces cinq mille personnes, en eût
seulement fait périr cinq cents, le même jour, sur une place publique, par un événement bien visible, la chute de la tour Eiffel, par exemple, aurait produit sur l'imagination une impression immense.
La perte possible d'un transatlantique qu'on supposait, faute de nouvelles, coulé en pleine mer, frappa profondément pendant huit jours l'imagination des foules. Or, les statistiques officielles
montrent que dans la même année un millier de grands bâtiments se perdirent. De ces pertes successives, bien autrement importantes comme destruction de vies et de marchandises, les foules ne se
préoccupèrent pas un seul instant.
Ce ne sont donc pas les faits en eux-mêmes qui frappent l'imagination populaire, mais bien la façon dont ils se présentent. Ces faits doivent par condensation, si je puis m'exprimer ainsi, produire
une image saisissante qui remplisse et obsède l'esprit. Connaître l'art d'impressionner l'imagination des foules c'est connaître l'art de les gouverner.
----------------
Les images, les mots et les formules
En étudiant l'imagination des foules, nous avons vu qu'elles sont impressionnées surtout par des images. Si l'on ne dispose pas toujours de ces images, il est possible de les évoquer par l'emploi
judicieux des mots et des formules. Maniés avec art, ils possèdent vraiment la puissance mystérieuse que leur attribuaient jadis les adeptes de la magie. Ils provoquent dans l'âme des multitudes les
plus formidables tempêtes, et savent aussi les calmer. On élèverait une pyramide plus haute que celle du vieux Khéops avec les seuls ossements des victimes de la puissance des mots et des
formules.
La puissance des mots est liée aux images qu'ils évoquent et tout à fait indépendante de leur signification réelle. Ceux dont le sens est le plus mal défini possèdent parfois le plus d'action. Tels,
par exemple, les termes: démocratie, socialisme, égalité, liberté, etc., dont le sens est si vague que de gros volumes ne suffisent pas à le préciser. Et pourtant une puissance vraiment magique
s'attache à leurs brèves syllabes, comme si elles contenaient la solution de tous les problèmes. Ils synthétisent des aspirations inconscientes variées et l'espoir de leur réalisation.
La raison et les arguments ne sauraient lutter contre certains mots et certaines formules. On les prononce avec recueillement devant les foules; et, tout aussitôt, les visages deviennent respectueux
et les fronts s'inclinent. Beaucoup les considèrent comme des forces de la nature, des puissances surnaturelles. Ils évoquent dans les âmes des images grandioses et vagues, mais le vague même qui les
estompe augmente leur mystérieuse puissance. On peut les comparer à ces divinités redoutables cachées derrière le tabernacle et dont le dévot n'approche qu'en tremblant.
Les images évoquées par les mots étant indépendantes de leur sens, varient d'âge en âge, de peuple à peuple, sous l'identité des formules. A certains mots s'attachent transitoirement certaines
images: le mot n'est que le bouton d'appel qui les fait apparaître.
Tous les mots et toutes les formules ne possèdent pas la puissance d'évoquer des images; et, il en est qui, après en avoir évoqué, s'usent et ne réveillent plus rien dans l'esprit. Ils deviennent
alors de vains sons, dont l'utilité principale est de dispenser celui qui les emploie de l'obligation de penser. Avec un petit stock de formules et de lieux communs appris dans la jeunesse, nous
possédons tout ce qu'il faut pour traverser la vie sans la fatigante nécessité d'avoir à réfléchir.
Aussi, quand les foules, à la suite de bouleversements politiques, de changements de croyances, finissent par professer une antipathie profonde pour les images évoquées par certains mots, le premier
devoir du véritable homme d'État est de changer ces mots sans, bien entendu, toucher aux choses en elles-mêmes. Ces dernières sont trop liées à une constitution héréditaire pour pouvoir être
transformées. Le judicieux Tocqueville fait remarquer que le travail du Consulat et de l'Empire consista surtout à habiller de mots nouveaux la plupart des institutions du passé, à remplacer par
conséquent des mots évoquant de fâcheuses images dans l'imagination par d'autres dont la nouveauté empêchait de pareilles évocations. La taille est devenue contribution foncière; la gabelle, l'impôt
du sel ; les aides, contributions indirectes et droit réunis; la taxe des maîtrises et jurandes s'est appelée patente, etc.
Une des fonctions les plus essentielles des hommes d'État consiste donc à baptiser de mots populaires, ou au moins neutres, les choses détestées des foules sous leurs anciens noms. La puissance des
mots est si grande qu'il suffit de termes bien choisis pour faire accepter les choses les plus odieuses. Taine remarque justement que c'est en invoquant la liberté et là fraternité, mots très
populaires alors, que les Jacobins ont pu « installer un despotisme digne du Dahomey, un tribunal pareil à celui de l'Inquisition, des hécatombes humaines semblables à celles de l'ancien Mexique ».
L'art des gouvernants, comme celui des avocats, consiste principalement à savoir manier les mots. Art difficile, car, dans une même société, les mêmes mots ont le plus souvent des sens différents
pour les diverses couches sociales. Elles emploient en apparence les mêmes mots; mais ne parlent pas la même langue.
------------------
Les moyens d’action des meneurs
Quand il s'agit de faire pénétrer lentement des idées et des croyances dans l'esprit des foules - les théories sociales modernes, par exemple - les méthodes des meneurs sont différentes. Ils ont
principalement recours aux trois procédés suivants: l'affirmation, la répétition, la contagion. L'action en est assez lente, mais les effets durables.
L'affirmation pure et simple, dégagée de tout raisonnement et de toute preuve, constitue un sûr moyen de faire pénétrer une idée dans l'esprit des foules. Plus l'affirmation est concise, dépourvue de
preuves et de démonstration, plus elle a d'autorité. Les livres religieux et les codes de tous les âges ont toujours procédé par simple affirmation. Les hommes d'État appelés à défendre une cause
politique quelconque, les industriels propageant leurs produits par la publicité, connaissent la valeur de l'affirmation.
Cette dernière n'acquiert cependant d'influence réelle qu'à la condition d'être constamment répétée, et le plus possible, dans les mêmes termes, Napoléon disait qu'il n'existe qu'une seule figure
sérieuse de rhétorique, la répétition. La chose affirmée arrive, par la répétition, à s'établir dans les esprits au point d'être acceptée comme une vérité démontrée.
Lorsqu'une affirmation a été suffisamment répétée, avec unanimité dans la répétition, comme cela arrive pour certaines entreprises financières achetant tous les concours, il se forme ce qu'on appelle
un courant d'opinion et le puissant mécanisme de la contagion intervient. Dans les foules, les idées, les sentiments, les émotions, les croyances possèdent un pouvoir contagieux aussi intense que
celui des microbes. Ce phénomène s'observe chez les animaux eux-mêmes dès qu'ils sont en foule. Le tic d'un cheval dans une écurie est bientôt imité par les autres chevaux de la même écurie. Une
frayeur, un mouvement désordonné de quelques moutons s'étend bientôt à tout le troupeau. La contagion des émotions explique la soudaineté des paniques. Les désordres cérébraux, comme la folie, se
propagent aussi par la contagion. On sait combien est fréquente l'aliénation chez les médecins aliénistes. On cite même des formes de folie, l'agoraphobie, par exemple, communiquées de l'homme aux
animaux.
Si les opinions propagées par l'affirmation, la répétition et la contagion, possèdent une grande puissance, c'est qu'elles finissent par acquérir ce pouvoir mystérieux nommé prestige.
Tout ce qui a dominé dans le monde, les idées ou les hommes, s'est imposé principalement par la force irrésistible qu'exprime le mot prestige. Nous saisissons tous le sens de ce terme, mais on
l'applique de façons trop diverses pour qu'il soit facile de le définir. Le prestige peut comporter certains sentiments tels que l'admiration et la crainte qui parfois même en sont la base, mais il
peut parfaitement exister sans eux. Des êtres morts, et par conséquent que nous ne saurions craindre, Alexandre, César, Mahomet, Bouddha, possèdent un prestige considérable. D'un autre côté,
certaines fictions que nous n'admirons pas, les divinités monstrueuses des temples souterrains de l'Inde, par exemple, nous paraissent pourtant revêtues d'un grand prestige.
Le prestige est en réalité une sorte de fascination qu'exerce sur notre esprit un individu, une oeuvre ou une doctrine. Cette fascination paralyse toutes nos facultés critiques et remplit notre âme
d'étonnement et de respect. Les sentiments alors provoqués sont inexplicables, comme tous les sentiments, mais probablement du même ordre que la suggestion subie par un sujet magnétisé. Le prestige
est le plus puissant ressort de toute domination. Les dieux, les rois et les femmes n'auraient jamais régné sans lui.
---------------
Les foules dites criminelles
Les foules tombant, après une certaine période d'excitation, à l'état de simples automates inconscients menés par des suggestions, il semble difficile de les qualifier en aucun cas de criminelles. Je
conserve cependant ce qualificatif erroné parce qu'il a été consacré par des recherches psychologiques. Certains actes des foules sont assu-rément criminels considérés en eux-mêmes, mais alors au
même titre que l'acte d'un tigre dévorant un Hindou, après l'avoir d'abord laissé déchiqueter par ses petits pour les distraire.
Les crimes des foules résultent généralement d'une suggestion puissante, et les individus qui y ont pris part sont persuadés ensuite avoir obéi à un devoir. Tel n'est pas du tout le cas du criminel
ordinaire.
L'histoire des crimes commis par les foules met en évidence ce qui précède,
On peut citer comme exemple typique le meurtre du gouverneur de la Bastille, M. de Launay. Après la prise de cette forteresse, le gouverneur, entouré d'une foule très excitée, recevait des coups de
tous côtés. On proposait de le pendre, de lui couper la tête, ou de l'attacher à la queue d'un cheval. En se débattant, il frappa par mégarde d'un coup de pied l'un des assistants. Quelqu'un proposa,
et sa suggestion fut accla-mée aussitôt par la foule, que l'individu atteint coupât le cou au gouverneur.
« Celui-ci, cuisinier sans place, demi-badaud qui est allé à la Bastille pour voir ce qui s'y passait, juge que, puisque tel est l'avis général, l'action est patriotique, et croit même mériter une
médaille en détruisant un monstre. Avec un sabre qu'on lui prête, il frappe sur le col nu ; mais le sabre mal affilé ne coupant pas, il tire de sa poche un petit couteau à manche noir et (comme, en
sa qualité de cuisinier, il sait travailler les viandes) il achève heureusement l'opération. »
On voit clairement ici le mécanisme précédemment indiqué. Obéissance à une suggestion d'autant plus puissante qu'elle est collective, convic¬tion chez le meurtrier d'avoir commis un acte fort
méritoire, et conviction naturelle puisqu'il a pour lui l'approbation unanime de ses concitoyens. Un acte semblable peut être légalement, mais non psychologiquement, qualifié de criminel.
Les caractères généraux des foules dites criminelles sont exactement ceux que nous avons constatés chez toutes les foules : suggestibilité, crédulité, mobilité, exagé-ration des sentiments bons ou
mauvais, manifestation de certaines formes de moralité, etc.
Nous retrouverons tous ces caractères chez une des foules qui laissèrent un des plus sinistres souvenirs de notre histoire : les septembriseurs. Elle présente d'ailleurs beaucoup d'analogie avec
celles qui firent la Saint-Barthélemy. J'emprunte les détails du récit à Taine, qui les a puisés dans les mémoires du temps.
On ne sait pas exactement qui donna l'ordre ou suggéra de vider les prisons en massacrant les prisonniers. Que ce soit Danton, comme cela parait probable, ou tout autre, peu importe; le seul fait
intéressant pour nous est celui de la suggestion puis-sante reçue par la foule chargée du massacre.
L'armée des massacreurs comprenait environ trois cents personnes, et constituait le type parfait d'une foule hétérogène. A part un très petit nombre de gredins profes-sionnels, elle se composait
surtout de boutiquiers et d'artisans de corps d'états divers : cordonniers, serruriers, perruquiers, maçons, employés, commissionnaires, etc. Sous l'influence de la suggestion reçue, ils sont, comme
le cuisinier cité plus haut, parfaite-ment convaincus d'accomplir un devoir patriotique. Ils remplissent une double fonc-tion, juges et bourreaux, et ne se considèrent en aucune façon comme des
criminels.
Pénétrés de l'importance de leur rôle, ils commencent par former une sorte de tribunal, et immédiatement apparaissent l'esprit simpliste et l'équité non moins simpliste des foules. Vu le nombre
considérable des accusés, on décide d'abord que les nobles, les prêtres, les officiers, les serviteurs du roi, c'est-à-dire tous les individus dont la profession seule est une preuve de culpabilité
aux yeux d'un bon patriote, seront massacrés en tas sans qu'il soit besoin de décision spéciale. On jugera les autres sur la mine et la réputation. La conscience rudimentaire de la foule étant ainsi
satisfaite, elle va pouvoir procéder légalement au massacre et donner libre cours aux instincts de férocité dont j'ai montré ailleurs la genèse, et que les collectivités ont le pouvoir de développer
à un haut degré. Ils n'empêcheront pas du reste - ainsi que cela est la règle dans les foules - la manifestation concomitante d'autres sentiments contraires, tels qu'une sensibilité souvent aussi
extrême que la férocité.
« Ils ont la sympathie expansive et la sensibilité prompte de l'ouvrier parisien. A l'Abbaye, un fédéré, apprenant que depuis vingt-six heures on avait laissé les détenus sans eau, voulait absolument
exterminer le guichetier négligent, et l'eût fait sans les supplications des détenus eux-mêmes. Lorsqu'un prisonnier est acquitté (par leur tribunal improvisé), gardes et tueurs, tout le monde
l'embrasse avec transport, on applaudit à outrance », puis on retourne tuer les autres. Pendant le massacre une aimable gaieté ne cesse de régner. Ils dansent et chantent autour des cadavres,
dis-posent des bancs « pour les dames » heureuses de voir tuer des aristocrates. Ils continuent aussi à manifester une équité spéciale. Un tueur s'étant plaint, à l'Abbaye, que les dames placées un
peu loin voient mal, et que quelques assistants seuls ont le plaisir de frapper les aristocrates, ils se rendent à la justesse de cette observation, et décident de faire passer lentement les victimes
entre deux haies d'égorgeurs qui ne pourront frapper qu'avec le dos du sabre, afin de prolonger le supplice. A la force les victimes sont mises entièrement nues, déchiquetées pendant une demi-heure ;
puis, quand tout le monde a bien vu, on les achève en leur ouvrant le ventre.
Les massacreurs sont d'ailleurs fort scrupuleux, et manifestent la moralité dont nous avons déjà signalé l'existence au sein des foules. Ils rapportent sur la table des comités l'argent et les bijoux
des victimes.
Dans tous leurs actes on retrouve toujours ces formes rudimentaires de raisonne-ment, caractéristiques de l'âme des foules. C'est ainsi qu'après l'égorgement des douze ou quinze cents ennemis de la
nation, quelqu'un fait observer, et immédiate¬ment sa suggestion est acceptée, que les autres prisons, contenant des vieux men¬diants, des vagabonds, des jeunes détenus, renferment en réalité des
bouches inutiles, dont il serait bon de se débarrasser. D'ailleurs figurent certainement parmi eux des ennemis du peuple, tels, par exemple, qu'une certaine dame Delarue, veuve d'un empoisonneur : «
Elle doit être furieuse d'être en prison ; si elle pouvait, elle mettrait le feu à Paris ; elle doit l'avoir dit, elle l'a dit. Encore un coup de balai. » La démons¬tration paraît évidente, et tout
est massacré en bloc, y compris une cinquantaine d'enfants de douze à dix-sept ans qui, d'ailleurs, eux-mêmes, auraient pu devenir des ennemis de la nation et devaient par conséquent être
supprimés.
Après une semaine de travail, toutes ces opérations étaient terminées, et les massacreurs purent songer au repos. Intimement persuadés qu'ils avaient bien mérité de la patrie, ils vinrent réclamer
une récompense aux autorités ; les plus zélés exigèrent même une médaille.
L'histoire de la Commune de 1871 nous offre plusieurs faits analogues. L'influence grandissante des foules et les capitulations successives des pouvoirs devant elles en fourniront certainement bien
d'autres.
Voltaire humilié
NB : Les principaux acteurs cités dans cette étude furent maçons sauf Rousseau.
---------------------
Le royaume
Nous sommes en 1726.
Louis XV, couronné trois ans plus tôt n'a que 17 ans. Il appelle auprès de lui le cardinal de Fleury, son ancien précepteur. Une période de paix et de prospérité s'ouvre pour la France alors première puissance mondiale, la plus peuplée, la plus riche, la mieux dotée de routes. La Lorraine et le Barrois ont été donnés en usufruit au beau père de louis XV (l'ex roi polonais Stanilas - d'ou la place du même nom à nancy) et reviendront à la France à sa mort, par héritage de sa fille Marie Leszcynska, Reine de france. La France s'est pourvue d'un vaste empire, du canada aux Indes en passant par la louisiane et les caraïbes, son fleuron colonial par son industrie sucrière.
Bref tout va plutôt bien dans le royaume de France ou les lettres prospèrent.
---------------------
D'ou vient Voltaire ?
Voltaire est né Arouet. Les Arouets sont originaires d’un petit village du nord du Poitou, Saint-Loup, où ils exercent au XVe et XVIe siècle une activité de tanneurs. Les Arouet sont un exemple de l’ascension sociale de la bourgeoisie au XVIIe siècle. Le premier Arouet à quitter sa province s’installe à Paris en 1625 où il ouvre une boutique de marchand de draps et de soie. Il épouse la fille d’un drapier prospère et s’enrichit suffisamment pour acheter pour son fils, François, le père de Voltaire, une charge de notaire au Châtelet en 1675, assurant à son titulaire l’accès à la petite noblesse de robe. Ce dernier, travailleur austère et probe aux relations importantes, arrondit encore la fortune familiale en épousant le 7 juin 1683 la fille d’un greffier criminel au Parlement. Arouet père veut donner à son cadet, François-Marie une formation intellectuelle qui soit à la hauteur des dons que celui-ci manifeste. Arouet père élève cinq enfants (dont trois atteignent l'âge adulte), et revend son étude en 1696 pour acquérir une charge de conseiller du roi, receveur des épices à la Chambre des Comptes. Voltaire perd sa mère à l’âge de sept ans.
François-Marie entre à dix ans comme interne au collège Louis-le-Grand chez les Jésuites. L'établissement le plus cher de la capitale (500 livres par an) et le mieux fréquenté; François-Marie y étudie durant sept ans. Les jésuites enseignent le latin et la rhétorique, mais veulent avant tout former des hommes du monde et initient leurs élèves aux arts de société : joutes oratoires, plaidoyers, concours de versification, et théâtre.
Arouet est un élève brillant, vite célèbre par sa facilité à versifier : sa toute première publication est son Ode à sainte Geneviève. Imprimée par les Pères, cette ode est répandue hors les murs de Louis-le-Grand. Il apprend au collège à s'adresser d’égal à égal aux fils de puissants personnages et tisse de précieux liens d’amitié, très utiles toute sa vie : entre par exemple les frères d’Argenson, René-Louis et Marc-Pierre, futurs ministres de Louis XV et le futur duc de Richelieu.
Arouet quitte le collège en 1711 à dix-sept ans et annonce à son père qu’il veut devenir homme de lettres, et non avocat ou titulaire d’une charge de conseiller au Parlement, investissement pourtant considérable que ce dernier est prêt à faire pour lui. Devant l’opposition paternelle, il s’inscrit à l’école de droit.
---------------------
La Société du Temple
Il fréquente la société du Temple, qui réunit dans l’hôtel de Philippe de Vendôme, des membres de la haute noblesse et des poètes, épicuriens connus pour leur esprit, leur libertinage et leur scepticisme. Comme les lettrés de ce temps il entend restaurer la philosophie des anciens pour l'opposer au dogme. Il y approfondi sa connaissance des classiques latins, Sénèque et Marc Aurèle en particulier :
«Nous sommes nés par hasard dans un monde qui s’en moque. Natus sum in mundo, qui forte ignorat.
Qui a vu ce qui est dans le présent a tout vu, et tout ce qui a été de toute éternité et tout ce qui sera dans l'infini du temps.
Tu as subsisté comme partie du Tout. Tu disparaîtras dans ce qui t'a produit, ou plutôt, tu seras repris, par transformation, dans sa raison génératrice.
Tout est éphémère, et le fait de se souvenir, et l'objet dont on se souvient.
Bientôt tu auras tout oublié, bientôt tous t'auront oublié.
C'est une citadelle que l'intelligence libérée des passions»
Telles sont les sentences, les inclinations philosophiques qui marquent les esprits avancés de ce temps.
L’abbé de Châteauneuf, son parrain, l’avait présenté à la Société du Temple dès 1708. A la fréquentation de ses membres, il se persuade qu’il est né d'un grand seigneur libertin et n’aurait rien à voir avec les Arouet et les gens du commun. (il ira jusqu'a s'imaginer le fils d'un noble proche de sa défunte mère)
La Société est aussi pour lui une école de poésie ; il va ainsi y apprendre à faire des vers « légers, rapides, nourris de référence antiques, libres de ton jusqu’à la grivoiserie, plaisantant sans retenue sur la religion et la monarchie.
Le 18 novembre 1718, sa première pièce écrite sous le pseudonyme de Voltaire, Œdipe, obtient un immense succès. Le public, qui voit en lui un nouveau Racine, aime ses vers en forme de maximes et ses allusions impertinentes au roi défunt et à la religion. Ses talents de poète mondain triomphent dans les salons et les châteaux.
Il connaît un nouveau succès en 1723 avec La Henriade, (un hommage à Henry IV) poème épique de 4 300 alexandrins se référant aux modèles classiques. Pour ses contemporains admiratifs, Voltaire va être longtemps l'auteur de La Henriade , le « Virgile français », le premier à avoir écrit une épopée nationale.
A ses gloires littéraires et dans les salons ou son esprit piquant et léger est recherché, à sa fortune familiale déjà très consistante qu'il augmente habilement avec le concours de financiers amis, s'ajoute ses succès nombreux avec les femmes.
Et parmi ses maîtresses l'une d'elle est une figure du siècle : la comédienne Adrienne Lecouvreur
---------------------
Adrienne Lecouvreur
C'était une jeune femme svelte dont la voix bien timbrée, mais posée, était incapable de ces coups de force mais qui charmait littéralement son auditoire.
Adrienne Lecouvreur ne criait pas, ce qui constituait une nouveauté pour l'époque, étonnant le public habitué à entendre vociférer des vers de Corneille ou de Racine.
Tour à tour Bérénice, ou Amphytrion, elle enchante la Cour et la ville, jouant cent trente-neuf fois en dix mois.
Le Mercure de France la décrit ainsi : «Mademoiselle Lecouvreur est parfaitement faite dans sa taille médiocre, avec un maintien noble et assuré; la tête et les épaules sont bien placées, les yeux pleins de feu, la bouche belle, le nez un peu aquilin et beaucoup d'agrément dans l'air et les manières; sans embonpoint, mais les joues assez pleines, avec des traits bien marqués pour exprimer la tristesse, la joie, la tendresse, la terreur et la pitié.»
Bien que fort effacée dans la comédie, ce fut elle cependant que Marivaux choisit pour créer le rôle de la marquise dans la Seconde Surprise de l'Amour, qu'elle joua, dit d'Alembert, avec des «allures de reine».
Elle fut longtemps maîtresse attentionnée du Maréchal de Saxe.
Mais pour l'heure elle est celle de Voltaire
---------------------
L'altercation : 15 janvier 1726
Revenons à cette date du 15 janvier 1726. Voltaire à 32 ans.
La querelle naquit entre Voltaire et Rohan un soir à la Comédie-Française, dans la loge d'Adrienne Lecouvreur.
Guy-Auguste de Rohan comte de Chabot, Grand du Royaume, jaloux du succès de Voltaire auprès de la comédienne, lui dit devant celle-ci, pour faire valoir sa haute noblesse face au roturier :
« Arouet ? Voltaire ? Enfin, monsieur avez-vous un nom ? »
La réplique fuse :
« Voltaire ! Je commence mon nom et vous finissez le vôtre. »
Le ton monte entre les deux hommes et Voltaire demande réparation s'offrant pour un duel le lendemain; mais Rohan réplique qu'il ne s'abaissera à combattre un manant. Voltaire le traite de lâche.
Le lendemain au soir alors qu'il soupe chez le Duc de Sully, un domestique fait descendre Voltaire dans la rue où deux voitures l'y attendent; de l'une jaillit une volée de tape-dur armés de bâtons, et tapi dans l'autre, Rohan s'écrie : « Ne frappez pas sur la tête, il peut encore en sortir quelque chose de bon. »; puis « C'est assez. » lorsqu'il estime la correction suffisante.
C'est ainsi qu'on se doit de traiter la roture.
Voltaire est humilié et en appelle à ses amis pour organiser une cabale contre Rohan pour le pousser au duel.
Mais pas un n'intervient. Tous l'exhortent à oublier l'incident et à prendre conscience de la position de son adversaire. Ses amitiés aristocrates l'abandonnent l'une après l'autre; le roturier prend amèrement conscience de sa condition d’histrion utile à leur divertissement. Il ne décolère pas.
Un rapport de police est adressé au ministre :
« nous sommes informés par voie sûre que le sieur Voltaire médite d'insulter incessamment et avec éclat M. de Rohan […] il [Voltaire] est actuellement chez un nommé Leymaud, maître en fait d'armes, rue Saint-Martin, où il vit en très mauvaise compagnie […] »
Il est embastillé sur le champ mais ménagé tout de même par la lettre suivante écrite à l'attention du gouverneur de la Bastille :
« Le sieur Voltaire est d'un génie à avoir besoin de ménagements. Son Altesse Royale a trouvé bon que j'écrivisse que l'intention du Roi est que vous lui procuriez toutes les douceurs et la liberté de la Bastille qui ne seront point contraires à la sécurité de sa détention. »
Onze jours plus tard, Voltaire obtient son départ pour l'Angleterre pour quitter la Bastille :
« Je remonte très humblement que j'ai été assassiné par le brave chevalier de Rohan assisté de six coupe-jarrets derrière lesquels il était hardiment posté. J'ai toujours cherché depuis ce temps-là à réparer, non mon honneur, mais le sien, ce qui est trop difficile… Je demande avec encore plus d'insistance la permission d'aller incessamment en Angleterre et si on doute de mon départ, on peut m'envoyer avec un passeport jusqu'à Calais.»
---------------------
L'enterrement de Newton
D’une durée de trois ans, le voyage est une révélation intellectuelle et humaine pour le Parisien : il y a d’abord la découverte de Shakespeare ; il y a ensuite le commerce avec les œuvres de John Gay et de Swift ; puis le chaleureux accueil de l’ami Lord Bolingbroke, qui présente au voyageur Alexander Pope ; à cela s’ajoutent l’initiation à la philosophie newtonienne et la rencontre des philosophes Berkeley, Locke et Clarke. Sur l’« île de la Raison », exacte antinomie du « royaume très chrétien » qu’incarne la France, Voltaire côtoie l’élite anglaise. Résultat, sa pensée se précise.
Il ne faut pas plus de quelques semaines pour qu'il goûte au règne de l’indulgence : aucune lettre de cachet ici ; la loi d’Habeas corpus de 1679 (nul ne demeure détenu sauf par décision d’un juge) et la Déclaration des droits de 1689 protègent les citoyens contre le pouvoir du monarque. Voltaire croise des personnes d’obédiences religieuses très diverses et écarquille les yeux à leur écoute : loin de s’entre-tuer, le juif, le mahométan et le chrétien négocient ensemble ; les trois confessions agissent pour la prospérité commerciale. L’exemple, surprenant et remarquable, sera souvent cité par le philosophe au cours de sa longue vie. Le modèle insulaire n’a décidément que du bon. Le Français note chaque détail et relate ses expériences ; les feuilles qu’il noircit au fur et à mesure des jours s’apparentent à un véritable reportage intellectuel.
Le projet d’écrire des « Lettres anglaises » fait son chemin qui deviendra plus tard les Lettres philosophiques. De quoi y parle-t-on ? Outre un panorama religieux, Voltaire propose des développements sur le politique, le social et l’économique. Il chante les louanges de l’esprit novateur propre aux Anglais, un esprit libre de toute censure qui s’affirme aussi bien chez Bacon (le théoricien de l’expérience) que chez Locke (le théoricien de l’empirisme) ou chez Newton (le théoricien de la gravitation universelle et apôtre de la religion naturelle -déisme). Une dernière partie traite des institutions littéraires et des écrivains. L’œuvre constitue l’un des premiers manifestes en faveur des Lumières.
Le voyage participe indéniablement à la mutation spirituelle du jeune auteur. Éloge de la tolérance, du pragmatisme et de la liberté économique.
A chacun selon sa naissance, dit on en France
A chacun selon ses mérites, dit on a Londres
A Londres ou il assiste à l'enterrement de Newton, père de la Maçonnerie, sous les pavements de Westminster Abbey aux côtés des rois d'angleterre. Newton qui refusa les derniers sacrement et qui ne fut anobli que de part son génie.
---------------------
L'enterrement d'Adrienne
De retour en France, dont il se languissait, Voltaire renoue avec Adrienne. Dans la nuit du 20 mars 1730 la comédienne s'éteind d'une violente crise intestinale évoluant en hémorragie (on soupçonne l'épouse de maurice de Saxe de l'avoir empoisonnée)
Saxe, Voltaire et le chirurgien Faget ont assisté à ses derniers moments. Les scellés furent apposés le jour même, et le lendemain matin on procédait à l'autopsie.
Adrienne morte, des faits odieux vont se passer autour de son cadavre. La valetaille fait main basse sur tout ce qu'on peut prendre.
Le curé de Saint-Sulpice, arrivé lorsque son ministère n'était plus nécessaire, se refuse à rendre les honneurs funèbres, arguant que la défunte n'a pas fait acte de repentir des scandales de sa profession; bien plus: il s'oppose à ce qu'elle soit inhumée parmi les fidèles, bien qu'elle eût témoigné l'extrême désir de recevoir les derniers sacrements et qu'elle fût morte dans le temps qu'on avait envoyé chercher un prêtre. D'où l'obligation pour le ministre Maurepas de donner des ordres pour faire enlever le cadavre la nuit, afin de l'enterrer n'importe où, mais sans scandale.
Voltaire nous a laissé le procès-verbal de cette opération, qui fut hideuse :
«...Que l'aimable Lecouvreur
A qui j'ai fermé les paupières
N'a pas eu même la faveur
De deux cierges et d'une bière,
Et que Monsieur de Laubinière
Porta la nuit par charité,
Ce corps autrefois si vanté
Dans un vieux fiacre empaqueté,
Vers les bords de notre rivière»
A minuit, le corps d'Adrienne Lecouvreur avait été descendu dans un fiacre par des portefaix, puis, accompagné du Laubinière cité plus haut et d'une escouade du guet, transporté dans un terrain vague et déposé dans de la chaux vive, au milieu de chantiers, près de la Seine.
Différents endroits ont été désignés: la Grenouillère, c'est-à-dire vers le quai d'Orsay actuel, à l'angle du boulevard Saint-Germain;
Au lendemain de ce scandale, Voltaire seul avait protesté. Sa voix resta sans écho et il en fut meurtri.
---------------------
Ces trois épisodes, la bastonnade de Rohan, la découverte de l'Angleterre et l'enseignement de Newton, l'enterrement d'Adrienne Lecouvreur, transformèrent le poète en un philosophe, qui de sa roture, jadis dissimulée, s'en fait désormais gloire.
Ces événements intimes firent de lui ce qu'il fut.
De ces épisodes, minuscules d'apparence, naissent, par réaction sous la forte impulsion de Voltaire l'épopée des Lumières ou tous les Philosophes (tous maçons sauf Rousseau) s'appliqueront à bouleverser le Monde.
---------------------
La conclusion de Bakounine
Bien plus tard Bakounine fit un discours en Loge pour évoquer ce moment :
«La bourgeoisie avait un monde à conquérir, une place à prendre dans la société, et organisée pour le combat, intelligente, audacieuse, se sentant forte du droit de tout le monde, elle était douée d’une toute-puissance irrésistible : elle seule a fait contre la monarchie, la noblesse et le clergé réunis les trois révolutions. A cette époque la bourgeoisie aussi avait créé une association internationale, universelle, formidable, la Franc-Maçonnerie. On se tromperait beaucoup si l’on jugeait de la Franc-Maçonnerie du siècle passé, ou même de celle du commencement du siècle présent, d’après ce qu’elle est aujourd’hui. Institution par excellence bourgeoise, dans son développement, par sa puissance croissante d’abord et plus tard par sa décadence, la Franc-Maçonnerie a représenté en quelque sorte le développement, la puissance et la décadence intellectuelle et morale de la bourgeoisie. Aujourd’hui, descendue au triste rôle d’une vieille intrigante radoteuse, elle est nulle, inutile, quelquefois malfaisante et toujours ridicule, tandis qu’avant 1830 et surtout avant 1793, ayant réuni en son sein, à très peu d’exceptions près, tous les esprits d’élite, les cœurs les plus ardents, les volontés les plus fières, les caractères les plus audacieux, elle avait constitué une organisation active, puissante et réellement bienfaisante. C’était l’incarnation énergique et la mise en pratique de l’idée humanitaire du XVIIIe siècle. Tous ces grands principes de liberté, d’égalité, de fraternité, de la raison et de la justice humaines, élaborés d’abord théoriquement par la philosophie de ce siècle, étaient devenus au sein de la Franc-Maçonnerie des dogmes politiques et comme les bases d’une morale et d’une politique nouvelle, - l’âme d’une entreprise gigantesque de démolition et de reconstruction.
La Franc-Maçonnerie n’a été rien [de] moins, à cette époque, que la conspiration universelle de la bourgeoisie révolutionnaire contre la tyrannie féodale, monarchique et divine.
Ce fut l’Internationale de la Bourgeoisie
---------------------
La conclusion (opposée) d'Edmund Burke
Philosophe irlandais, député à la Chambre des Communes britannique dans les rangs du parti Whig « Le Cicéron anglais» voit les choses autrement.
Opposé à la Révolution française dès son début, il s'en déclara l'adversaire, contre l’opinion de la plupart des Whigs qui manifestaient de l'intérêt pour l'expérience française, tels Thomas Paine et William Godwin, qui incarnèrent ce pan du libéralisme anglais converti aux Lumières françaises et défenseur de l'esprit de 1789.
Dans l’œuvre de Burke, on lit en filigrane la lointaine et durable incrédulité qui règne entre les maçons anglais, libéraux et conservateurs et leurs frères de France plus portés à une rupture radicale avec l’Ordre ancien, à une politique brouillonne de terre brulée, aux balancements extrêmes.
CITATION
«Ce qui conduit à la découverte de la véritable cause de cette opération : Les capitalistes de Paris ; Les philosophes politiques, hommes de lettres.
Le peuple a regardé longtemps d'un mauvais œil les capitalistes. La nature de leur propriété lui semblait avoir un rapport plus immédiat avec la nature de sa détresse, et l'aggraver. Dans le même temps, la fierté des hommes à argent, non nobles ou nouvellement anoblis, s'augmentait avec sa cause. Cette classe d'hommes ne supportait qu'avec ressentiment une infériorité dont elle ne reconnaissait pas les fondements. C'est cette classe d'hommes qui a frappé sur la noblesse en attaquant la couronne et l'église. Elle a porté particulièrement ses coups aux endroits où les blessures devaient être les plus mortelles ; c'est-à-dire en s'adressant aux propriétés de l'église qui, au moyen du patronage du roi, étaient communément réparties parmi la noblesse. Dans cet état subsistant d'une guerre très réelle, quoique pas toujours apparente, entre l'ancien propriétaire foncier et le nouveau capitaliste, la force prépondérante était en faveur des derniers. Les capitaux sont en effet plutôt disponibles pour tous les événements, et leurs propriétaires plus disposés aux nouvelles entreprises de toute espèce ; comme l'acquisition en est récente, ils s'accordent plus naturellement avec toutes les nouveautés. C'est par conséquent l’espèce de richesses qui convient à ceux qui souhaitent des changements.
D'un autre côté, s'était élevée, aussi dans le même temps, une nouvelle classe d'homme qui ne tarda pas à former avec les capitalistes une coalition intime et remarquable ; je veux dire les hommes de lettres politiques. Les hommes de lettres sans cesse préoccupés du besoin de primer, sont rarement ennemis des innovations. Depuis le déclin de la vie et de la grandeur de Louis XIV, ils avaient cessé d'être aussi recherchés, soit par lui-même, soit par le Régent, soit par leurs successeurs à la couronne ; ils n'étaient plus si systématiquement attirés à la cour par les mêmes faveurs et les mêmes largesses que pendant la brillante période de ce règne politique et plein de dignité. Ils tachèrent de se dédommager de ce qu'ils avaient perdu dans la protection de l'ancienne cour, en se réunissant pour former entre eux une association puissante. L'union des deux académies de France, et ensuite la vaste entreprise de l’Encyclopédie dirigée par ces messieurs, ne contribuèrent pas peu aux succès de leurs projets.
La cabale littéraire avait formé il y a quelques années quelque chose de ressemblant à un plan régulier pour la destruction de la religion chrétienne ; ils poursuivaient leur objet avec un degré de zèle qui jusqu'ici ne s'était montré que dans les propagateurs de quelque système religieux. Ils étaient possédés jusqu'au degré le plus fanatique de l'esprit de prosélytisme ; et de là, par une progression facile, d'un esprit de persécution conforme à leurs vues : ce qu'ils ne pouvaient pas faire directement et tout d'un coup pour arriver à leurs fins, ils le tramaient par des procédés plus lents et en travaillant l'opinion. Pour commander à l'opinion, le premier pas nécessaire est de s'arroger un empire sur ceux qui la dirigent. Leurs premiers soins furent de s'emparer avec méthode et persévérance de toutes les avenues qui conduisent à la gloire littéraire ; beaucoup d'entre eux, assurément, ont occupé un rang très élevé dans la littérature et dans les sciences. Le monde entier leur a rendu justice, et en faveur de leurs autres talents, on leur a fait grâce sur le but dangereux de leurs principes particuliers ; c'était générosité pure ; ils y ont répondu en faisant tous leurs efforts pour accaparer entre eux seuls et leurs adeptes toute la réputation d'esprit, de savoir et de goût
A ce système de monopole littéraire était jointe une industrie sans pitié, pour noircir et pour discréditer de toutes les manières, et par toutes sortes de moyens, tous ceux qui ne tenaient pas à leur parti. Les persécutions faibles et passagères qui ont eu lieu contre eux, plutôt par égard pour la forme et pour la décence, que par l'effet d'un ressentiment sérieux, n'ont ni diminué leurs forces, ni ralenti leurs efforts. Tout ce qui en est résulté, c'est que cette opposition et leurs succès ont fait naître un zèle violent et atroce, d'une espèce inconnue jusqu'ici dans le monde ; que ce zèle qui s'était emparé de leurs esprits, rendit toutes leurs conversations, qui autrement auraient été agréables et instructives, tout-à-fait dégoûtantes. Ils s'emparèrent avec grand soin de toutes les avenues de l'opinion.
Les écrivains, surtout lorsqu'ils agissent en corps, et dans une seule et même direction, obtiennent une grande influence sur l'esprit public ; c'est pourquoi l'alliance de ces écrivains avec les capitalistes a produit un sensible effet, en affaiblissant la haine et l'envie du peuple contre cette espèce de richesses. Ces écrivains, de même que tous ceux qui propagent des nouveautés, affectèrent un grand zèle pour le pauvre, et pour la classe la plus basse de la société, en même temps que, dans leurs satires, ils attiraient, à force d'exagération, la haine la plus forte sur les fautes des cours, de la noblesse et du clergé ! Ils devinrent des démagogues d'une certaine espèce. Ils servirent comme de chaînon pour joindre, en faveur d'un seul objet, les dispositions hostiles de la richesse, au désespoir turbulent de la pauvreté. Comme ces deux espèces d'hommes paraissent être les principaux guides de toutes les dernières opérations, leur union et leur politique serviront à expliquer la fureur universelle avec laquelle on a attaqué toutes les institutions de ce pauvre royaume. Peu de conquérants barbares ont jamais fait une révolution si terrible.
J'ai dit Vénérable Maître
V.B.
Les explorateurs maçons du siècle des lumières à nos jours : Connaître l'autre côté du monde
Vénérable Maître et vous tous mes frères en vos grades et qualités, je vais vous inviter ce soir à un voyage dans le temps et dans l'espace pour retracer les aventures et parfois les fortunes de mer de quelques explorateurs maçons ou proche de la confrérie qui ont exploré les confins du monde pour atteindre, souvent au péril de leurs vies, ces lieux encore inexplorés de notre globe et pour certains, bien au-delà !
Toute exploration commence par un voyage dans l'inconnu avec l’irrésistible envie de voir ce qu’il y a derrière les collines, les montagnes et les mers avec la promesse de découvrir une nouvelle partie du monde et de nouvelles civilisations. Pour les maçons, nous le savons , l'exploration peut être considérée comme un voyage initiatique ouvrant les portes de la géographie spirituelle. Pour les explorateurs maçons, les deux notions s’interpénètrent.
Les temps anciens
Dans l’histoire et depuis l’antiquité, les explorateurs à commencer par Ulysse ou Pythéas le marseillais n’avaient de cesse d’assouvir leur soif de découvertes. L’irrépressible envie d’apercevoir de nouveaux horizons, de nouveaux rivages ou de nouvelles contrées bercent leurs rêves et notre mythologie.
La fin du 15ème siècle la découverte des Amériques par Christophe Colomb marque une rupture profonde dans les mentalités et la vision du monde. Le début du 16éme siècle confirmera la rotondité de notre planète avec le premier voyage est-ouest autour de la terre effectué par Magellan et dont il ne verra pas la fin en mourant dans une île des philippines sur le chemin du retour.
Mais ces merveilleux voyages restent souvent centrés sur la recherche de nouvelles terres à conquérir au nom des royaumes d’Europe pour s’approprier les richesses “que Cipengo mûrit en ces mines lointaines“ tels les conquérants du célèbre poète cubains qui enchanta les milieux littéraires parisiens ( José-Maria de Hérédia)
Les lumières et l’exploration
Avec le 18ème siècle et les lumières commencent les grandes campagnes d'explorations scientifiques pour reconnaître, décrire et mesurer le globe. Les puissances européennes que sont la France et l'Angleterre montent de nombreuses expéditions scientifiques à la recherche de nouvelles terres.
Nous allons nous attarder sur 2 explorateurs français et maçons qui ont à jamais marqué l'histoire du pacifique autant par leur découverte que par leur humanisme.
En 1766 Louis Antoine de Bougainville par la volonté de Louis XV est le premier navigateur français à entreprendre un tour du monde. Le 5 décembre, il quitte Saint-Malo à bord de la frégate La Boudeuse.
Le navire se dirige au sud-ouest de l'atlantique, fait escale à Rio de Janeiro où son botaniste Philibert Commerson découvre parmi de nombreuses singularités végétales du Brésil, une plante aux fleurs feuilles qu’il nommera plus tard Bougainvillée. Il fait également escale à Buenos Aires rejoint par l'Etoile son navire de charge.
La petite escadre franchit le détroit de Magellan et mouille à Tahiti que Bougainville croit découvrir mais qui vient d’être reconnue quelques semaines plus tôt par un capitaine de la Royal Navy : Samuel Wallis mais les anglais ne purent accoster sur l'île devant l'hostilité des autochtones. Il poursuit sa route sur l'océan Pacifique, découvre les Nouvelles-Hébrides et les îles Salomon, puis le 16 mars 1769, la flottille rejoint son port d'attache : Saint-Malo. Immense triomphe pour ce succès et pour ces apports scientifiques majeurs notamment sur la géographie de l’Océanie.
Bougainville fut initié à la franc maçonnerie dans la loge de marine « l’Accord parfait » peu avant son voyage de 1766.
Il resta fidèle à ces valeurs maçonniques qui l'ont certainement guidé tout au long de sa vie aussi bien avec les colons malouins qu'il débarque sur les Falklands et qui devinrent malouines pour un temps qu'avec les peuples Patagons, Fuégiens ou encore Tahitiens qu'il croisera dans son voyage et avec lesquels il établira des relations amicales. Bougainville participera en 1798 au préparatif de la campagne d'Egypte de Bonaparte qui le nommera plus tard comte de l'Empire.
La fin du siècle approche avec, en France, le futur bouillonnement de la révolution mais, peu avant que les canons tonnent aux tuileries et à la bastille, Louis XVI passionné de géographie et conscient que la France ne joue qu'un rôle modeste dans les découvertes de l'Océanie face aux anglais décide d'organiser et de financer une grande expédition visant à compléter les découvertes de James Cook. Choisi par le roi et par le ministre de la Royale, le marquis de Castries, Jean François de Galaup, comte de La Pérouse appareille de Brest le 1er août 1785 avec deux navires : l'Astrolabe et la Boussole pour une expédition estimée à 4 ans autour de l'océan pacifique. L'expédition Lapérouse, composée de scientifiques ( astronomes, physiciens, naturalistes, botanistes, minéralogistes et illustrateurs ) double le cap Horn en février 1786 , fait escale au Chili et gagne l'île de Pâques où les pasquouans encore nombreux se montrèrent amicaux ce qui permit aux scientifiques fascinés par les géants de pierre d'effectuer mesures et croquis.
Ensuite Tahiti puis cap au nord où l'escadre atteint l'Alaska au mois de juillet ; là également la rencontre avec les indiens est courtoise. Lapérouse décide de longer la côte nord-ouest américaine jusqu'à Monterret d'où il effectue une traversée sans escale du pacifique en direction des philippines qu'il atteint début 1787 puis la Chine, l'île de Sakaline et en septembre de la même année l'expédition touche les côtes du Kamtchatka.
Dans ce décor des confins du monde les membres de l'expédition purent contempler la chaîne des volcans en activité et y relever de nombreuses observations scientifiques. Comme les frégates regorgeaient d'une extraordinaire moisson d'échantillons, de dessins et d'informations cartographiques précieuses, Lapérouse décide de confier au jeune Jean- Baptiste de Lesseps ( grand oncle de Ferdinand) ce précieux chargement et de le conduire par voie de terre jusqu'à Versailles qu'il atteignit après une odyssée de 13 mois à travers la Sibérie, la Russie et l'Europe.
Pour leur part, L'astrolabe et la boussole poursuivirent leur exploration d'abord au îles Salomon où ils durent subirent la perte de 12 marins tués par les indigènes puis une dernière escale en Australie à Botany Bay en avril 1788. A partir de cette date le mystère Lapérouse commence avec la disparition des deux navires. Louis XVI avant de monter sur l'échafaud aurait demandé si quelqu'un avait des nouvelles de Monsieur de Lapérouse.
Pour la petite histoire le seul survivant de l’expédition est un certain Jean-Baptiste-Barthélemy de Lesseps que l’expédition débarque avec une partie des échantillons et planches botaniques récolté par l’expédition. Il traversera la sibérie, la russie et mettra un an pour rejoindre l'Europe en franchissant les fleuves, les lacs gelés, les bourbiers des plaines d’Ukraine, et ce au péril de sa vie.
Quand à la recherche des navires de La Pérouse et avec la période révolutionnaire, on ne décide qu’en 1791 d’envoyer une expédition de secours commandée par le Vice-Amiral d’Entrecastreaux qui se soldera par un échec cuisant.
Et, ce n'est qu’en 1828 que Dumont d'Urville reconnut le lieu probable du naufrage sur les récifs de l'île de Vanikoro. Ainsi s'acheva la vie d'un grand explorateur qui fut initié à la franc-maçonnerie dans la loge de Brest “l'Heureuse rencontre “ en 1779 avec le même sens des valeurs. Il connu très certainement Lafayette lors de la bataille de la baie d'Hudson pendant la guerre d'indépendance américaine.
Le 19ème Siècle
Nous voici maintenant au 19ème siècle. La connaissance des côtes et des mers est devenue précise, c'est l'intérieur des continents, en particulier l'Amérique de sud et l'Afrique qui fascinent les explorateurs et les institutions comme la royal geographical society ou le muséum d'histoire naturel.
En Amérique du Sud, une paire inséparable d'explorateurs va permettre une description très riche du bassin de l'amazone et de ses affluents les plus importants. Alexandre Von Humbolt ingénieur des mines et Aimé Goujond dit Bonpland Chirurgien de marine et naturaliste partent en juin 1799 pour un voyage d'exploration de plus de 5 ans en Amazonie.
A leur retour en France en août 1804 ils ont parcouru 15 000 km, dont 2500 de navigation fluviale sur L'Orénoque et le Cassiquiare, ont gravi les pentes du Chimborazo, un volcan d’Équateur culminant à 6 263 m d’altitude et situé près de Riobamba, à environ 180 km au sud de Quito. C’est le sommet le plus haut des Andes équatoriennes.
C'est au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris que Bonpland et Humbolt offrirent l'herbier de plus de 6000 échantillons de plantes observées et recueillies durant leur voyage. Humbolt et Bonpland sont également amis avec Simon Bolivar avec qui ils aborderont le sujet de l'indépendance de l'Amérique du Sud.
Bien sûr si Simon Bolivar est un franc maçon bien connu initié en 1803 à Cadix en Espagne dans la loge "Grande Réunion Américaine, à Paris il obtient le grade de Compagnon dans la loge "Saint- Alexandre d'Écosse”. Pour nos explorateurs, Il ne sera jamais vraiment fait état de l'appartenance à la maçonnerie d'Alexandre Von Humbolt mais ce prussien amoureux de la France et de Paris alors capitale intellectuelle du monde fréquente la communauté scientifique des grandes institutions françaises qui comptait nombre de maçons comme Laplace, Lalande ou Arago et à la fameuse société de géographie.
Quand à Aimé Bonpland , il retourna en Amérique du sud. Tout au long de ses multiples vies, voyages et engagement politique, il ne cessa d’envoyer des plantes au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris (où l’on peut encore contempler nombre de ses herbiers) et créa le Musée d'Histoire Naturelle de Corientes en Argentine. Bonpland fut franc-maçon même si son adhésion officielle ne se fit, dit-on, qu'à la fin de sa vie. D'esprit libre et visionnaire, il fut à deux doigts d’être emprisonné accusé de conspiration contre le président argentin de l'époque. Mais la fibre de l'explorateur le reprend et il va remonter le Río de La Plata vers le nord, en direction du Paraná, où il découvre dans l’île de Martín García des plants de maté, la fameuse infusion du Paraguay jalousement gardé par les jésuites.
L'Afrique est un continent où au 19ème siècle d'immenses régions restent à explorer car les cartes sont en grande partie incomplètes. L'Afrique équatoriale reste un mystère aussi bien à l'est qu'à l'ouest.
Richard Francis Burton proche de la maçonnerie fut un voyageur incessant et grand érudit. Il dirigea une expédition commanditée par la société royale de géographie à la recherche des sources mythiques du Nil. Cette expédition reconnaîtra le Lac Tanganyika en 1858.
A l'ouest, c'est Pierre Savorgnan de Brazza qui se prend de passion pour ce continent à peine exploré. Dès 1874 il remonte L'Ogooué qui prend sa source dans l'actuelle république du Congo. En 1875 alors Capitaine de la Marine nationale, il est à la tête d'une première exploration qui veut prouver que l'Ogooé et le fleuve Congo ne font qu’un, la mission prouvera le contraire et Brazza rebrousse chemin. Une 2ème expédition sera couronnée de succès avec la reconnaissance du fleuve Congo et les sources de l'Ogooé. Il pactise avec les tributs et rois locaux permettant l'établissement d'un comptoir français à Nkuna sur le Congo qui s'appellera Brazzaville. Brazza est un franc maçon actif généreux et profondément humain. Il fut initié en 1888 dans la loge “Alsace Lorraine“ à l'Orient de Paris.
Le XXème siècle, le siècle des révolutions techniques au service des explorateurs
Nous arrivons maintenant au XXème siècle. La révolution industrielle a bouleversé les moyens de transport, les distances du monde ont commencé à se rétrécir, l'ère de la vitesse a commencé, celle de la démesure aussi. La planète semble de mieux en mieux connue pourtant, des parties du globe ne sont pas encore accessibles et attirent la convoitise des explorateurs : c'est la conquête des pôles.
Robert Peary est le premier explorateur et maçon à atteindre le pôle nord en traîneau accompagné de 4 guides inuit le 21 avril 1909. Mais comme le pôle est un océan glacial, la dérive de la banquise n'a probablement pas permis à PEARY d'atteindre précisément le pôle nord géographique. Un autre maçon Richard BYRB est le premier américain à survoler le pôle nord en 1926. il fut initié par la “federal lodge “ à l'Orient de Washington DC et fonda en 1935 la “First Antartic Lodge“ .
Le Pôle Sud est lui un continent difficilement accessible car il faut traverser le 40ème rugissant et les 50ème hurlants pour atteindre cette terre parmi les plus inhospitalières au monde.
Ernest Henry Shackleton est le véritable aventurier du pôle sud. Lors de sa première expédition en 1908 il gravit le mont Erebus sur l'île de Ross, un volcan haut de 3794 mètres. Ensuite, après un périple de 2000 kilomètres à pied en tirant 300 kg de traîneau chacun avec deux de ses compagnons, ils plantent l'union jack à l'emplacement du pôle sud magnétique. Cette première expédition lui vaut d'être anobli par Edouard VII.
Mais c'est lors de sa seconde expédition au pôle sud en 1914 qu'il va révéler ses qualités extraordinaires de chef, de survie et de maçon. Arrivé au large des côtes du continent blanc, son navire l'Endurance est pris par les glaces . Sa coque de bois ne tarde pas à se briser par les mouvements de la glace. L’équipage quitte le navire qui sombre. Pendant plusieurs mois les 25 hommes campent sur un bloc de glace en attendant la débâcle de la banquise pour atteindre en chaloupe l'île éléphant. Shackleton éternel optimiste repart sur une chaloupe avec 5 hommes pour chercher des secours laissant le reste de l'équipage sur l'île. Après 17 jours de traversée il réussit à accoster et marche à travers une nature hostile pendant 36 heures avant d'atteindre le premier village. Grâce à cet exploit il sauva son équipage d'une mort certaine. Shackleton fut initié dans la Loge "Navy Lodge" de la Grande Loge Unie d'Angleterre à l'Orient de Londres, le 9 Juillet 1901
Roald Amundsens est lui aussi un géant de l'arctique. Il a déjà franchi le passage du nord ouest entre l'atlantique et le pacifique. Pour l'expédition pôle sud il appareille de norvège à bord du Fram pour mouiller à l'extrême est de la mer de Ross et en traîneau à chiens et à skis Amundsens et quatre compagnons atteignent le pôle Sud le 14 décembre 1911. Franc-maçon, il perdra la vie en 1928 au nom de la fraternité lors d'une expédition de sauvetage en mer de Barents de l'explorateur italien Umberto Nobile.
Juste un petit mot sur le commandant Charcot qui fut l'explorateur des pôles français et même s’il ne fût pas maçon il en eut toutes les qualités de vertu et de fraternité. Après avoir sillonné les mers froides des deux hémisphères et marqué l’empreinte française de l’exploration de ces régions désolées Il périt dans le naufrage de son navire le “pourquoi pas“ avec ses hommes non loin de Reykavik en Islande le 16 septembre 1936. La même année, il avait aidé un tout jeune ethnologue à aborder les côtes du Groenland. Ce Chercheur lui aussi français allait s’illustrer dans la connaissance de l’arctique et des Inuits il s’appelait Paul Emile Victor.
Nous sommes maintenant en 1969, le 16 juillet exactement. C'est le jour historique où 2 hommes foulent le sol lunaire. Neil Amstrong et Buzz Aldrin sont à ce moment les premiers explorateurs d'un autre monde et à contempler de la mer de la tranquillité où s'est posé eagle, leur module lunaire, notre planète à 384 000 km de distance. De si loin, Elle apparaît d'un bleu parfait mais aussi petite et fragile dans le vide infini de l'espace.
“Un petit pas pour l'homme mais un bon de géant pour l'humanité“ dira Amstrong. Cet exploit autant technologique qu'humain est l'entreprise qui a le plus mobilisé l'intelligence, le risque, le courage et la quête de réponses face à l'inconnu malgré les immenses dangers d'une telle mission.
Et ce sont bien 2 maçons qui les premiers réalisèrent cet exploit. Niel Amstrong ne revendiqua jamais son appartenance à l'ordre. Buzz Aldrin lui ne s'en cacha pas. Il fut initié au REAA dans la “loge MontClair“ à l'Orient du New Jersey en 1965.
Et demain me direz -vous?
Demain d'autre mondes restent à découvrir, explorer et comprendre. Des profondeurs de la terre et des océans aux monde secret des dernières jungles tropicales ou encore aux planètes lointaines du système solaire, ou au-delà vers les nouvelles exoplanètes et peut être les vies extraterrestres qu’elles pourraient abriter ; la quête est aussi vaste que l’univers et presque sans fin.
Et si pour nous maçons le chemin initiatique et symbolique nous donne parfois quelques clés sur l'au-delà de l'horizon spirituel c'est peut-être également le voyage et l'exploration du réel qui forment la parfaite synthèse entre chacun d'entre nous et le cosmos.
J'ai dit
Vénérable Maître
J-P B.